Quelques entrelacements : introduction et sommaire
Par où prendre les films de Jean Eustache en ce jour ? Mille filets, mille façons, mille « pièges » tendus selon un mot qui revient souvent à propos du cinéaste et de ses dispositifs, nous appâtant de plus belle par la force de tous les retournements médiatiques et affectifs qui scellent la différence des temps. Restaurés, remis en circulation à l’été 2023, et tout récemment assemblés dans un coffret après des années d’atermoiements, ces films nous trouvent de fait dans un état de spectature qui semble à première vue en porte-à-faux avec l’état d’esprit par lequel ils se firent jour. Ne fallait-il pas Eustache pour réapparaître en ce moment, dans cette ambiance peu rassurante de post-vérité, ne serait-ce que pour poursuivre ce goût persistant de réagir contre, de contredire pour, de continuer d'amplifier de manière sibylline le tremblement entre le fictif et la parole donnée, et de réagiter nos troubles du genre, par contraste interposé avec #Metoo ? « Frappez fort comme pour réveiller un mort », avait-il écrit sur sa porte de suicidé. À réveiller le mort, le voici toujours en train de prêter l’oreille à nos voix dans la nuit.
Logiques du secret
À l’origine de ce dossier, s’il y avait au départ une envie personnelle de faire retour vers un moment inaugural de cinéphilie autour de La Maman et la Putain (1973), de creuser quelque vingt-cinq ans après l’avoir vu pour une première fois tout ce qu’un film peut projeter autour de lui dans la durée, tout ce qu’un film de la durée peut transformer sous l’effet des couches de sa propre vie, la force de travail s’est bien vite transformée en souhait plus ample de se déplacer à travers une filmographie qui, soudainement disponible, invitait au jeu de l’œuvre ouverte. Les films d’Eustache circulaient certes jusqu’ici plus ou moins sous le manteau — par le truchement de copies pirates et de numérisations web. Néanmoins, la restauration, l’épreuve du grand écran et la réapparition convient un nouveau regard collectif sur une œuvre au statut paradoxal, confidentielle et connue à la fois.
Cette filmographie, qui consiste en treize films aux formats si divers, répondant de dispositifs extrêmement précis, fait signe sous tant d’égards vers ce que Louis Marin appelle une « logique du secret ». Logique du secret depuis une mise en réserve ou une mise à l’écart du temps même du vécu d’Eustache et dans l’après-coup de sa mort, ses films ayant somme toute peu été montrés ; logique du secret depuis le différé où Eustache nous parvient, en ce que le secret est, dans les mots de Marin, un « effet présent dans le présent d’un état passé 1 », une inscription dans une temporalité du futur antérieur, un déjà-là. Ce qui perce sous une couche appelant à ce que l’on s’approche, que l’on écoute et exhibe à la fois. Mais logique du secret depuis l’en dedans des films même, en ce que le secret est « l’effet — négatif — de relations et d’interactions », un « simulacre », un « rien », un « comme si 2 », une petite constituante larvée qui a partie liée à la répétition et au louvoiement, là où le même recèle de la différence, où la révélation devient visée.
À l’origine de ce dossier également, une certaine déception éprouvée devant la façon dont les films restaurés ont été montrés à Montréal pour la première fois, l’été dernier, au Cinéma du Musée. Jetés là, sans geste de programmation autre que de reprendre les (non) agencements peu amènes des disques durs par lesquels les numérisations sont transmises, les films ont été projetés pêle-mêle devant de tristes salles vides. J’ai été surprise d’assister à une séance montrant Le Cochon (1970) jumelé à Une sale histoire (1977), sans aucune forme de justification ou de référence à l’intelligence de l’œuvre et à ses étapes de développement, alors qu’une dissonance importante se produit entre ces deux films réalisés à des moments théoriques opposés. Et alors que la question du « comment montrer et dans quel ordre » innerve pourtant Une sale histoire.
Voici un film tenant sur deux captations d’un même récit de voyeur en une version dite « fictive », tournée en 35 mm et narrée par l’acteur Michael Lonsdale ; et en une version dite « documentaire », tournée en 16 mm et racontée par Jean-Noël Picq, auteur de la « sale histoire ». Le choix donc, d’une trajectoire inversant la hiérarchie toute puissante qui prévaut entre document et fiction, un fourvoiement délibéré. En l’occurrence, une sorte de confession littérale et fascinante racontée deux fois, celle d’un homme se rendant dans les toilettes pour observer le sexe des femmes. Matrice retorse et duplice d’une sophistication inouïe, film de secret confessé et de spectature montrée, de capture du dispositif d’énonciation tendue sur le fil d’une sexualité posée sur le bout de la langue, Une sale histoire joue de la juxtaposition de ses versions comme un questionnement ouvert jusqu’à la béance.
Cela a été souvent dit, les films de Jean Eustache s’abreuvent à une infinité de plis de temps, perdu/retrouvé à la façon dont, chez Proust, l'a postériori de la phrase retrouve le présent de la lecture en une mise en sensation et réflexion du passé, mais davantage, ils sont l’affaire de révélations mutuelles, d’ordres étranges en lesquels se nichent tant d’enveloppes fictives ricochant entre elles. Ils s’entrelacent les uns les autres, s’interprètent les uns les autres. Cette question de l’ordre, de la répétition, des liens souterrains qui aménagement des effets de révélation que condense Une sale histoire est, à vrai dire, disséminée un peu partout dans l’œuvre, et elle demandait à être mise au travail.
Il y a les deux Rosière de Pessac, films tournés à dix ans d’écart (en 1968 et 1979) montrant la même et exacte trame évènementielle — la délibération et le couronnement d’une jeune fille vertueuse dans la ville de Pessac, autre forme ou concours de révélation — et qu’Eustache conseillait de regarder en ordre déchronologique. Il y a Numéro Zéro (1971) et Odette Robert (1980), le second étant une version abrégée pour la télévision du premier. Il y a le rapport qu’entretient Une sale histoire avec Le jardin des délices de Jérôme Bosch (1979), le second reprenant la mise en scène conversationnelle du premier. Et puis le rapport qu’entretiennent Une sale histoire, Le jardin des délices de Jérôme Bosch et Les photos d’Alix (1981), le dernier faisant dérailler l’ekphrasis présente dans les deux précédents films. Ce goût du jeu réflexif, de la mise en miroir et du re-façonnage incessant, est d’ailleurs présent dès la sortie des deux premiers films d’Eustache, Du côté de Robinson (1963) et Le père Noël a les yeux bleus (1966). Encore dans le giron de la Nouvelle Vague, ces deux moyens métrages de fiction se plaisent toutefois à confondre leur propre nomenclature et à jouer de leurs effets de corpus, en étant également lancés ensemble, en 1967, sous le nom de Les mauvaises fréquentations. C’est dire que, dès le départ, le faire du film comprend dans son filet une opération de jumelage, de mise en lien, de chapitrage et de re-lecture de la démarche, une attention de présentation a posteriori qui « pense » et mise sur un effet théorique de révélation.
Comment accompagner le secret ; comment nous accompagne-t-il ? Comment déployer le secret ; comment nous déploie-t-il ? Ce dossier veut donner corps à ces questions en réfléchissant quelques entrelacements tendus par Eustache.
Corpus
Si La Maman et la Putain survient et saillit dans différents articles, nous avons surtout cherché, avec les auteurs et les autrices du dossier, à frayer d’autres films du corpus eustachien, à fabriquer aussi des trajectoires de pensées, des intrigues entre les films et des désirs de voir. Il s’est moins agi de cerner historiquement la nébuleuse Eustache, quoique cela affleure, qu’à vivre des états d’éclosion. À donner corps à la façon dont les pièges s’activent et nous activent. À constituer des états de pensée à travers des sensibilités cinéphiliques d’aujourd’hui.
Les deux premiers textes du dossier éclairent chacun à leur façon la prise de distance d’Eustache vis-à-vis du paradigme de l’auteur, une scission qui s’affirme dans l’après-coup de la création des premiers moyens métrages de fiction du cinéaste et qui cerne une première étape de développement de son travail.
Dans un premier texte pour Hors champ, la programmatrice Charlotte Lehoux s’interroge sur le caractère ethnologique du diptyque des Rosière de Pessac (1968 et 1979), avec un Eustache qui « se fait tout au long observateur, filmant chaque étape de ce rituel avec la caméra d’un documentariste, de sorte qu’il donne l’impression de s’effacer, de s’invisibiliser comme réalisateur ». Pour l’autrice, cette distance, si elle se corrèle à une absence de jugement devant un rituel en décalage avec son époque et ouvre vers des considérations sur le temporalité, comporte surtout, en creux et à travers la figure tutélaire de la Rosière, une « compassion pour cette jeunesse passive malgré elle, cette jeunesse à qui la parole est trop peu permise ». De là, c’est un certain paradigme nostalgique et un attachement à l’adolescence comme clés de lecture de l’œuvre qui retiennent l’autrice, en s’entrelaçant notamment à Le père Noël a les yeux bleus (1966) et à Mes petites amoureuses (1974).
« Imaginons dès lors qu’Eustache et Barjol, en fanatiques lumiéristes, auraient vu La charcuterie mécanique. Qu’animés d’un geste poétique et critique, ils auraient tenté de percer l’apparence tranquille qui se dégage de la captation de Louis Lumière, adopté un esprit anti-méliésien, et cherché ainsi à dévoiler les rouages du tour de magie. Question délirante : que se passe-t-il à l’intérieur du coffre ? Pourquoi garder secret ce qui s’y cache ? Que dissimule-t-il dans ses plis ? ». Ce sont ces très belles questions heuristiques que pose Carlos Solano dans un texte qui porte sur Le cochon (1970), film qu’Eustache co-signe avec Jean-Marie Barjol et qui montre, dans la plus grande distance, toutes les étapes d’abattage et de traitement artisanal de l’animal, depuis l’égorgement jusqu’à la mise en viande. Ce faisant, c’est sur la piste du « retour aux sources » et la nécessité du geste de revenir vers l’arrière dont avait discuté Eustache dans un entretien de 1971, que Solano se penche, avec pour hypothèse la transfiguration par le cinéma, outil de transformation du réel.
Les cinéastes Samuel Cogrenne et Rachel Samson se saisissent de l’occasion que représente le travail en cours de Cogrenne, lequel porte sur ses deux grands-mères, pour réfléchir ensemble au moment d’acmé que représente Numéro zéro (1971). À travers un riche et généreux entretien, les cinéastes contextualisent, détaillent, observent, mettent en parallèle et réfléchissent, pour ainsi dire à haute voix, tout ce qui entoure cet autre retour aux sources que constitue la captation de la parole de la grand-mère du cinéaste, Odette Robert, en rapport avec le film qu’en tire Eustache pour la télévision (Odette Robert, 1980). Film d’épure et de dispositif par excellence avec ses deux caméras et microphones posés autour d’une table nappée, ses claps apparents et son tabac de temps qui se consume, Numéro zéro se fait, de manière similaire à ce que sera Une sale histoire en 1977, point de basculement, moment de refonte du faire cinématographique. Et si pour beaucoup, Eustache est le cinéaste de la parole, cet entretien éclaire si bellement en quoi l’écoute est son corollaire affectif et technique exact, puis en quoi Numéro zéro fournit la dimension matricielle de cette écoute dont tout le potentiel sera déployé par la suite dans l’œuvre du cinéaste.
Nous continuons de nous déplacer dans l’œuvre d’Eustache avec une réflexion qui, cette fois, situe le cinéma d’Eustache en rapport avec la configuration historique et affective de la Post-Nouvelle Vague dans sa relation à la Nouvelle Vague, depuis l’architectonique du trou que donne à imaginer Une sale histoire. Comment le problème de la construction du monde autour du vide génère-t-il une approche de l’expérience intime et des formes ? Comment le vertige des possibles, caractéristique de cette Post-Nouvelle vague, crée autant de couches de protection par le réglage strict, le travail sur des qualités de lourdeur stabilisante ici comparées à celles qui informent le postimpressionnisme dans sa relation à l’impressionnisme ? Si Mohammad Reza Amiri brosse ici une large et riche toile de compréhension contextuelle entourant la Post-Nouvelle Vague en discutant entre autres films de La Maman et la Putain et du rapport d’Eutache à Pialat, son approche formaliste nous plonge du même souffle au cœur du « problème » — comme appelaient les historiens de l’art allemand du 19e siècle le nœud de relation entre les qualités des œuvres et leur rapport à l’univers historique —, de l’engendrement des formes chez Eustache, jusqu’à l’affleurement de l’impossible que représente Une sale histoire.
En un retournement de la forme qui s’arc-boute sur le dandysme, Antoine Achard postule a contrario de la stabilité et de la gravité, une inversion des rapports entre surface et profondeur à la faveur de laquelle c’est le rapport à la surface et aux yeux qui prévaut. Portée par la figure tutélaire de Jean-Noël Picq dans Le jardin des délices de Jérôme Bosch (1979), le dandysme que déploie Antoine Achard, loin du trope souvent cité dans l’exégèse eustachienne et jamais vraiment explicité, révèle la viscéralité d’une posture de renversement au monde. De la même manière que la toile de Bosch ne recèle pas de symbole pour Picq, le dandysme brandit son apparaître comme une composition pleine, là pour être vue et pour être dite. « J’aimerais suggérer, écrit Achard, qu’il ne faut peut-être pas lire Eustache ; peut-être faut-il plutôt en parler exactement comme Picq parle de Bosch, c’est-à-dire en s’accrochant à ce qui est là — le visible et le détail — et, plus spécifiquement, à la manière dont ces détails font corps ». De cinéaste de la parole, Eustache se fait cette fois, sous le regard d’Achard, « cinéaste du corps » : partant du Jardin des délices de Jérôme Bosch, il fait détour vers la figuration du vêtement comme modalité de l’image dans Le père Noël a les yeux bleus, La Maman et la Putain et Mes petites amoureuses.
Dans la préparation de ce dossier, un diptyque inattendu s’est formé avec les propositions de Frédérique Bernier et d’Éric Thouvenel, autour du film Les photos d’Alix (1980). Avec pour prémisse une scène et un dialogue issus de Mes petites amoureuses, l’écrivaine pose cette question cruciale : « à quelle condition une expérience esthétique est-elle (ou fait-elle accéder à) une expérience de vie, et non quelque chose de figé, de fabriqué, de factice, un faux-semblant détournant de la vie (ou y palliant), plutôt qu’y engageant ? ». Du Daniel s’interrogeant devant ce qu’on lui enseigne, l’expérience des Photos d’Alix réfléchit la fécondité de l’écart, du ratage, voire de la relation qui en atteste, celle d’Alix Cléo Roubaud à Boris Eustache, en allant vers quelques pages du Journal d’Alix qui portent sur les relations (érotiques) de vie et de mort à l’image et davantage sur un rêve émané autour de la mort d’Eustache. Nous sommes dans ce texte tour à tour Alix et Boris, tour à tour image flottante, parole décrochée, flottement d’existence.
Eric Thouvenel dégage la poétique de l’incompréhension qui émane des Photos d’Alix (1981) en examinant rigoureusement l’orchestration de la matière filmique. Des plans des images aux plans des deux interlocuteurs qui les regardent, la traversée de ce film de 19 minutes montre un dérèglement entre images et son tendu sur un étrange rapport d’inégalité interprétative entre deux personnes devant les images. « Entre Boris et Alix, c’est d’abord la relation aux images qui diffère, si profondément qu’elle conditionne des régimes de présence au monde amenés à s’entre-dévorer », écrit Thouvenel. Et alors que la mécanique des raccords laisse passer des bris et des étrangetés, que la relation entre l’image et la voix prend à parti celle de Boris et d’Alix, la « parole-en-l’image » continue de lier, les « voix échappées de corps incomplets […] donnent substance à ces images en déshérence ». Un sourire passe.
Plongeant dans le premier plan d’Offre d’emploi (1981), dernier film d’Eustache, Olivier Godin fait courir ses pensées à la mesure des menottes et petits pieds d’enfants qui apparaissent sur son journal de générique d’ouverture, en allant vers leur hors champ. Aussi porteur d’une « charge allégorique pénétré de désespoir », Offre d’emploi, argumente le cinéaste avec lui-même et un mystérieux René intérieur, tire également vers la lumière, oscille entre les pôles. Nous regardons avec Godin un matin et un crépuscule, où se métaphorisent une vie de cinéaste et davantage les conditions de possibilité de faire du cinéma, mais matin et crépuscule encore que constitue l’espoir de faire des films, lorsque Godin regarde ses étudiants regarder Offre d’emploi. Les enfants du hors champ, nous les espérons éternellement tapageurs.
Enfin, je m’entretiens avec Philippe Azoury à qui nous devons le très beau Jean Eustache. Un amour si grand… paru aux éditions Capricci en 2023. Livre aussi rigoureux que libre en ses interprétations et sa mise en travail de l’histoire, des films, d’une vision eustachienne du monde, de ses contenances enfouies, sa trame m’a beaucoup accompagnée pendant les derniers mois, m’aidant à articuler les films d’Eustache à mon « aujourd’hui », à donner de la profondeur à mes élans. L’un des ressorts les plus patents d’Un amour si grand… est, parallèlement à ce que remarquent Samuel Cogrenne et Rachel Samson dans leur entretien, l’adossement chez Eustache de la parole à des cadres d’écoute multiples — technique, de mise en scène, de dispositifs et de reprises — avec toute la résonance psychanalytique que cela comprend. Un fil transparent coud le silence de la Rosière à la parole de Véronika, le témoignage d’Odette Robert à l’écoute de son fils, le silence d’Alexandre à la reprise d’une parole de désir masculin dans Une sale histoire, tandis que que le silence des femmes de l’audience est cerné, comme pour mieux faire comprendre que, pendant ce temps, elles pensent. L’entretien aborde ces questions, en plus de celles de l’écriture, d’une certaine et étonnantte affinité d’Eustache avec notre époque, des souterraines inflexions lacaniennes que dégage Azoury, de la consolation et de l’inconsolation.
__________________________
Épilogue de l'avant
Et si je pouvais choisir qui je suis-je serais une voix de téléphone car j’aurais une vie de fée, je pourrais parler à tout le monde sans que personne ne me voie, je serais la fée des dents parce qu’elle vit en secret et dans la nuit. j’ai cherché des endroits où l’on pouvait perdre son visage et j’ai trouvé la pénombre mais aussi la voix, car parfois quand on se met à dire il arrive qu’on altère son image ou qu’on la renverse, qu’on descende dans ce qui nous travaille et qu’on dessert un peu ce qui nous enferme.
Quand je ne dis rien, je pense encore, Camille Readman Prud’homme
J’ai choisi une image pour illustrer ce dossier. Image d’un plan fulgurant qui se produit durant Numéro zéro, vers la fin de ce film qui consiste à capter, à l’aide de deux caméras, la vie et la parole d’Odette Robert devant son petit-fils qui manie le clap. En une réduction radicale de l’économie de tournage, ce film-confidence apparaît en train de se faire, le long de souvenirs, de vies démultipliées, à la façon d’un vêtement retourné. Après une heure et demie d’enregistrement, le téléphone sonne, interrompt le flux en cours, telle une couche plus profonde de ce qu’Eustache appelait « principe de non-intervention », ou ailleurs, « enregistrement pur ». Le tournage est surpris, mais la caméra continue de tourner. Jusqu’ici, Eustache que l’on perçoit dans le champ, assis à table, de dos en plan moyen ou présent de sa simple main qui fume lors des plans rapprochés sur sa grand-mère, envisage Odette Robert qui est de face de l’autre côté de la table. Une composition à la fois simple et savante qui, avec sa table, son après-midi, ses objets, fait penser à la tranquillité réflexive des natures mortes, mais qui surtout invente une formule visuelle de co-appartenance à l’échange sans champ-contrechamp, une formule qui accomplit la solidarité de la parole à l’écoute. Eustache sort alors légèrement du champ pour aller répondre au téléphone. L’une des caméras reste pendant quelques secondes sur Odette Robert qui écoute en silence la conversation téléphonique que son fils est en train d’avoir devant elle. Une sorte d’envers de la parole et du silence, de redoublement inversé. Et puis cette même caméra, en une coupe franche de montage, rejoint Eustache. Elle cadre son dos, ses cheveux noirs qui retombent sur son vêtement noir. Derrière, une porte entrebâillée, un seuil. Eustache parle au téléphone. La caméra s’approche, le dos sature avec opulence le champ. Quelque chose se passe, quoi, on ne le sait guère, mais on le sent. Une dilatation.
Étrange situation où le caméraman a eu le flair d’absorber ce dos que Eustache a décidé de conserver au montage, à l’intérieur d’un film pratiquement sans montage. Il ne faut qu’un petit pas de plus pour voir là s’incarner le positionnement de refus d’Eustache à l’endroit de la politique des auteurs. L’idée d’enregistrement pur à même l’incorporation de soi, à même la figuration de son propre corps sans visage, et sur lequel insiste la caméra.


Numéro zéro (1971)
À l’inverse des rückenfiguren, ces figures romantiques dont le dos fournit un relais au regard devant l’étendue du paysage, ce dos qui sature le champ ne renvoie qu’à lui-même. Il m’évoque le trou d’Une sale histoire. Il m’est un noir qui avale, une profondeur insaisissable, une béance. Un sexe, à tout prendre. Et comme dans Une sale histoire, le trou contient un trou, en ce cas, un film, Le père Noël a les yeux bleus qu’un producteur hollandais voudrait diffuser à la télévision, ce que l’on apprendra par la suite de la bouche d’Eustache, tandis que le film reprend son cours aussi rapidement qu’il ne s’est interrompu, comme si naturellement, un film se montrant en train de se faire devait contenir un film en train ou sur le point d’être diffusé.
Ce dos, en son renvoi virtuel au refus de l’auteurisme d’Eustache, me fait également penser à cette phrase de Foucault que je contemple à l’intérieur de moi comme on regarde sans cligner des yeux les pierres d'un jardin zen : « Plus d’un, comme moi, écrivent pour n’avoir plus de visage 3 ».
Et ce dos d’Eustache, suspendant la forme si réglée de Numéro zéro, si je n’arrive pas à m’en détourner, c’est qu’il me renvoie aussi à la dernière image que le cinéaste a partagée de lui aux Cahiers du cinéma 4 et qui le montre cette fois de dos, nu et étendu.

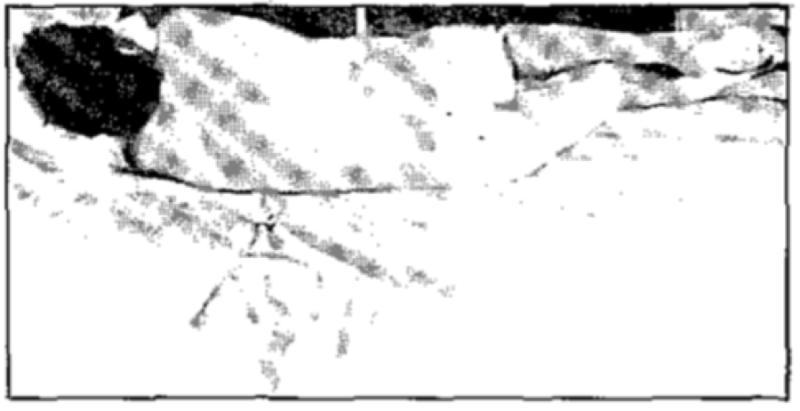
Seules images trouvées de celles qu'Eustache choisit de montrer de lui, dans un texte qu'il transmet aux Cahiers du cinéma paru en 1981, quelques mois avant sa mort.
Vers la fin de sa vie, Eustache ivre appelait ses amis durant la nuit, à tout bout de champ. La nuit de sa mort, c’est aussi ce qu’il a fait. Peut-être parce que je suis aussi superstitieuse qu’Odette Robert qui se tire les cartes, je n’arrive pas à ne pas voir dans ce plan de dos d’Eustache qui parle au téléphone, dans ce trou formé dans le récit de Numéro zéro et dans le quadrillé du plan même, dans le renversement du visage et de l’auteur qu’il métabolise, une forme de préfiguration de sa mort. Mais ce serait aussi parce que le jeu des formes est le même : téléphone, dos, trou, refus d’une certaine idée de soi, retourné contre soi, choix délibéré toujours.
Dans l’introduction du Dictionnaire Eustache, Antoine de Baecque écrit que La Maman et la Putain et le suicide d’Eustache sont deux arbres qui cachent la forêt Eustache 5 . Or, si je me suis vite débarrassée de tout ce que contenait de romantisme ou d’idées surfaites mon rapport à La Maman et la Putain, je dois admettre que le suicide d’Eustache a en revanche beaucoup pesé ces derniers mois sur mon écoute. Comme s’il regardait tous les coins par où je prenais les choses, comme si, depuis les films jusqu’à ma vie — et c’est Philippe Azoury qui a si justement formulé ce que fait le suicide des autres — il me désignait 6 .
Mais je reprends la phrase de Foucault. Écrire pour ne plus avoir de visage ne signifie pas se suicider. Cela veut dire plusieurs choses, et avec Eustache, on écrira sans visage pour se faire corporellement médial, pour user de soi comme d’un outil de captation de parole (de discours) et d’écoute, ce qu’explique aussi Foucault de manière savante dans l’Archéologie du savoir dont est issue la phrase citée. On prendra le discours comme ces pans à découper, à relier ensemble afin, chez Foucault, d’accéder à des épistémès : c’est-à-dire à des entrelacements de savoirs dans un ordre donné ; chez Eustache, afin d'accéder à des morceaux d’intimité travaillée, à des entrelacements de temps et d’affects toujours remédiés.
Écrire pour ne plus avoir de visage veut alors également dire prendre un pas de recul en tant que soi vis-à-vis de soi, toucher peut-être à des sensations épiphaniques de dissolution de son propre narcissisme au sein d’une écriture que l’on pourrait dire d’écoute.
Capter des paroles, en faire un vêtement cousu, cela ressemble aussi à monter un dossier pour une revue. Et il me semble qu’Eustache, s’il réfute non sans paradoxe l’auteurisme, retient quelque chose de mon idéal de la position de l’éditeur et de la place centrale que revêt l’édition à mes propres yeux : l’invention et le maintien d’un espace par où la parole des autres est entendue, prise au sérieux, par où elle circule.
*
ENTRELACEMENTS DE JEAN EUSTACHE
Charlotte LEHOUX, Une belle souffrance
Carlos SOLANO, Éventrer Lumière : le Réel devenu coupable
Samuel COGRENNE, Rachel SAMSON, D'Alice, d'Yvette et d'Odette Robert
+ Alice / Yvette, images de Samuel COGRENNE sur Zoom Out
Mohammad REZA AMIRI, Une sale histoire, un film solide et durable
Antoine ACHARD, Le plus superficiellement possible, donc à l'envers
Frédérique BERNIER, De vie ou de mort. À propos de Jean Eustache et d'Alix Cléo Roubaud
Éric THOUVENEL, Deux vases communicants (Les photos d'Alix)
Olivier GODIN, Lumière et Ténèbre
Maude TROTTIER, Entretien avec Philippe Azoury
*
Notes
- Louis Marin, « Logiques du secret », Traverses, 1984, nos 30-31, p. 60. ↩
- Ibid., p. 61 ↩
- Michel Foucault, L’archéologie du savoir, 1969 [1966], Paris, Gallimard, p. 28 ↩
- Jean Eustache « Peine perdue. Fragments d'un scénario abandonné », Cahiers du cinéma, n° 323/324, mai 1981, p. 63. ↩
- Antoine de Baecque (dir.), Le dictionnaire Eustache, Paris, Éditions Léo Scheer, 2011, p. 10. ↩
- Ses paroles exactes sont : « En fait, évidemment, la mort par suicide désigne tout le monde, on se sent désigné par le geste ». Il les a prononcées lors de l’entretien. ↩
