Le plus superficiellement possible, donc à l’envers


Le Jardin des délices de Jérôme Bosch (1980)
Le Jardin des délices de Jérôme Bosch (1980). Jean Eustache met en scène une soirée d’amis, durant laquelle Jean-Noël Picq, installé dans un fauteuil de cuir rouge, monologue à propos de l’œuvre éponyme du peintre flamand. Sur ses cuisses repose un rouleau où sont reproduits les trois panneaux du retable. C’est sur le plus célèbre de ces panneaux, celui de l’Enfer, que Picq s’attarde. Il débute par le bas : une nonne à tête de cochon (ou peut-être un cochon vêtu en nonne) se fait embrasser (ou repousser) par un homme nu. Derrière eux, un heaume bipède et percé de flèches les épie, plein de concupiscence…
Voir, puis rapporter ce qui est vu : voilà ce que se contente de faire Picq. Ses mots ne traduisent pas un esprit, mais une paire d’yeux. Et le tableau n’est plus seulement là, devant lui ou devant la caméra, mais avec lui, c’est-à-dire dans sa voix. « D’habitude quand on parle de Bosch, lui remarque une amie au cours de son monologue, c’est quelque chose de compliqué. Et là, la manière dont tu nous en parles — le ton de ta voix —, on a l’impression d’une très grande tranquillité ». Jean-Noël Picq acquiesce : effectivement, il trouve Bosch d’une très grande tranquillité ; de ce tableau affolé, rien ne l’affole. Il ne comprend pas et n’espère pas comprendre : « lorsqu’on me parlait de Bosch, on me parlait d’un symbolisme, ce qui implique un sens secret, un langage de métaphore à décrypter. Or, je ne vois vraiment aucun sens dans ce tableau, donc aucun symbolisme ». L’image est là, l’image suffit : c’est d’elle qu’il faut parler, pas de celui qui l’a peinte ou du sens qu’elle refoule. L’image ne veut pas une exégèse, mais une ekphrasis ; elle ne donne pas à penser, mais à voir.
Jean-Noël Picq survient à trois reprises dans le cinéma d’Eustache : Le jardin des délices, Une sale histoire (1977), ainsi qu’une brève apparition dans La Maman et la Putain (1973). Et chaque fois que nous le croisons, il parle toujours de la même chose : de ce qu’il voit, ou de ce qu’il a vu. Que ce soit de Bosch, des femmes à moitié dévêtues dans la toilette d’un café ou d’un ami vêtu « en vert et contre tous », il n’a pas de biographie, pas de drame, pas d’arc narratif : il n’a que des yeux pour constater et une bouche pour conter — il est, à l’instar des figures de Bosch, dénué de personnalité, réduit à ses purs orifices, qu’il associe et enchaîne avec d’autres. Ce qui excite Picq le pervers dans Une sale histoire, ce ne sont pas les femmes à proprement parler, mais le fait de les épier par un trou, puisque ce trou ouvre sur un monde inusité dans lequel le rapport entre la surface et la profondeur s’intervertit, où les femmes laides ont de beaux sexes, et les femmes belles, des sexes laids.
Picq s’offre lui-même à la caméra comme une composition : son cou exhibe une cravate ascot, ses pantalons sont rayés et son veston est de velours. Cet attirail parade le programme : « ce soir, j’accorderai une attention toute particulière au détail ». Il incarne l’archétype fétiche et fondamental du cinéma d’Eustache : le dandy. Or, si Jean-Noël Picq est dandy, ce n’est pas strictement par son appétence pour les rayures ou par l’air patricien avec lequel il pince une cigarette 1 , mais d’abord et avant tout parce qu’il réfléchit Bosch comme tous les descendants de Beau Brummell s’astreignent à réfléchir le monde, c’est-à-dire en surface et avec les yeux, plutôt qu’en profondeur et avec la tête. D’ordinaire, l’aura du génie est verticale. On dit à son compte : « il est grand, il transcende, il est profond ». Mais en bon dandy, Picq fait culbuter le génie de Bosch, qui soudainement se retrouve à l’horizontale. Ainsi déboulonnées, ses qualités primordiales ne sont plus la complexité, mais l’originalité ; son ambiguïté n’est plus à domestiquer, mais à célébrer.
Toujours, le dandysme se conçoit comme une révolte, une révolte qui s’éprouve comme un retournement 2 . Aussi les nombreux dandys d’Eustache observent scrupuleusement cette règle. Prenez l’Alexandre de Jean-Pierre Léaud. Parfois, il porte un bleu de travail. Pourtant, il ne travaille pas. Autrement, il porte un costume. Cependant, il ne circule pas avec autorité, mais désinvolture. Alexandre ne s’habille donc pas symboliquement, c’est-à-dire pour signaler son appartenance à une quelconque communauté. Il refuse aux vêtements leur droit habituel de référencer autre chose que ce qu’ils sont, de s’ancrer dans le réel ou le quotidien, comme certains monstres de Bosch ressemblent à des pingouins, mais n’en sont pas. L’habillement d’Alexandre ne renvoie pas à des ensembles, mais constitue lui-même un ensemble : il ne faut pas s’escrimer à déceler dans son foulard, par exemple, autre chose qu’une note venue insister sur l’harmonie ou la dissonance de sa tenue.
Il se dit beaucoup de mots, dans La Maman et la Putain. Mais jamais le mot « dandy ». Pourtant, on ne peut que le constater. Exemple : le personnage de Bernadette Lafont annonce partir en voyage d’affaires en Angleterre et derechef Alexandre dresse l’inventaire des chemises qu’il souhaite qu’elle lui déniche. Ce détail n’est pas anecdotique. Le film est tourné en 1972. Londres pénètre dans la période tardive de la Peacock Revolution. Sur la rue Carnaby, des hommes aux cheveux longs défilent en chemise à rayures, les doigts embijoutés et les foulards bigarrés. Leurs vestons, aux épaules structurées et à la taille pincée, affichent les revers dramatiques et démesurés mis à la mode par Tommy Nutter, le démon de Savile Row. Alexandre et ses amis — notamment celui incarné par Jacques Renard, avec ses nœuds fantaisistes et ses tirades à la Oscar Wilde sur la supériorité de la fausse Marlene Dietrich sur la vraie — sont très visiblement les héritiers de cette anglophilie vestimentaire. Et bien sûr, Alexandre ne se déchausse jamais de ses bottes Jodhpur — un modèle venu d’Inde, mais diffusé par les Britanniques —, même pas dans son lit. Ainsi, le dandysme n’est nulle part nommé, mais pourtant partout 3 . Des hommes à l’apparence raffinée, mais à l’emploi du temps incertain, l’œuvre d’Eustache en grouille : Jean-Noël Picq et l’invivable Alexandre, bien sûr, mais aussi le petit-maître provençal de Mes petites amoureuses (1974) ou le charmant photographe du Père Noël a les yeux bleus (1966)… — et sans doute le réalisateur lui-même.


La Maman et la Putain (1973)
J’aimerais suggérer qu’il ne faut peut-être pas lire Eustache ; peut-être faut-il plutôt en parler exactement comme Picq parle de Bosch, c’est-à-dire en s’accrochant à ce qui est là — le visible et le détail — et, plus spécifiquement, à la manière dont ces détails font corps. Oui, peut-être qu’il faudrait prendre son œuvre comme un dandy prend les choses et exige de se faire prendre : le plus superficiellement possible, donc à l’envers. Peut-être qu’il faut entrer dans son cinéma comme on s’allonge contre un trou dans la toilette d’un café pour découvrir un monde sens-dessus…
Le père Noël a les yeux bleus (1967) s’amorce sur cette phrase : « cette année, les duffel-coats sont à la mode ». De tous les films d’Eustache, c’est celui dont le rapport à l’habillement est le plus explicitement nommé. Le film autorise à se faire lire comme une critique du consumérisme. On pourrait noter que ce dont rend compte Eustache, c’est le rapport de la jeunesse des années 1960 à la culture de masse et, plus spécifiquement, l’apparition du prêt-à-porter. Et l’on pourrait tracer un parallèle cinéphilique avec Masculin, féminin (Jean-Luc Godard 1966), puis souligner la manière dont le film se soucie plus ou moins du même phénomène avec le même acteur principal, en plus d’utiliser la pellicule non-utilisée de Godard pour ce film. Et comme Le père Noël a les yeux bleus s’achève par l’image d’une vitrine fracassée dans laquelle étaient exposées des chemises, on serait en droit de tirer une conclusion du genre : « depuis le prêt-à-porter, le vêtement n’est plus seulement un marqueur de classe, mais devient un objet de convoitise à part entière, etc. » Ça se tient, mais ce n’est pas forcément juste. Le désir juvénile du personnage de Daniel d’obtenir un duffel-coat n’est simplement — j’aimerais dire, naïvement — pas traité sur le mode critique. Plutôt, ce jeune garçon veut être au goût du jour — cela ne suffit-il pas, comme moteur narratif ? Je réitère : les vêtements n’ont pas fonction de symbole, mais de cadre ; le dandysme n’explique pas l’image, mais la met au monde.
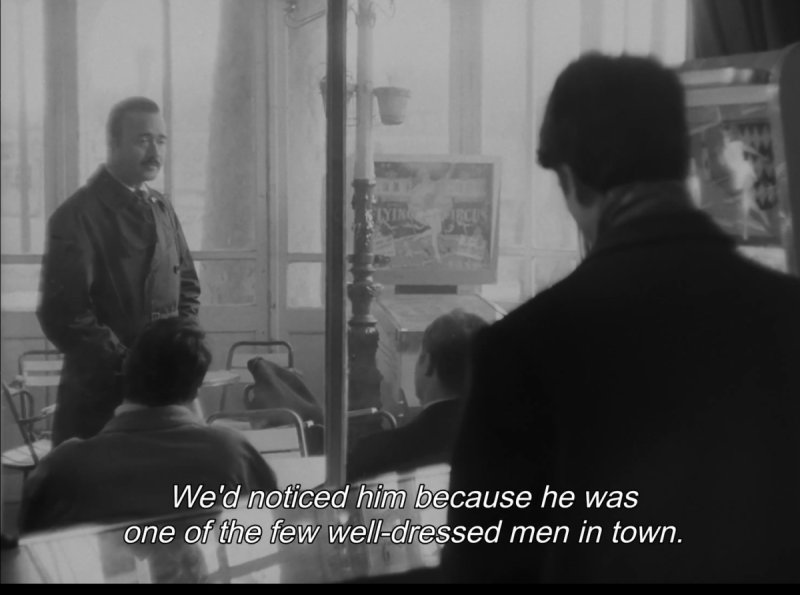
Le père Noël a les yeux bleus (1966)
Comme le Bosch de Picq, le cinéma d’Eustache parait inviter à l’exégèse pour rapidement aboutir à un cul-de-sac interprétatif. Et l’on pourrait se demander si cette posture pleine d’ironie – posture encore une fois très dandy — n’est pas parfois volontaire. C’est après tout l’enjeu des Photos d’Alix (1980) : faire correspondre des mots à des images, pour que bientôt ces mots dérivent et les images restent… — ou vice-versa ? Mais aboutit alors une situation récurrente chez le cinéaste : discuter de choses qui ne sont pas là, tandis que les choses qui sont là ne se discutent pas. Dans Offre d’emploi (1980), tout ce qu’on connait de la vie du chômeur, c’est le résumé qu’il en fait pendant son entrevue. Et de son curriculum vitae, qu’on sait être là, sur la table — présent dans la même pièce que la caméra ! — on n’apprend strictement rien. On l’aperçoit sans pouvoir le déchiffrer, tout au plus. Et les commentaires de la graphologue ne révèlent rien de son contenu. Dans sa lecture, celle-ci ne s’en tient qu’à ce qu’il y a de plus superficiel sur la surface de cette feuille : la calligraphie. C’est sur l’apparence du curriculum vitae, plutôt que son interprétation, que se décide l’embauche. À beaucoup de personnages d’Eustache incombe la question des images et de leur interprétation, de la manière dont il faut les rapporter par la parole. Dans une Sale histoire, si Picq narre son histoire pratiquement comme un égarement, Michael Lonsdale en fait une curiosité pleine de charme et de perversité. Et cette question nous occupe aussi nous, les spectateurs.
Dans La Maman et la Putain, que pense honnêtement Veronica d’Alexandre ? « Je m’en fous complètement ; je me fous de tout », déclamerait-elle, peut-être. Elle n’est pas simple à décoder, Françoise Lebrun. Elle circule les bras croisés, les yeux cernés et le dos vouté. Parfois, elle rit, et d’autres fois, elle fume. Et Daniel dans Mes petites amoureuses ne marche pas, mais bondit, ses bras inertes contre ses flancs. Et Jean-Pierre Léaud érige l’index, fait la moue, puis quand il passe sa main dans ses cheveux, il ne le fait pas avec ses doigts, mais sa paume : mises bout à bout, ces idiosyncrasies feraient la taille d’une encyclopédie. L’une des premières choses que l’on remarque des personnages, dans un film d’Eustache, c’est leur port 4 . Ils se meuvent mal, boivent vite, attendent trop longtemps pour tapoter leur mégot… Et nous passons notre temps à les constater, sans être en mesure de les décrypter. Le corps humain, chez Eustache, est une source d’ambiguïté davantage que de clarté 5 .
Et ce qui rend les personnages d’Eustache si épais, ce qui nous rend difficile la tâche de les traverser ou de les approfondir pour découvrir chez eux un sens, c’est l’emploi inusité et franchement radical du champ-contrechamp. Alexandre parle, parle et parle. Enfin, la coupe survient ! — Françoise Lebrun fume une cigarette : elle écoute. Pas de réaction à proprement parler, pas d’identification ; le contrechamp ne crée pas le sens, il le laisse en suspense. « On ne peut pas prouver Bosch, nous dit encore Picq. On ne peut en parler qu’avec certitude, sans avoir à prouver. Je n’ai pas à prouver, parce qu’il n’y a pas de relation de cause à effet ». On peut dire la même chose d’Eustache. Comme il est enseigné dans les écoles de cinéma, l’effet Koulechov procède à une mise en symbole du corps qui le rend lisible : « il est fâché, elle est triste, ils sont heureux ». Mais quand Eustache coupe pour dévoiler un corps, ce corps ne se laisse pas symboliser. Très souvent, la seule chose qu’on peut émettre avec certitude, c’est que ce corps en observe un autre parler. C’est encore le regard qui est mis de l’avant, comme si les personnages eux-mêmes étaient pris dans un processus d’interprétation semblable au nôtre. On pourrait pratiquement tordre l’expression : ils se regardent parler.
Eustache est un cinéaste de la parole, entend-on parfois. Mais peut-être qu’émettre un tel jugement, c’est déjà prendre un pas de trop ; c’est déjà lire plutôt que voir. Fions-nous à nos yeux, plutôt qu’à nos oreilles — renversons la perspective et proposons : Eustache n’est pas un cinéaste de la parole, mais du corps.

Mes petites amoureuses (1974)
Le Jardin des délices, une dernière fois. Des gens présents à cette soirée, nous n’apprenons ni leur nom ni leur rapport exact ; rien ne nous est fourni de leur proverbial fond de pensée. La seule information que nous fournit Eustache à leur propos, c’est effectivement leur corps. Nous les observons fumer, sourire, froncer les sourcils, se lever, s’approcher de la reproduction du panneau… Ensemble, ils rejouent le charme insolite du panneau de Bosch, dont « le propre des êtres qui s’y trouvent, c’est de s’y emboiter, de s’y associer de manière multiple sans qu’il soit possible de dire ce que cela veut dire », dixit Picq. L’objet d’étude de la caméra, ici, ce n’est pas seulement le Jardin des délices. L’objet d’étude, c’est aussi — et peut-être même surtout — Jean-Noël Picq qui discourt sur cette image tandis que ses amis et les spectateurs l’écoutent et le regardent. Et cet arrangement visuel très simple suffit à Eustache, comme celle de sa grand-mère dans Numéro Zéro (1971). L’image suffit toujours, avec lui. Et si elle suffit, c’est parce que le mystère ne se trouve pas au fond des choses, mais à la surface.
Notes
- Baudelaire nous le signale très clairement un essai canonique sur le sujet : « Le dandysme n’est même pas, comme beaucoup de personnes peu réfléchies paraissent le croire, un goût immodéré de la toilette et de l’élégance matérielle. Ces choses ne sont pour le parfait dandy qu’un symbole de la supériorité aristocratique de son esprit ». Charles Baudelaire, Critique d’art, Paris, Gallimard, coll. « Folios essais », 1976, p. 370. ↩
- Ou plus exactement — et parce qu’il faut nécessairement évoquer le Beau Brumelle de Barbey d’Aurevilly — le dandysme est « une révolution individuelle contre l’ordre établi, [qui] se joue de la règle et pourtant la respecte encore. [Le dandy] en souffre et s’en venge tout en la subissant ; il s’en réclame quand il y échappe. » Jules Barbey d’Aurevilly, Œuvres romanesques complètes 2, Paris, Gallimard, coll. « Pléiade », 1966, p. 675. ↩
- Comme l’urbanité chez Baudelaire, pourrait-on dire. Walter Benjamin, à propos du poète, remarque astucieusement que, « dans aucune tournure ni aucun mot du sonnet “À une passante”, on ne mentionne explicitement la foule. C’est sur elle, pourtant, que repose toute l’action, comme le mouvement du voilier repose sur le vent ». Certaines choses, un dandy doit savoir les taire pour mieux les laisser parler. Walter Benjamin, Œuvres III, Paris, Gallimard, coll. « Folios essais », 2000, p. 350. ↩
- Le port du corps est la question dandy par excellence, parce que c’est la question qui lui est sans cesse posée par les vêtements, le miroir et le regard des autres – la vie intérieure du dandy est tout entière consacrée à y répondre, de sorte qu’il ne reste, chez lui, qu’une surface. ↩
- On peut difficilement rendre compte de la radicalité politique et sexuelle du dandysme au XIXe siècle : un homme issu des classes moyennes dévoue son corps au Beau plutôt qu’à l’Utile. Idem au XXe siècle, quand les femmes dandys revendiquent des éléments de la garde-robe masculine (les pantalons, le veston, le smoking). Les hommes s’engoncent, les femmes se désentravent : le corps s’inverse, puis traverse des frontières réservées à celui de l’autre. Le dandysme aussi, exige l’ambiguïté du corps. Et le dandy cultive l’androgynie ou projette la prétention d’une autre classe économique que la sienne parce que le corps par excellence est un corps qui ne se laisse pas décoder. ↩
