Circuler dans les archives du cinéma : rencontres, gestes et affectivités
Chère Ghada,
J’ai croisé la citation ci-dessous à la Cineteca Bologna en juin 2019. J’y étais pour le festival du cinéma retrouvé (Il Cinema Ritrovato). Ce matin, je me suis plongée dans mes propres archives à la recherche de cette photo, dans l’un des multiples back-ups de mon Samsung datés de 2019. Pour la retrouver, j’ai dû traverser des images d’une relation amoureuse passée et d’un soulèvement révolu.
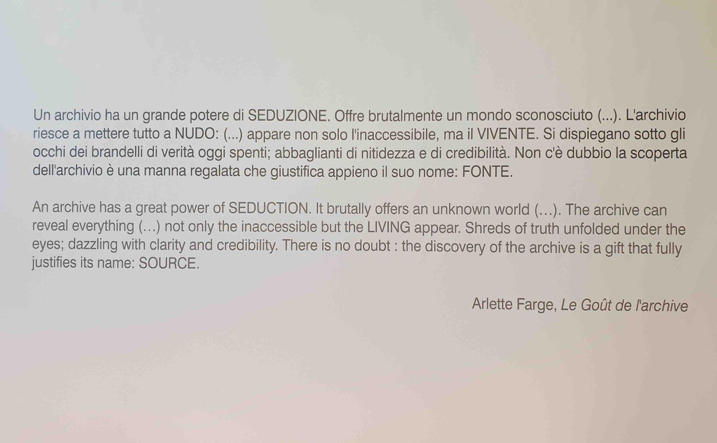
« Déroutante et colossale, l’archive, pourtant, saisit. Elle ouvre brutalement sur un monde inconnu (…) L’archive agit comme une mise à nu ; (…) apparaissent non seulement l’inaccessible mais le vivant. Des morceaux de vérité à présent échoués s’étalent sous nos yeux : aveuglants de netteté et de crédibilité. Il n’y a pas de doute, la découverte de l’archive est une manne offerte justifiant pleinement son nom : source ». (Arlette Farge, Le goût de l’archive, Paris, Seuil, 1997, p. 11 et 15)
Pendant l’année ayant suivi les trois mois passés dans la rue fin 2019, je n’arrivais pas à consulter les images prises durant cette période. Je n’y voyais que l’intensité de la vie qui nous a animés à un instant donné face à la dévastation de la mort qui nous habite depuis.
Il y a deux semaines, je me suis plongée longuement et pour la première fois dans cette archive hétérogène et accidentelle. J’observais nos corps figés en images dans des mouvements collectifs. Et puis ces quelques rares vidéos où je remarquais que nos corps n’étaient pas encore fatigués, que nos voix ne se lassaient pas de crier pour une autre fin du monde possible. Aujourd’hui, deux ans plus tard, j’ai pu circuler dans ces archives, me demandant alors : est-ce que le maniement d’une archive devient possible seulement au moment où l’apparition du vivant au sein de cette archive, comme l’écrit Arlette Farge, devient tolérable ?
Nour,
À Beyrouth, le 21 décembre 2021
*
Chère Nour,
Je ne réponds que maintenant à ta lettre, après un temps étrangement long, ou étonnamment court. La vérité est que la notion du temps se contracte ou se décontracte pour moi au gré d’un rapport au monde qui m’échappe, et ce, depuis longtemps. C’est l’écriture qui me sauve, oui. Elle est indéniablement là, lorsque tout(s) m’abandonne. Dernièrement, ou peut-être depuis plus longtemps que cela, les émotions provoquées par la rencontre avec certaines images, sonorités et écritures, me rendent extrêmement vulnérable. Je m’en méfie, me protège, me crée une carapace. Je sélectionne ce que ma sensibilité peut ou non accueillir. Je crois qu’aller à la recherche des traces du passé peut s’avérer une entreprise belle et dangereuse, une rencontre comparable à celle que l’on peut avoir avec la mort.
Il y a quelques jours, j’ai pensé à une amie qui habite Montréal, que je n’ai pas vue depuis longtemps, octobre 2019, pour être plus précise. Nous nous étions donné rendez-vous sur la place des martyrs, lorsque nos corps étaient encore emportés par cet espoir désespéré. Nous nous sommes quittées avec un petit geste de la main et ce regard conscient que, désormais, ce qui nous séparait n’était pas une distance géographique mesurable, mais celle d’une nouvelle vie dont les paramètres nous échappaient complètement.
Il y a quelques jours, donc, j’ai repensé à un message vocal émouvant que mon amie désormais montréalaise m’avait envoyé il y a plus d’un an. J’ai eu envie de le réécouter, de me souvenir de cette émotion, recherchant une vibration de beauté pour perturber cette tristesse qui m’envahit inlassablement dès que je m’arrête, un instant, de bouger. J’ai traversé l’historique assez long de nos échanges sur le téléphone, celui des nombreuses discussions, messages, images, textes, fragments envoyés ou reçus, sans savoir jusqu’où je devais remonter. Mais j’étais déterminée à retrouver cette voix du passé. Puis, je suis tombée dessus, et j’ai réécouté ces paroles émues me racontant une belle rencontre, pas si improbable et qui, je ne le savais pas encore, me concernait inévitablement. À l’instant où je me suis autorisé cette émotion renouvelée, j’ai remarqué la date de ce message : le 24 juillet 2020. Mon cœur s’est mis à battre la chamade, la série de messages suivants étant datée du 4 août 2020. J’ai lancé l’écoute d’un message, que j’ai coupé en plein milieu, mes larmes m’empêchant de la poursuivre. Et je me suis demandé, Nour, comment tant de beauté peut côtoyer, de si près, l’impensable. Comment, au même moment, ressentir cet élan du cœur et cette douleur indescriptible ?
La rencontre avec une archive est, je crois, inévitablement une affaire de vie ou de mort. Admettre que cette « apparition du vivant », qui devient tolérable comme tu le dis, est aussi une apparition de son versant. C’est oser croiser du regard, simultanément, la lumière et l’obscurité. Memories for a Private Eye (2015) de Rania Stephan, film qui mêle les archives personnelles de la réalisatrice à celles du cinéma, se termine sur les images d’un dessin animé japonais doublé en arabe. Un petit garçon qui se tient à côté d’un homme sur un bateau lui demande pourquoi il regarde le coucher du soleil. Ce à quoi il répond :
This beauty is just an illusion you cannot trust. The sunset is only a trick of the eye. In a few seconds the human heart changes, from light and happiness to darkness. Finally, I understood as I grew older, that the sunset is a lie. / So why are you staring at it? / It’s difficult not to be mesmerized by it, enraptured by its beauty.

Memories for a Private Eye (Rania Stephan, 2015)
Est-ce cela que nous recherchons, Nour, lors de la manipulation d’une archive ? Cette sensation simultanée d’être emportés par une énergie vitale et mortifère ?
Ghada,
À Beyrouth, le 30 janvier 2022
*
Chère Ghada,
Je sens que lorsque je rencontre une image d’archive, tout se joue dans ces premiers instants où celle-ci, éblouissante, apparaît en face de moi. Je sens que l’écho de cette première rencontre résonne dans mon corps à chaque nouveau contact. Je sens aussi que la manipulation d’une image d’archive renouvelle à l’infini le flash de cette première rencontre.
Sans contexte, je trouve que l’archive est trompeuse. Elle peut nous induire en erreur, nous mener à être fascinés par des images qui contiennent une infinitude de violences dissimulées par sa lumière éblouissante. Il s’agit parfois de fermer les yeux pendant un instant pour éviter la lumière et oser regarder la mort en face.
Cette double charge de l’archive que tu décris me fait penser à une phrase écrite par Rania Stephan dans son texte intitulé « L’étoffe des songes », publié dans ce dossier.
Elle nous annonce : « L’archive ne nous arrive jamais seule ». En effet, l’archive est toujours accompagnée, toujours en présence de… entre autres, l’archive est accompagnée de tous les regards qui se sont posés sur elle durant sa vie, lors de ses morts multiples et puis au moment de sa résurrection. Cette accumulation de regards finit par former une ombre.
À quoi donc ressemble l’ombre d’une archive ?
Exercice d’imagination : cette ombre est un brouillard qui accompagne l’archive de près, qui est présent et toujours déjà en décalage, comme l’ombre d’un vampire, jamais synchrone — est-ce qu’elle aussi n’aurait pas de reflet si l’on place un miroir devant elle ?

Topologie d’une absence (Rami el Sabbagh et Sharif Sehanoui, 2021)
« L’archive ne nous arrive jamais seule », répète-t-elle.
Je lui réponds : « Comme nous, elle est toujours accompagnée par son ombre… »
Elle poursuit : « Comment préparer la venue d’une image ? »
Je réponds : « C’est une opération très délicate comme on n’a que quelques infimes instants pour essayer de faire l’impossible, soit saisir l’ombre avant que l’archive ne surgisse ».
Nour,
À Beyrouth, le 1er février 2022
*
Chère Nour,
Ces belles nuances que tu égrènes délicatement dans ta lettre semblent nous mener vers un espace intermédiaire au cœur d’une articulation intense, déclenchée par la circulation dans les (des) archives. Premier regard renouvelé sur une image sublimée qui porte en elle, ou avec elle, une tension émotionnelle se logeant dans cet intervalle même entre l’archive et son ombre, entre son apparition et sa disparition. Car au sein de cette rupture, celle d’une ombre asynchrone comme tu le dis si bien, similaire à celle d’un vampire, se loge un accès vers un « autre monde », celui des images qui entrent en archive dès leur naissance, et qui subissent « des cycles de résurrections » à chaque apparition, pénétrant indubitablement « le monde des morts-vivants » (suivant les mots de ce monteur que cite Carine Doumit dans son texte « Vers le rouge, ou La rétraction de l’univers selon Jeanne Dielman »).
L’image d’archive n’aurait-elle pas cette force d’attraction des vampires, nous attirant vers les images d’un passé violent qui, par une même impulsion, forcent le regard à s’absenter ? Me revient le film The Addiction (1995) d’Abel Ferrara sur la vampirisation qui s’opère par la découverte des traumatismes de l’histoire. Cette addiction au sang dont se nourrissent les vampires serait-elle aussi métaphoriquement celle qui nous attire vers des images, belles et douloureuses, qui coexisteraient dans un même monde ?


The Addiction (Abel Ferrara, 1995)
Tout comme cet « autre monde » dans lequel s’introduit Carine Doumit lorsqu’elle se rend à l’Arsenal (Institut für Film und Videokunst), qui abritait « il y a encore une dizaine d’années (…), un crématoire ». Ce lieu de préservation des archives lui permet de poser le regard sur une copie rouge du film de Chantal Akerman, Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles, en fin de vie, manipulée délicatement par Nathalie, archiviste qui a pris pour habitude de toucher ces corps en décrépitude. Cette rencontre est d’autant plus émouvante qu’elle place « le monde de Jeanne » entre « un temps d’avant le Big Bang et la formation des planètes », et celui d’un hypothétique « Big Bang à l’envers ». « La rétraction de l’univers » s’opèrerait même par le sceau noir à la fin de la pellicule rouge : « Ne vois-tu pas que ce cercle noir sur la dernière image du film (…) pourrait justement être cet épicentre, ce point qui va avaler le monde, et que par ce mouvement même, il contiendrait le monde ? Il me semble que Jeanne sera très bientôt aspirée ».

Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles (Chantal Akerman, 1975)
La rupture entre l’image et son ombre me fait aussi penser à une faille, que l’on retrouve cette fois-ci sur le corps même de l’archive, comme ces rayures ou autres scories que mentionne Rania Stephan dans « L’étoffe des songes », qui sont pour elle « matière[s] à narration », notamment dans Les trois disparitions de Soad Hosni, un film par lequel « une actrice morte se souvient de sa vie et de son parcours » ; ou ce glitch que Nasri Sayegh recherche, sélectionne, tente d’agrandir, de déplacer, par ce jeu d’accords et de désaccords d’une multitude d’images et de danses, « fragments pour une mélancolie arabe » qu’il collectionne compulsivement (« Le Cantique des Quantiques et/ou l’inverse, c’est selon »). La faille apparaît aussi comme « une cicatrice dansant sur le corps » d’une copie du film Les Chroniques d’Anna Magdalena Bach de Jean-Marie Straub et Danielle Huillet, que Carine suit hypnotiquement du regard.

Les trois disparitions de Soad Hosni (Rania Stephan, 2011)

Les Chroniques d’Anna Magdalena Bach (Jean-Marie Straub et Danielle Huillet, 1968)
Dans cette pérégrination sans fin que nous offrent ces textes se composant à mesure que l’on écrit ces lignes, je ne peux oublier de mentionner l’émotion qui surgit à chaque découverte d’une image ou d’un mot qui entrouvrent une dimension nouvelle, révélant aussi cet amour infini pour les images de cinéma. Celles-ci semblent rejoindre les étoiles, et même composer l’univers, comme le dit si joliment Nasri :
rana adhikari
professeur de physique
quantique
à caltech
avance que l’univers est composé
de petites unités décrites comme un pixel de l’espace-temps
l’univers serait donc composé de pixels
le visage de nour el hoda aussi
le visage de
jeannette
ma grand-mère maternelle aussi


Ghada,
À Beyrouth, le 5 février 2022
*
Chère Ghada,
Je crois de plus en plus que les choses finissent par se faire d’une certaine manière pour des raisons qui semblent pendant longtemps accidentelles, mais qui prennent sens lorsque la convergence de certains événements a lieu. Je ne prêtais pas beaucoup d’attention à l’ordre de réception des textes de ce dossier ni au montage qui s’opérait dans le va-et-vient d’un texte à un autre durant les multiples relectures. Cela dépendait du rythme de chaque auteur·rice et de nos disponibilités pour les relire et les commenter.
Je me rends compte, en m’apprêtant à t’écrire, qu’il y a tout un champ lexical lié à l’infrastructure de préservation du patrimoine cinématographique et du pouvoir qu’elle impose qui a commencé à se démarquer durant les derniers jours de travail sur le dossier. Alors que cette constellation a toujours été là dans certains textes, je l’avais invisibilisée au profit de la poursuite d’une émotion plus… comment dire ? poétique, peut-être… J’ai commencé à repérer ces mots apparus au fil des multiples textes, à la suite de la lecture de l’échange entre Léa Morin et Annabelle Aventurin, puis en travaillant sur le dialogue avec Rami el Sabbagh : effacement, absence, invisibilité, censure, omission, autorité, domination, colonialisme, nationalisme, militant·e·s, appropriation, réappropriation, reconstitution, restitution, rapatriement, agence… Je pense à ce qu’a formulé Walter Benjamin à propos des moments de l’histoire qui ne prennent sens — et un sens nouveau à chaque fois — que lorsqu’ils se rencontrent dans un éclair avec des moments du présent ; ce qu’il nomme le maintenant. Les auteur·rice·s parlent d’amour — cet amour infini pour les images de cinéma comme tu le formules, de fascination et de souvenir, mais aussi de pouvoir, d’oubli et d’effacement. Je crois donc que le dossier offrira des points d’entrées très différents selon l’ordre dans lequel le ou la lecteur·rice choisira de lire les textes.
Au fait, mon premier rapport au monde des archives filmiques a été celui d’un éblouissement. Une fascination envers cet objet mort-vivant qui nous arrive d’un autre temps et d’un autre monde. Ce n’est qu’après coup, que j’ai commencé à repérer l’infrastructure complexe dissimulée derrière l’attrait que présente l’archive. Je repense donc à la phrase de Rania Stephan que j’ai citée dans ma dernière lettre : « L’archive ne nous arrive jamais seule », n’évoquerait pas seulement ce qui accompagne l’image d’archive, mais aussi les mécanismes par lesquels cette image nous parvient.
Qui nous a donné accès à cette image ? Et pourquoi ?
L’on regarde des images d’archive parce que quelqu’un nous a permis de le faire. Quelqu’un doit toujours nous ouvrir une porte — qu’elle soit celle d’une archive barricadée ou d’un cinéma délaissé. Il y a certaines images d’archives qui arrivent vers nous, et d’autres qu’on doit aller chercher. Dans ce cas, il faut défoncer la porte.

De quelques événements sans signification (Mostafa Derkaoui, 1974)
Qui détient les clés ?
Certains pensent posséder l’archive, d’autres se disent dépositaires. Savais-tu, Ghada, qu’on peut détenir des droits d’indexation d’une image, sans posséder les droits pour cette même image ? Je l’ai découvert récemment, et j’ai eu le vertige face à ces répugnantes micro-dissections des droits. L’archive est, en fin de compte, elle aussi une commodité ; et sa préservation et sa restauration, un marché lucratif. Posséder l’archive ou la garder, dans les deux cas, c’est la traiter comme bien.
Ces jours-ci, on parle de réappropriation. On réclame : « Ces images sont les nôtres, rendez-les-nous ! » À cela, Rami el Sabbagh répond : « Je ne pense pas à ces images comme à des biens que je reprends ou que je donne. […] Mon regard sur l’appropriation et la réappropriation est très littéral, et je n’aime pas utiliser ces expressions parce qu’elles ont tendance à sous-entendre que les images, la culture et l’art sont des biens qui nous ont été volés. Alors que c’est la violence des colonisateurs qui en a fait des biens qu’ils peuvent prendre et donner. Je veux libérer l’archive de l’idée qu’elle est un bien ».
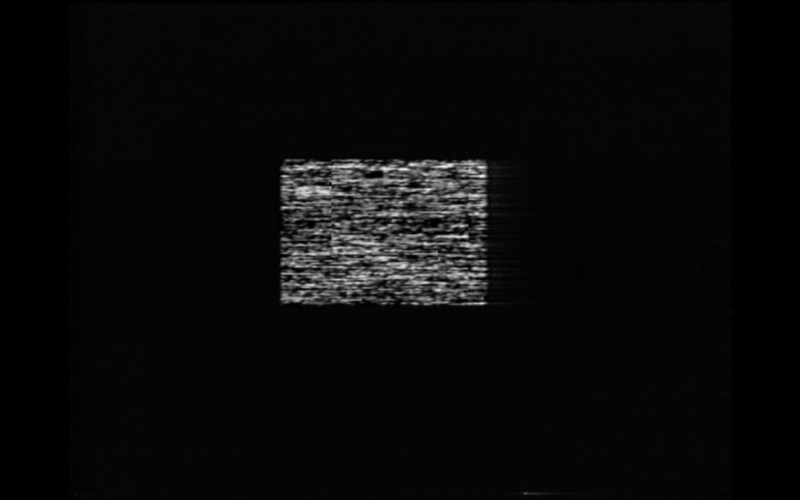
Tribu (Rania Stephan, 1993)
C’est dans cette optique que j’ai toujours aimé le piratage. Les bootlegs de VHS, les rips de DVD et les fichiers torrents, un réseau illégal qui a longtemps donné accès là où il n’y en avait pas, et surtout, sans demander la permission à qui que ce soit. Cette archive infinie de torrents qui migre constamment d’adresse pour fuir les poursuites judiciaires, cette archive qui est partagée par des millions de serveurs reliant autant d’ordinateurs que de spectateurs serait-elle cet espace de liberté dont rêve Mohamed Soueid ? Il nous écrit dans sa lettre, publiée dans ce dossier : « mon plus grand souhait est que nous laissions nos souvenirs flotter dans l’espace, sans leur imposer de frontières, sans les classer dans les archives. Imagine comme il serait merveilleux et poétique de laisser nos souvenirs se mouvoir librement dans l’air, par-dessus les “nuages” (clouds) ».

Topologie d’une absence (Rami el Sabbagh et Sharif Sehanoui, 2021)
Souvent, la sidération qui a lieu devant une image d’archive vient du fait qu’on la découvre pour la première fois. Image d’un passé lointain qu’on n’a jamais vécu, ou d’un lieu qu’on n’a jamais vu, son attraction se crée par sa rareté et son exclusivité. Souvent aussi, la découverte d’une archive est aussi la découverte d’une absence. Cette absence est due parfois à une négligence, mais surtout à un effacement délibéré et systématique. Pour Léa Morin, « il s’agit d’explorer et d’enquêter sur leur disparition [les films, les archives], comme point d’entrée d’une réflexion sur l’historiographie du cinéma. Et tenter de les reconstituer par l’absence ». Circuler dans les archives serait donc une manière de naviguer dans ces trous qui apparaissent dans les séquences d’images, qui elles, documentent nos histoires (privées ou communes).
Nour
À Beyrouth, le 28 février 2022
*
Chère Nour,
Il me plait à penser que la circulation dans les archives serait similaire à celle que permet la lecture des textes de ce dossier, offrant une infinité de montages possibles, entre images, mots, et temporalités. Je crois que l’on circule dans les archives comme on circule dans une mémoire, constituée par ces trous de mémoire, ces absences que tu mentionnes, et qui enclenchent ces pérégrinations. Après tout, la trace du passé qu’est l’archive, ne serait-elle pas, comme le dit Jacques Derrida, « l’objet-même de la disparition » ? Elle se révèle alors par cet éclair entre apparition et disparition, que l’on saisit à un instant donné, rencontre éphémère entre passé et présent, et qui se renouvelle, indéfiniment. L’on navigue ainsi en ces trous dans les séquences de nos souvenirs vécus ou rêvés, comme un imaginaire qui se compose et se recompose. « La mémoire, comme le rêve, se construit et se reconstruit par répétitions, transformations, substitutions, hésitations, lapsus, manques et oublis. Elle fonctionne aussi par associations et résonances », comme l’écrit Rania Stephan dans « L’étoffe des songes », ce qui me fait penser aux multiples échos que l’on perçoit d’une archive à une autre, d’un texte à un autre.

Un jour sans lendemain (Mohamed Soueid, 2020)

Memories for a Private Eye (Rania Stephan, 2015)
Ainsi, le vertige ressenti à l’apparition de l’œil de Soad Hosni dans l’incrusté du plan la plaçant à côté de Camille/Mirna, figure de l’actrice et de la femme adulée dans Un jour sans lendemain de Mohamed Soueid, qui scintille à la rencontre de l’œil gauche de Nour el Hoda, ou de celui de la grand-mère maternelle de Nasri Sayegh qu’il révèle en ses pixels ; et résonne encore avec un autre incrusté de Soad Hosni, cette fois-ci à la place du portrait de Laura du film d’Otto Preminger, cette autre femme qui sort de l’image, et qui revient d’entre les morts, dans la séquence que réemploi Rania Stephan en son Memories for a Private Eye. L’émotion poétique que tu recherches, Nour, se loge aussi en ces rencontres insoupçonnées, aux coins et recoins de gestes multiples perçus en ces films, ces archives et ces textes, et même dans un champ lexical plus institutionnel que tu as pu repérer. Après tout, Rami El Sabbagh souhaite « libérer les archives », alors que Léa Morin reconstitue l’historiographie d’un cinéma invisible « par l’absence ». Je crois que ces gestes politiques sont aussi poésie.
Si on se devait de conclure, Nour, toi et moi, cette correspondance qui a accompagné tant d’affects et d’idées généreusement offertes par les auteur·rice·s et les artistes qui signent les textes de ce dossier, je pense à une phrase que répète inlassablement Soad Hosni en ses Trois disparitions… : « L’imagination est plus belle que la réalité ». J’aimerais que l’écho de cette confusion permanente entre rêve et réalité retentisse encore et encore dans nos têtes et nos cœurs, afin que l’on puisse, plus aisément, se réconcilier avec notre passé.
Ghada
À Beyrouth, le 2 mars 2022
*
