Sur le cinéma artisanal

Alain Cavalier, Ce répondeur ne prend pas de messages (1979)
Le soleil vous plombe au passage. Il fait une nappe scintillante dans le sable où je suis comme le prisonnier des ombres dont il est également le créateur. J’attends midi. Je suis dans un parc nommé en l’honneur d’une Sainte. Elle vécut dans la chasteté toute sa vie et pour apaiser la jalousie de son mari dut; marcher pieds nus sur des charbons ardents. Pour un centre d’artistes, j’ai préparé une communication sur le cinéma dit « alternatif » ou «artisanal». En préparer le propos et les sujets est une chose, mais il faut aussi se préparer à la livrer, à la dire, à la mettre en mot. Lorsque je quitterai le parc de la Sainte-Cunégonde, à côté du Café Dépôt, un de mes repères favoris, ce sera parce que je serai prêt à la livrer. Mon mandat, lors de cet atelier théorique qui débutera dans quelques heures, est de faire découvrir aux participants les différentes facettes de la narrativité alternative à travers des extraits de films, des citations et peut-être, si le temps nous le permet, des exercices de création.
Les extraits que j’ai préparés et rassemblés sur un même disque sont les suivants :
Anatomie d’un rapport de Luc Moullet
Haewon et les hommes de Hong Sang-soo
Mon amie Pierrette de Jean-Pierre Lefebvre
Honeymooners de Jackie Gleason
Ce répondeur ne prend pas les messages de Alain Cavalier
Le paradis de Alain Cavalier
Hamlet de Aki Kaurismaki
Blanche-Neige de Joao César Monteiro
La femme du Gange de Marguerite Duras
Si le temps me l’accorde, afin d’évoquer les avantages et les désavantages d’un tournage en studio, je pensais également présenter le début de Sissy-Boy Slap-Party de Guy Maddin et quelques scènes de Thérèse de Alain Cavalier dont l’épuration et le repli vers le studio sont annoncés par la finale étonnante de Ce répondeur ne prend pas les messages qui met en scène le fondu au noir le plus artisanal et le plus fulgurant de mon histoire du cinéma. La réflexion visuelle de Cavalier sur l’espace et la parole atteint son point de perfection dans Le paradis, que je présenterais avant ou ensuite ; un film dont la dimension épique des deux œuvres qu’il adopte, La Bible et L’Odyssée d’Homère, est communiquée à l’aide d’objets, de fruits ou de plantes, par le pouvoir évocateur d’une parole douce et spontanée.

Alain Cavalier, Thérèse (1986)

Alain Cavalier, Thérèse (1986) et Le paradis (2014)
Le paradis me permettrait de rebondir sur le traitement artisanal de sujets « épiques » comme c’est le cas dans le Blanche-Neige de Monteiro ou le Hamlet de Kaurismaki. Parce que c’est un de mes films préférés, j’aurais aussi aimé y inclure Robin and Marian de Richard Lester, mais bien qu’il présente de nombreuses scènes tournées en décor naturel avec une économie de moyen rafraichissante (pour un film de cette envergure) et qu’il dépeint un Robin des Bois bien moins héroïque que celui dont l’histoire du cinéma nous a habitués, je me suis abstenu, craignant de passer pour un illuminé en raison du considérable budget et des formidables vedettes.

Aki Kaurismäki, Hamlet Goes Business (1987)

Richard Lester, Robin and Marian (1976)
Dans tous les cas, avant de me lancer dans les extraits, j’ai décidé de commencer l’atelier en me présentant, espérant ainsi établir un lien de confiance fort entre les participants et moi. Je m’appelle Olivier Godin. Je fais, pour l’instant, un cinéma artisanal. Mon film préféré est un film de Ozu, parfois de Hong Sang-soo, parfois de Luc Moullet ; rarement, mais ça m’arrive encore, un film de Cassavetes ou de Keaton. Mon dernier film, je l’ai terminé le 7 mai 2015 et il s’intitule Les brigands de l’hôtel bleu et je l’imagine comme un hommage romantique au cinéma de Wakamatsu et un éloge des seins de la femme.

Luc Moullet, Anatomie d’un rapport (1976)

Hong Sang-soo, Haewon et les hommes (2015)
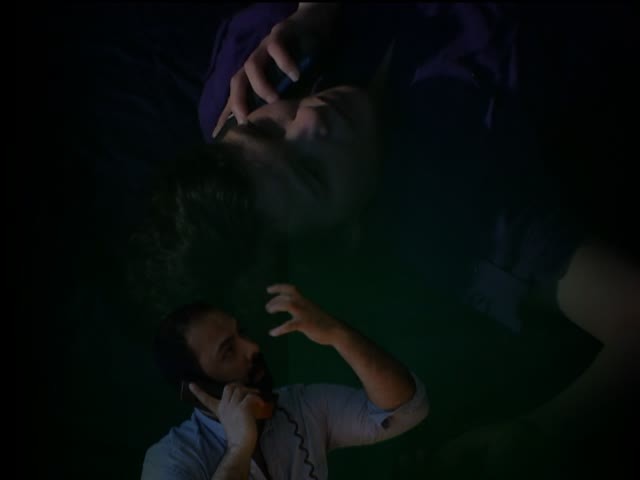
Olivier Godin, Les brigands de l’hôtel bleu (2015)
Après ma présentation, je poserai aux participants la question suivante : qui est et comment devenir un cinéaste artisanal ? Il faut, tout d’abord, ne pas avoir d’argent ou en avoir très peu. Cela me permettra, comme Rivette l’écrit à propos de Preminger, de faire l’éloge de la pauvreté 1 : «N’aurait-elle pour bienfait qu’obliger pour la masquer à l’ingéniosité et stimuler ainsi l’invention ?» De cette pauvreté qui réduit l’art à l’essentiel afin que «les éléments du cinéma jouent presque à nu», le cinéaste artisanal est forcé de repenser le système économique de production, car «les procédés économiques apportent avec eux, s’ils sont novateurs, des esthétiques nouvelles» 2 . Elles obligent effectivement à repenser le cinéma en donnant une mesure tout autre à l’espace et à la parole. Par exemple, dans mon cas, devant quelques problèmes budgétaires, grâce à une productrice ambitieuse qui était également la directrice photo et grâce à un directeur artistique débrouillard, nous arrivions à des solutions étonnantes que seule notre «pauvreté matérielle» était en moyen de provoquer ou de stimuler. Dans tous les cas, je le préciserai, le cinéma artisanal a plusieurs identités. À chaque cinéaste de lui en trouver une.
Qu’en est-il de la diffusion ? Je ne m’y aventurerai pas trop. Je dirai seulement que du point de vue des décideurs, du ministère du bon goût et des apôtres de la «production value», parce qu’il ne profite pas du financement public (un gage de qualité) et/ou de la bénédiction des festivals internationaux, deux éléments instrumentaux au rayonnement de toutes œuvres cinématographiques québécoises, il peut certainement être perçu comme une chose non artistique et sans principes, destinée à n’être visionnée qu’en festivals par des amis et des membres de la famille. Il y a dans l’air que respire les décideurs cette idée dont j’ai expérimenté les préceptes en nourrissant une amertume que, grâce au bon conseil de ma sage productrice, j’ai réprimé dans le tendre de ma chair, enfin, cette idée, inconsciente peut-être, mais certainement partagée par une presse peu curieuse, les voix des syndicats et certains programmateurs, soit qu’un cinéma « alternatif » qui entretient un rapport à l’individu avant tout, qui détourne les engrenages et la validation, un mal nécessaire (comme la police) diront certains, du financement public, et décidément, que ce cinéma « alternatif » qui se fabrique forcément de manière égoïste afin de satisfaire un désir de cinéma dédaignable, ce cinéma qui affiche ouvertement un goût pour un art brouillon, finalement, ce cinéma, puisqu’il évite la manière traditionnelle et qu’il est donc sans manières, ne mérite peut-être pas que l’on contribue à son épanouissement, car le contraire signifierait de remettre en question son rôle dans un système qui a prouvé sa valeur 3 .
Je rassurerai ensuite les participants : mon désir de cinéma est intact. Je suis un romantique avant d’être un cynique. Le cinéma est mon élixir ; une lutte qui est belle. Et les décideurs ont en effet des munitions à leur porter. Un film artisanal n’est pas meilleur qu’un autre. Je leur prouverai que je sais voir l’autre côté de la médaille en orientant les participants vers des identités du cinéma artisanal beaucoup plus répandu. Il est bien de prendre le temps d’y réfléchir, ici, entre ami et complices. En se promenant un peu à travers les festivals de la province, le cinéphile et le curieux, mon ami René par exemple, constate vite les limites d’un cinéma « artisanal ». Il observe un potentiel cinématographique, mais le déclare fragilisé par son besoin de calquer le réel, l’inscrire dans un rapport à une parole qui cherche un effet de « naturel ». René jette enfin le blâme sur l’héritage du cinéma direct qui invitait les cinéastes à prendre du côté du reportage une technique beaucoup moins onéreuse. À une autre époque, Comolli, le critique et le cinéaste, devant l’envahissement de la grammaire du direct, parle justement de techniques qui contraignent à un certain domaine formel. Aujourd’hui, la légèreté et l’indépendance que permettent les nouvelles technologies tendent à stimuler, c’est du moins une certaine tendance, un réel et une mécanique qui rappellent la captation et enfin une forme qui renvoie un peu à cet héritage. C’est un débat déjà vieux. J’y reviendrai rapidement. Je vais alors citer Comolli, parce qu’il est meilleur que moi et encore très pertinent. Je prendrai une voix douce et délicate, comme celle de Comolli , d’ailleurs, pour dire aux participants : «Tout un jeu d’échanges, de renversements, d’inversions s’instaure ainsi dans le cinéma direct entre ce qu’on peut nommer l’effet de réalité (impression du vécu, du vrai, etc.) et l’effet de fiction (sensible par exemple au niveau de la remarque courante : « trop beau pour être vrai », etc.).»
Évidemment, une telle approche peut également produire des perles.

Jean Pierre Lefebvre, Mon amie Pierrette (1969)
Je pourrai ensuite, afin d’engager la discussion, présenter l’extrait de Mon amie Pierrette que j’ai soigneusement compilé.
Est-ce que Comolli a raison ? Est-ce que c’est encore vrai aujourd’hui ? Bien sûr ! Cette recherche d’équilibre, par delà le cinéma de genre, est ce qui donne sa légitimité à un pan majeur de notre cinématographie.
Dans ma pratique personnelle, comme je n’ai pas cherché à tout prix ce point médian, je me permettrai alors une nuance. Je pourrais également dire, en guise d’avertissement, comme on me l’a déjà dit et de manière péjorative (car j’ai eu l’arrogance d’exiger cette précision), qu’un cinéma, celui vers lequel le mien semble tendre, « trop articulé pour être vrai » est un cinéma dans lequel aucun spectateur ne se reconnaîtra. C’est à ce moment que je me choquerai un peu, car avancer un argument de manière passionnelle est une façon sûre, du moins dans le monde des idées qui est le nôtre, de le servir et de le valider. Je dirai donc : Cinéastes artisanaux ! Il faut se tenir loin de ce cinéma du présent et de son énergie vitale, ce cinéma animé par la fièvre de sa démocratisation et par le pouvoir d’une fougueuse immédiateté, ce cinéma de la facilité qui pense que fleuriront dans les gestes mous et les silences durs — ces choses qui créent de la tension et qui se captent aisément — les enjeux et les thèmes qui animent le réel d’un scénario.
Les enjeux d’un scénario, pour beaucoup, il est trop peu cinématographique de les présenter grâce à des personnages qui les articuleraient tout simplement, un en face de l’autre, en buvant un cidre non alcoolisé au Café Dépot du coin. Le concours de l’efficacité, chose moderne, a industrialisé le geste et la parole. Il suffit d’assister à un cours de scénarisation à l’UQAM où des formules comme « efficacité narrative », « intensité des dialogues » et « arc dramatique renforce ́» font état de dogme. La douceur ou la tendresse, malgré Jacques Leduc et Éric Rohmer, passent encore peut-être mal pour cinématographiques. Qu’en penseront les participants ?
Après avoir cité Comolli (chose risquée), afin de me rendre plus accessible et moins pédant auprès des participants et dans l’espoir d’illustrer la dynamique entre le compromis et la contrainte, dynamique qui exalte tout art artisanal, je déclarerai mon amour des sitcoms américains. Cela allègera l’atmosphère, je n’en ai aucun doute. Dans mes notes que je consulte dans le parc de la Sainte-Cunégonde, j’avais noté la phrase suivante : « Dans une culture qui carbure à la citation, est-ce que s’enseigne un art cinématographique qui ne ferait pas de la citation un enjeu créatif ? »
Je pourrai alors dire aux participants que le sitcom a au moins la modestie ou la pauvreté (riche néanmoins) de n’avoir aucun contemporain à citer, ce qui serait la pire ou la meilleure façon d’être pertinent. Tout dépend du scénariste ou du créateur qui, en télévision, on le sait, est le véritable auteur, parfois, oui, un auteur majeur (pensons à Dennis Potter, David Simon, Larry David ou Victor-Lévy Beaulieu).
Cela est par ailleurs savamment illustré dans le sitcom policier Brooklyn Nine-Nine (voilà une référence qui pardonne ma pédanterie). Dans un des premiers épisodes, le sergent Jeffords, la brute du département, qui est tendrement interprété par Terry Crews, cite parmi ses films préférés À bout de souffle de « Truffaut ». Tout comme moi, vous souriez et sourcillez d’étonnement en notant et en pardonnant aussitôt l’erreur. Autrement, la remarque passe inaperçue. Aucun des collègues ne rappelle le sergent Jeffords à l’ordre (à cet égard, il faut également pardonner l’ignorance des collègues du sergent Jeffords, d’autres brutes, moins tendres que lui, qui n’ont probablement aucune idée des existences de Godard ou de Truffaut ou encore moins d’une certaine politique des auteurs). Il faut attendre encore quelques épisodes, en pleine soirée mondaine, pour que cette remarque qu’on devine alors répétée par le sergent Jeffords trouve enfin quelqu’un pour la contester, en l’occurrence un homme rigoureux aux tempes grisonnantes. À la surprise de tous et d’une manière métaphorique qui illustre bien la politique des auteurs de télévision, le sergent Jeffords soutient et défend l’idée qu’À bout de souffle est une œuvre de Truffaut avant d’en être une de Godard, car Truffaut est celui qui en a eu l’idée. Autrement dit, pour ce sergent Jeffords, brute musculeuse au cœur tendre, l’enrobage importe peu. Ce qui compte, c’est que la forme est au service de l’idée et du fond. La forme n’est que la mécanique du sens. Godard au service de Truffaut. Selon le sergent.
Le même principe anime la plupart des sitcoms où la contrainte, surtout les plus «pauvres» des sitcoms, agit véritablement comme un enrobage simplet, mais aussi comme un moteur créatif. C’est là, excusez donc la digression précédente, que je voulais en venir. Malgré le fait de sa banalité qui lui donne un certain éclat, la forme du sitcom, dans son rapport à la fiction, est victime de certaines contraintes, mais le contenu, d’un point de vue narratif et artisanal, en est à mon avis très avantagé. Je présenterai alors un extrait d’un épisode de Honeymooners de Jackie Gleason.
En affichant sans crainte mon amour du sitcom, qui pour certains esprits distingués a plus d’affinité avec la vase du Saint-Laurent qu’avec toute œuvre artistique, je me suis accordé la bénédiction des humbles. En poursuivant la réflexion qui oppose fond et forme, contrainte et compromis, je pourrai alors, sans risquer aucune taxe, sortir la Bible du cinéaste et la citer très lentement, d’une voix neutre, sans affect, comme il se doit :
« La faculté de bien me servir de mes moyens diminue lorsque leur nombre augmente 4 . »
Je renchéris, j’ose :
«Un petit sujet peut donner prétexte à des combinaisons multiples et profondes. Évite les sujets trop vastes ou trop lointains où rien ne t’avertit quand tu t’égares. Ou bien n’en prends que ce qui pourrait être mêlé à ta vie et relève de ton expérience 5 .»
Afin de stimuler la recherche d’un petit sujet, je vais diriger le participant en panne d’inspiration vers les 36 situations de Georges Polti selon lequel il n’existe que 36 situations dramatiques pour tout scénario et desquelles découlent de nombreuses variations 6 . Je soulignerai que ces situations s’appliquent autant à une approche artisanale qu’à une approche plus commerciale ou grand public. En guise de contre-exemple, je présenterai ensuite les extraits de Anatomie d’un rapport de Luc Moullet et de Haewon et les hommes de Hong Sang-soo dans lesquels le principe de rencontre suffit à dynamiser toute une portion du récit. Et ce sera là mon tremplin vers l’exercice pratique : élaboration d’un petit sujet dramatique ; description de personnages et des intentions formels, etc.
Si le cinéaste ne cite, visuellement et formellement bien entendu, aucun cinéaste actif, c’est-à-dire qu’il ne tente pas de s’inscrire dans une certaine tendance, et s’il ne travaille pas dans les confins d’un genre et de ses embranchements, est-ce que son œuvre est plus susceptible d’être marginalisée, mûre pour les festivals « expérimentaux », pour les festivals qui présentent des œuvres dites « fauchées » ou « tournées à tout prix » ou pour des présentations muséales qui s’accompagnent généralement de petites fiches instructives ? Je vais alors rassurer les participants : je ne saurais moi non plus répondre à cette question. J’aurai pensé à voix haute.
En passant par Duras et la force hypnotique du cinéma qui se mesure par la musique et la voix, je terminerai dans la sérénité. Je ne jetterai aucun regard nerveux à ma montre, puisque je n’en porterai pas, et je dirai qu’il n’y a pas de culture supérieure, que le cinéma artisanal n’est pas plus pur que le cinéma commercial et, comme le dit si bien Jean- Claude Biette, que «ce n’est pas avec des éléments purs qu’on fait une oeuvre vivante 7 .» Considérant toute création artistique, la sienne comme celle du voisin, il faut exercer sa capacité à mettre sur une même égalité le cinéma commercial et le cinéma artisanal; admettre que l’un se définit grâce à l’autre et non contre l’autre. En créant, il ne faut jamais tomber dans une logique de discrimination économique. Je dirai. Laissons cela aux décideurs et puisque leur bénédiction nous est un luxe, contentons- nous de créer.

Marguerite Duras, La femme du Gange (1974)
Je termine mon café dans le parc de la Sainte dont le nom est élevé vers le Ciel afin de continuer, par delà son éternité, à nous fournir, humbles mortels, des directions et des conseils. Au moment de la dernière gorgée, je reçois un message qui me laisse savoir que la communication que je dois donner dans quelques heures est finalement annulée.
Ce qui m’a mérité l’invitation à diriger cet atelier et ce qui est franchement heureux de mon aventure cinématographique, c’est que la seule façon que j’ai «trouvé» d’être pertinent, en terme de cinéaste, est finalement de ne surtout pas l’être, du moins, pour la majorité. Ce qui explique peut-être pourquoi la communication que je devais donner aujourd’hui sur le cinéma artisanal a été annulée. Une seule personne s’y était inscrite.
C’est à cette seule personne, que je remercie ici, que je dédis ce texte.
ndr : Le long-métrage d’Olivier Godin, Nouvelles, nouvelles, sortira en salle à Montréal le 14 août 2015.
Notes
- Jacques Rivette, « L’essentiel », Cahiers du cinéma, no. 32, février 1954. ↩
- « Entretien avec Luc Moullet, Cahiers du cinéma, no. 216, octobre 1968. ↩
- Maintenant, dans la mesure où j’épargnerai aux participants les exemples personnels qui la justifieraient, je demanderai pardon pour cette logorrhée fastidieuse. ↩
- Robert Bresson, Notes sur le cinématographe. ↩
- Robert Bresson, Notes sur le cinématographe. ↩
- 6 Georges Polti, Les 36 situations dramatiques, Éditions d’aujourd’hui, 1980. ↩
- 7 Jean-Claude Biette, « Sur Le théâtre des matières », Cahiers du cinéma, no. 277, juin 1977. ↩
