Sur quelques films de Lav Diaz

From What is Before (2014)
J’ai beaucoup pensé à Lav Diaz cet été, sans doute pour avoir passé beaucoup de temps en sa compagnie, au mois de mai et juin. J’ai en effet retranscrit et traduit le long entretien publié dans ces pages (exercice laborieux, monastique, presque d’un autre temps, d’un autre rythme), après mettre plongé dans quelques-uns de ses films au Cinéma moderne et à la Cinémathèque, puis aussi, par petites bouffées, sur mon portable (expérience détestable). Pour chacun des films vus durant le petit cycle à Montréal, j’ai réalisé que j’avais cumulé une bonne dizaine de petites pages griffonnées dans un cahier, ainsi que des kilomètres de réflexions qui s’étirent jusque dans ces rêves qui viennent forcément cohabiter avec les films, avant, pendant, après le visionnement. Et je trimballe ainsi – comme cette « malle dans la tête » qui encombre, dont parle Proust — des liasses d’idées qu’il aurait fallu parvenir à colliger et organiser en un grand texte synthétique, qui se serait déplié en une vaste fresque composée et articulée, comme le sont chacun de ses films-monde. Plutôt, c’est quelque chose d’assez épars, de personnel, de trivial souvent, variant les focales et les échelles, les durées et l’esprit, qui s’est imposé. Quelques notes, encore.

From What is Before (2014)
Peut-être que le seul vrai texte à écrire sur les films de Lav Diaz — à noter que le caractère péremptoire de ce genre d’énoncé ne cherche qu’à en rendre la proposition par avance irréalisable — en serait un qui parviendrait à reconstituer ce qui se déroule dans la tête et le corps (les deux) de celle ou celui qui est pris, enveloppé, embarqué, engagé — c’est bien de tout cela qu’il est question — dans un de ses films. Un texte qui en retracerait l’intériorité, qui saurait saisir la succession d’éclats ou d’éblouissements que les films génèrent, mais aussi les plages de lassitude, d’ennui, de doutes, de sommeil, d’étrangeté ; qui saurait par exemple parler de ce calcul que tout spectateur des films de Diaz négocie avec lui-même et le film afin d’économiser son temps d’attention, de faire des réserves d’énergie en évaluant la possibilité qu’une action décisive puisse se jouer dans tel ou tel plan, et d’ainsi se permettre de fermer les yeux quelques instants, de reposer son cortex, quitte à prolonger sur l’écran de ses paupières, les yeux fermés, la trajectoire de telle silhouette dans le paysage dévasté, de telle prostration, de telle attente, puis de retrouver le plan, ses figures, sa scène, précisément là où on croyait les retrouver, mais avec ce petit bénéfice d’avoir repris des forces pour la suite, de s’être reposé la rétine, mieux, d’en avoir imprimé le dessin au fond de soi, de l’avoir ressaisi par l’imagination, même si c’est en s’absentant momentanément au film qui continue, sans nous, à quelques mètres de notre corps, suspendu.

La femme qui est partie (2016)
À mi-chemin de la projection de Norte, je me suis rappelé cette séance du Festival du nouveau cinéma où était projeté La femme qui est partie (2016), deux ans auparavant (en ne cessant de m’étonner de la capacité du cinéma à éveiller d’autres expériences de cinéma qu’on avait jusque-là oubliées ou considérées comme superfétatoires). Dernière projection du festival, un dimanche du mois d’octobre, à 16h. Le film venait de triompher à Venise et on doutait alors de la chance de pouvoir le revoir un jour sur un écran (la salle était bien pleine). Le film démarre sur son somptueux et modeste noir et blanc. Des corps qui se déplacent dans les cadres, des femmes qui parlent, qui racontent. Elles sont en prison. Bientôt, l’une d’entre elles est libérée (je n’ai pas revu le film, il me manque des milliers de détails). Mais toujours est-il que, rapidement, sans doute au bout de dix minutes de projection, les spectateurs ont commencé à remarquer un léger problème de synchronisation. Ô, guère plus qu’un quart de seconde, mais qui allait en s’accroissant à mesure que le film avançait (sur un film de plus de quatre heures, l’écart est devenu assez important, une question de deux ou trois secondes je suppose). La projection fut interrompue au bout d’une demi-heure pour tenter de régler le problème, mais rien n’y faisait. Les responsables du festival acceptaient de rembourser les mécontents (ils étaient nombreux). Mais nous fûmes plusieurs, la majorité il me semble, à demeurer dans la salle, estimant que, synchronisme ou pas, les chances de revoir ce film à Montréal frisaient le coefficient zéro. Nous prîmes notre mal en patience. Mais comment, en même temps, ne pas être constamment arraché au film par ce trouble ? Comment rester dans le film en ne cédant pas à la frustration de ce désemboitement du son et de l’image ? Il s’agissait au fond — ma stratégie devait valoir pour d’autres — de négocier son attention en la laissant flotter au-dessus du film. Être attentif au film, mais en obturant la part de notre conscience habituellement dévolue à accrocher naturellement les sons aux images : il fallait, par exemple, éviter de trop regarder les lèvres bouger en fixant plutôt les yeux, les fronts, les détails en bordure de l’image, de ne pas fixer son regard sur l’objet qui génère un son particulier, être dans une sorte de balayage permanent pour conférer ainsi aux sons une apparence de synchronisation. L’autre stratégie, était de créer une sorte de rétention mentale de l’image afin qu’elle s’emboite virtuellement, dans notre tête, avec le son qui allait venir (l’image qui me vient est celle de deux wagons en marche qu’il s’agit de raccrocher)1 .
Comment expliquer que ces défauts, et la sorte de petite générosité supplémentaire qu’ils exigent de la part du spectateur qui décide de passer outre, d’inventer des tours de passe-passe mentaux pour ne pas en être affecté, peuvent paradoxalement finir par jouer en faveur du film, lui faire goûter différemment son principe de composition, son cadre, ses détails ? Comme si l’acte de foi que nous faisions, soudain, se mesurait à la démesure de générosité du cinéaste et des acteurs qui ont réalisé ce film. Que tout cela, au fond, fait partie du fait d’être avec le film, tout ce temps.

Death in the Land of Encantos (2007)
Dans [l’entretien->824] que Lav Diaz a accordé à Paul Grant, il est question de ces projections dont la durée, dans un certain contexte, imposent un autre régime au spectateur. Grant parlait notamment d’une projection à laquelle il avait assisté, au Myanmar, d’un film de Tsai Ming-liang, Stray Dogs, où les spectateurs « locaux » (le public international avait déserté la salle), alors qu’ils ne semblaient pas particulièrement captivés par l’histoire, sont restés jusqu’à la fin, simplement parce qu’ils se plaisaient à passer du temps avec les images qui défilaient : « they were just hanging out with the film ». Il s’agit moins de capter chaque seconde, chaque moment, d’être dans une logique d’absorption narrative complète, mais plutôt dans un rapport d’accompagnement. Nous passons du temps avec ce film, ce bloc de temps-espace qui se déroule devant nos yeux.
Nous ne nous trouvons pas, non plus, disons, devant un film de Lav Diaz, dans un régime de semi-provocation à la Warhol, où la relative, voire la totale inattention au contenu du film est consubstantielle à l’expérience de l’œuvre (que ce soit Sleep ou Empire). Nous ne nous trouvons pas non plus dans une logique à la The Clock de Marclay, où l’incapacité de tout absorber est liée à la nature même des lieux de diffusion et à la durée folle du projet (impossible de réellement demeurer éveillé et d’assister à la projection pendant 24h dans un musée, plus souvent qu’autrement ouvert à des heures normales). Non, il s’agit d’un sentiment, très particulier, qui consiste à s’installer, comme spectateur, auprès d’un film auquel on accepte de donner une partie, voire la totalité de sa journée (9h, 10h, 11h30). À cela s’ajoute cette particularité exigée par Diaz (mais pas toujours respectée, et que l’on ne retrouve pas dans les autres grands cas notoires de films longs, que ce soit Out 1, Le Tango de Satan, Hitler un film d’Allemagne, Shoah, Babel de Boris Lehman) : il n’y a pas de pauses (les films ne sont d’ailleurs, à ma connaissance, pas découpés en partie, mais se déroulent d’un trait). Le film est simplement appelé à occuper un bloc de temps dans une salle. Il s’agit d’être auprès d’eux, de faire preuve de cette délicatesse qui consiste à les laisser respirer de leur souffle propre. Le film est en marche. Se poursuit. Mène sa vie. À vous de le suivre, d’accompagner le drame qui s’y étend, de tout son long on pourrait dire.
Assister à un film de Diaz, c’est laisser cette vie parallèle se dérouler. Parfois cela veut dire lâcher le film avant la fin. Sortir prendre l’air, revenir, et au bout d’un certain temps, voir où on est rendu. Il peut arriver de se dire, comme au bout de quelques verres, c’est bon, j’en ai assez pris pour ce soir, je me trouve libre, et le film ne m’en voudra pas. Cette forme de lâcher prise participe certainement de la dimension politique de ces films qui cherchent à imposer une nouvelle économie (dans tous les sens du terme) du (temps du) spectateur2 . Comme si le film et ses personnages nous disait sans arrêt, suivant la prescription paulinienne reprise par Godard : « ne t’en fais pas, nous sommes tous encore ici. »

Norte la fin de l’histoire (2013)

From What is Before (2014)
La durée particulière des films de Diaz permet des expériences de cinéma singulières, comme par exemple de faire éprouver, physiquement, psychologiquement, sur la longueur, un rythme quotidien où il ne se passe rien sinon le fil du temps (non pas dans un plan, mais dans une séquence de plus ou moins 40 minutes ou une heure). L’exemple qui me vient provient de Norte. Après une série de péripéties tragiques (le mari est en prison, Fabian, le tueur, est terré, la femme reprend sa vie en main, avec ses enfants et sa sœur), le film se pose. On suit, sans drame, le quotidien des personnages, de scènes en scènes. Voici leur vie, leurs rituels, leurs petites habitudes, en épinglant tel ou tel détail anodin (élément de décor, jeu de lumière, couleur des espaces). Sous nos yeux, du temps se met à passer (quelques mois, peut-être des années). Et ce, sans qu’aucun rebondissement apparent ne vienne troubler le fil des actions pendant de longues minutes. C’est le type de luxe que le cinéma de fiction peut rarement s’autoriser. De la même manière, il peut arriver au film d’oublier pendant une heure ou plus un personnage, un fil narratif qu’on avait accompagné pendant un long moment. Et c’est non sans émotion que le spectateur retrouvera avec étonnement, parfois avec bonheur, au bout d’une heure ou deux, un visage qu’il avait déjà commencé à oublier.

Norte, la fin de l’histoire (2013)
À mi-chemin de Death in the Land of Encantos — film de dévastation, mêlant fiction et documentaire, tourné dans la région du Bicol, après le passage du typhon Durian/Reming — alors que l’action semble avoir atteint une sorte de plateau dramatique, et qu’on se dit, tiens, il me semble qu’il ne reste plus rien à dire ni à faire, qu’on a fait le tour de tous les possibles de ce film — Diaz plante sa caméra sur son héros, le poète Benjamin Augustan — revenu dans la région, auprès de ses amis, sur les traces de sa famille décimée par la catastrophe et hanté par la folie de sa mère —, assis à un café, lisant un livre, prenant des notes.

Death in the Land of Encantos (2007)
Le plan a une durée exceptionnelle pour une scène où, on pourrait dire, pour une fois, rien, vraiment, pour de vrai, ne se passe. On réalise alors tout l’intérêt qu’il peut y avoir aux autres plans, parfois très longs, où une action minimale suffit à alimenter la passion du regard — un nuage qui se déplace, le frôlement du vent sur les feuilles, le son des animaux, un faciès particulier, une composition du cadre en profondeur qui permet de stratifier nos points d’accroches dans l’image, une forêt d’où émerge au bout de quelques minutes, après que le son nous l’ait fait anticipé, un gamin transportant des branches ou un fruit.

From What is Before (2014)
Là, disons-le, il ne se passe rien. Un type lit dans un café et prend des notes. Et la chose s’étire de façon indécente. Et on se dit que c’eut été un bon moment pour sortir, prendre l’air, s’étirer, chercher ce café dont on rêve depuis une petite heure. Et le luxe d’un film de 9h pour un cinéaste, c’est qu’on a le droit, si on le désire, de faire durer un tel plan cinq ou six minutes (je ne suis pas allé revérifier la durée effective du plan, mais ça ne devait pas être en bas de ça). Et c’est à ce moment, alors qu’on a commencé à se dire au fond de soi-même qu’il exagère, qu’il pousse un peu loin la posture, que le slow cinema, parfois, ça a quand même ses limites, c’est à ce moment que, soudain, dans le hors champ, un bruit de pas retentit lourdement, qu’on sent tout le corps de notre héros se figer : un type louche, baraqué, trapu, apparaît sur la gauche et vient s’asseoir à la table du héros. Il s’agit de son ancien bourreau, revenu de son passé, surgi de nulle part, qui vient gentiment s’enquérir de lui, lui rappeler qu’il est surveillé, qu’il a intérêt et ne pas faire de politique, qui lui demande comment vont ses blessures : une vraie scène de torture psychologique, totalement prenante et déstabilisante. Et c’est alors que ce film, dans lequel on était plongé depuis quelques heures déjà, qu’on croyait avoir cerné, se fissure davantage, de l’intérieur, en faisant apparaître la fêlure centrale, décisive, du personnage, qui ne cessera dès lors de s’ouvrir, jusqu’à la béance qui le consumera.

Death in the Land of Encantos (2007)
Les films de Lav Diaz sont, tout comme les films de Tarkovski, Tarr, Costa, Straub, Panh, K. Kurosawa, Weerasethakul, et j’en passe, des films qu’on pourrait dire hantés. Il lui suffit en effet de planter sa caméra devant un paysage pour sentir aussitôt, dans la doublure du plan, mille douleurs, mille malheurs, le constat d’une sorte de malédiction, d’acharnement tragique qui semble résumer l’histoire des Philippines. À toutes les formes les plus brutales de colonialisme, de néo-colonialisme, de génocide, d’acculturation matérielle et symbolique, s’ajoutent le poids des dictatures, de la loi martiale, de l’arbitraire des inégalités sociales, auxquels il faut ajouter les catastrophes naturelles (typhon, tsunami, tornade) qui balaient périodiquement ce que la dernière reconstruction venait tant bien que mal de redresser.
Si son sujet privilégié est celui de la violence historique, de la brutalité sans nom dont ce peuple a été victime, cela se traduit dans les films par une incroyable douceur, une incroyable générosité envers les déshérités, les oubliés de l’histoire, les infâmes, une capacité émouvante à croire aux miracles. Le désespoir n’y est pas cynique, il passe par une étonnante et toute philippine forme de résignation, d’amor fati. Il est sauvé par la présence, dans chacun de ses films, de sortes de saints (ils sont aussi parfois poètes, héros nationaux). Cette sainteté côtoie aussi parfois la folie, la déraison, comme chez Dostoïevski (dont Lav Diaz se montre étonnamment proche, et qu’il n’a cessé d’adapter, dans presque chacun de ses films, sous des formes diverses, et qui est souvent mentionné dans la bouche des personnages). À côté des saints, des poètes ou des héros (le mari dans Norte, sa femme, les deux sœurs, le prêtre de From What is Before, la mère folle, le poète dans Death in the Land of Encantos, la femme de Rizal, la femme libérée de prison dans The Woman Who Left, etc.), à côté de ces personnages lumineux, complexes, que la sainteté élève (même littéralement comme dans Norte, tout comme dans Le sacrifice ou L’humanité), Diaz oppose les monstres, les fourbes, les bourreaux, les militaires, les exploitants, envers lesquels il est souvent sans pitié (comme eux le sont envers leurs victimes). Ce sont autant d’incarnations du Mal Absolu (qui appelle les majuscules) qui habitent chacun de ses films. Il est possible qu’un monstre le devienne (le personnage de Norte), ou qu’on devine sa vraie nature peu à peu (la délatrice dans From What is Before). D’autres fois, ils sont des monstres sans appel dès leur première apparition (les milices sanguinaires sur les bords des chemins, à la fin de From What is Before, le bourreau de Encantos). Parfois encore — mais c’est rare — ils ont le droit à une rédemption (on pense à la brute dans la prison de Norte, Wakwak, atteint d’une attaque soudaine, vers la fin du film et auquel notre héros, qu’il a pourtant torturé et martyrisé, offre un massage de pied, dans une scène proprement sidérante).

Norte la fin de l’histoire (2013)
Dans cette axiologie du bien et du mal, on peut s’étonner du fait que, alors qu’il a souvent à sa disposition une fin « ouverte », suspendue, mais qui ouvre sur une forme d’espoir (on pense à la fin de From What is Before ou même Death in the Land of Encantos), Diaz décide de clore son film sur un plan — souvent extrêmement violent — montrant les bourreaux à l’œuvre (brutalisant, torturant), comme s’il tenait à leur donner, malgré toute la résistance poétique dont son cinéma a été capable, le dernier mot. Est-ce une manière de s’assurer que le spectateur ressortira de la salle, non seulement hanté par toute la beauté qu’il aura vue, mais aussi par l’horreur avec laquelle on lui demande de demeurer, jusqu’au bout, irréconcilié ?

Death in the Land of Encantos (2007)
Comme chez Tarkovski, chez Kurosawa, chez Tarr, chez Weerasethakul, dans le Godard de Film Socialisme (pour prendre des exemples un peu extrêmes), il pleut beaucoup et le vent souffle, souvent au point de l’assourdissement. Cette pluie est reçue par les personnages, chez Diaz, avec la même sorte de résignation que celle de cette mère, au début de From What is Before, qui vient élever un chant de lamentation pour la mort de son fils et que des paysans l’écoutent, assis dans la boue, aussi résignés qu’elle, dégoulinants d’eau tombant entre les branches, patients. Cette pluie tombe tantôt en lourdes gouttes qui claquent comme des cailloux ou des coups de mitraillettes, tantôt en un fin rideau qui siffle et balaie en ondées, au gré du vent, la grisaille du paysage. La pluie est indifférente à tout. Comme chez Tarkovski, une maison peut brûler. La pluie va continuer.

From What is Before (2014)
Ce vent qui souffle, cette pluie qui s’abat, est une réalité documentaire (il semble en effet beaucoup venter et pleuvoir aux Philippines, tout comme il semble toujours venter et pleuvoir en Hongrie). Mais cette météorologie capricieuse est aussi le signe d’une histoire contre lequel on est en quelque sorte toujours impuissants et dont le grondement est toujours présent (que peut-on contre la pluie, le vent, l’orage ?). Dans Death In the Land of Encantos — son film sur l’après-typhon Reming — le vrombissement du vent est un constant rappel de la peur, de la mort, de la douleur qui est ensevelie sous cette boue sur laquelle désormais les personnages marchent, accablés. Dans ce vent qui vrombit — un personnage le dit à un moment, près de la mer, la nuit, éclairé à peine avec un feu qu’on nourrit tant bien que mal — on peut entendre les cris de tous ceux qui sont morts, qui sont encore ici, qui refusent d’accepter leur sort, qui réclament qu’au moins leurs voix puissent être entendues. À sa manière, chacun des films de Diaz est une tentative désespérée pour rendre les honneurs à ceux que la tempête de l’histoire a emportés, pour rien. Chaque film est un tombeau.
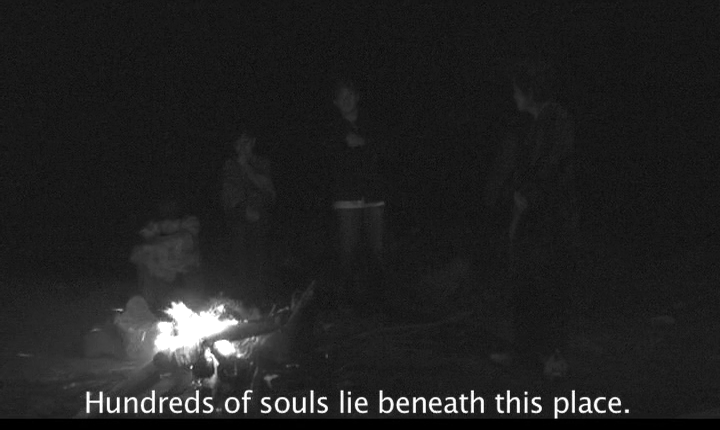
Death in the Land of Encantos (2007)
Le passé est une chose complexe chez Diaz (tout comme chez les plus grands cinéastes, Pasolini, Straub-Huillet, Godard, Duras, etc.). Le passé n’est pas tant ce qui a eu lieu, jadis, mais au contraire : ce qui ne passe pas (comme dirait Didi-Huberman), ce qui refuse de passer, ce qui ne cesse de revenir, d’être appelé par le présent qu’il taraude. Chez lui, le fascisme du présent, celui de Duarte, rencontre le fascisme de Marcos, qui rencontre la violence néo-coloniale des Espagnols, etc. Quand on dit « le fascisme ne passera pas », on peut entendre « le fascisme, c’est ce qui ne doit pas passer, ce qui doit demeurer inacceptable et intolérable », mais aussi, « c’est ce qui refuse de passer », qui ne cesse de revenir, de trouver une brulante et terrible actualité, hélas pour nous, et qui pour cette raison-même, appelle une constante vigilance. Le cinéma de Diaz n’échappe pas à ce passé-là, ces passés-là, qui hantent sans cesse. Et il ne cesse pas de tourner autour, de l’allégoriser, de la transposer, mais aussi de le dire, de sans cesse le raconter non pas afin qu’il passe, mais afin qu’il ne finisse pas de ne pas passer. Et de ce point de vue, on ne dira jamais assez l’incroyable capacité, chez Diaz, à raconter des histoires (ses films sont tous plein d’histoires), sans fin, pour se donner sans cesse le droit de continuer à raconter l’histoire de son pays, toutes les histoires qui l’habitent (en quoi son cinéma est infini, comme les Mille et une nuits, il restera toujours des choses à raconter… puisqu’il faut survivre, que raconter en dépend). Les personnages sont appelés à raconter ce qui a eu lieu, ce dont ils peuvent témoigner (et il y a à cela une justification économique, puisque ça évite de devoir tourner la scène qui est racontée). Et s’il y a un art du silence dans ce cinéma (vingt minutes sur une caravane qui se déplace en silence, en montagne), on y retrouve aussi une incroyable capacité à prendre la parole, à donner à entendre des débats, à laisser défiler des histoires. C’est en cela un film qui se donne aussi le temps de parler et donner à entendre.

Death in the Land of Encantos (2007)
S’il importe à Diaz de raconter l’histoire politique qu’a subi son peuple, et toutes les injustices dont il a été victime, il lui importe tout autant et si non plus, de chanter la diversité de ses langues (le respect des dialectes est un principe éthique de son cinéma, ça s’entend), la couleur de ses paysages, de célébrer ses croyances ancestrales, ses rituels oubliés, de plonger les racines de son cinéma aussi loin que lui permet l’imagination, pour aller y puiser une force créatrice et restauratrice (c’est peut-être ce que Pasolini appelait : « la scandaleuse force révolutionnaire du passé »). C’est disons l’aspect programmatique de son œuvre. Pour cette raison le cinéma de Diaz n’échappe pas, par endroits, au film à thèse, au mot d’auteur, au projet d’éducation populaire, qui peut parfois agacer en éclipsant le film au profit du programme du film, sa ligne idéologique (ce sont aussi des « moments théoriques » que l’on retrouve chez Pasolini). Le paradoxe est que ce sont aussi dans ces moments que tous les fils épars du film se trouvent rassemblés en un même fuseau, qu’apparaît avec le plus de netteté la cohérence interne de ce cinéma, son désir de réclamer une place pour ce passé honni, bafoué, oublié auquel il veut donner une voix.

From What is Before (2014)
Si les films sont hantés par l’histoire des catastrophes naturelles et des tragédies historiques, ils sont aussi hantés par ce temps d’avant, ce temps d’avant l’Islam, d’avant le christianisme, qui définirait une sorte d’essence des Malais. Un personnage — debout dans une rizière, dans un village déserté, condamné à une sorte de mort —, parlant de la malédiction qui les afflige, parle soudain de ce temps d’avant la séparation, de son désir de rejoindre ce passé, à nouveau, ou, mieux, de le faire revenir, et il ajoute : « in our dream », on pourrait dire, « dans un souvenir ».

From What is Before (2014)
Ce désir utopique d’un retour (impossible) à un temps d’avant, avant que le temps ne leur soit dérobé, c’est à la fois l’utopie, mais aussi la source de la mélancolie et de l’inquiétude qui irriguent tout le cinéma de Diaz, dressé sous le signe de cette mémoire : « This story is a memory of a cataclysm; it’s a memory of my country. »
Que, par les temps désespérés que nous traversons, la mémoire du cataclysme qui pèse et le souvenir d’un temps utopique qui sauve en aidant à résister, ne fut-ce qu’au désespoir, puissent partager une même scène, un même plan, un même chant, devrait suffire à nous convaincre que le cinéma de Diaz est l’un des plus importants, actuels et nécessaires qui soit.

From What is Before (2014)

From What is Before (2014)
Notes
- Une curiosité sonore analogue à celle-ci me frappa aussi durant la projection de From What is Before, comme si la version du film présenté était encore mal mixée, avec des volumes de sons très disparates, rendant le montage sonore trop apparent : un jappement de chiens, le chant d’un coq, le bruit de la pluie, des pas dans la boue, superposés les uns aux autres sans son d’ambiance. ↩
- Les exemples abondent de films où la dimension politique est directement liée à la longue durée des films : on pense aux exemples récents de La Flor, de Mariano Llinás, aux Mille et une nuits de Miguel Gomes, à Happy Hour de Ryusuke Hamaguchi, plus généralement aux films de Wang Bing, depuis À l’ouest des rails. Peut-être cela a-t-il toujours été le cas des films de Rivette, de Wiseman, à une autre époque de Stroheim ou Gance, et de façon évidemment encore plus ostentatoire et affichée chez Lanzmann ou Syberberg. ↩
