BLANCHE NEIGE, VOUS VOYEZ
(glissades et digressions entre João César Monteiro, Marguerite Duras et Guy Debord) pour un lieu noir, celui de la parole et de la mort
« Nul n’a jamais écrit ou peint, sculpté, modelé, construit, inventé, que pour sortir en fait de l’enfer. »
Antonin Artaud
« Après toutes les réponses à contretemps, et la jeunesse qui se fait vieille, la nuit retombe de bien haut. »
Guy Debord
Il faudrait pouvoir entendre parfaitement la langue portugaise pour regarder Branca de neve (Blanche-Neige) de João César Monteiro, sorti en 2001. Pourquoi ne pas regarder par intermittence le film les yeux fermés ? Et alors ? Les ouvrir seulement lorsque le cinéaste nous en donne l’ordre. Nous indique le moment juste où, par un appel sonore et musical, un leitmotiv climatique déclenché à l’endroit juste d’un ciel bleu, nous pouvons les ouvrir et voir à nouveau : « dans cette nuit opaque, je m’étais rendu ivre de lumière (…) dans le bleu du ciel de midi 1 . » La parole est le véhicule avec lequel le spectateur doit se laisser transporter tout au long du film. Ne pas avoir à lire ces sous-titres blancs, trop blancs (images déjà en trop) comme l’est la canne d’un aveugle pour nous laisser conduire là où nous nous y attendions le moins ; car l’inscription sonore du texte de Robert Walser, Blanche-Neige (écrit entre 1900 et 1902), est bien trop grande pour être enfermée dans n’importe quel cadre ou direction.
João César Monteiro est l’indispensable génie et petit dieu du voyage pour qui voudrait s’aventurer dans des contrées cinématographiques toujours à fleur de mer. Maître de l’élégance, de la vacuité, de la souplesse et de l’ironie il a trouvé le lieu et le chemin : celui d’un rectangle noir, seul envers et endroit de l’image dans lesquels puisse demeurer et s’amplifier le texte poétique de Robert Walser. Si le lieu de l’écrit est une chambre noire, l’écran noir ne serait-ce pas l’évocation la plus juste — en image — de cette espace-là ? Soit le lieu précis du surgissement du texte ; car tel que le précise Michel Chion dans La voix au cinéma à propos d’un autre film noir, celui de Duras, L’homme Atlantique : « Lorsque l’écran est noir, ce n’est pas pour autant qu’il n’y a plus de lieu ; le cadre, l’espace de la projection, même noir, demeure visible. (…) C’est ce cadre évident, cette fenêtre noire créée par la projection de la pellicule noire qui fait qu’il y a toujours un film, et c’est par rapport à ce lieu cadré, fixé, que la voix peut jouer dans la dimension de l’illimité, du sans-lieu, de la perte. Parce qu’il y a un lieu, et que ce lieu est celui du pas-tout-voir : ainsi peut-on définir le mieux, sans doute, après André Bazin, l’écran de cinéma 2 . » Dans le film de Monteiro, il y a cinq voix d’acousmêtres qui parlent sur une image noire : celles de la Reine, du jeune prince, de Blanche-neige, du chasseur et du conte… Après le fameux conte de Grimm, le texte de Robert Walser est une évocation poétique écartelée et mise en éclats car chacun des personnages raconte une version différente de l’histoire dans un entremêlement qui obscurcit le récit : la frontière entre la haine et l’amour s’amincit et se distord, l’érotisme se mélange à la mort. Le lieu du ne pas-tout-voir trouve ici une correspondance avec le lieu du ne pas-tout-entendre. La narration est trouée par chacune des interprétations a posteriori des personnages et en regard de leur expérience respective et qui pourraient être rejouées infiniment de manière différée. Un lieu lacunaire dans lequel s’est inscrit de manière instinctive pour le cinéaste cette perte essentielle de l’image autant que du langage.
Mario Barroso, le chef opérateur du film a précisé : « L’idée de départ pour Blanche-Neige était d’avoir le texte préenregistré, que les acteurs devaient rejouer en une sorte de play-back. On a tourné ainsi quelques jours, et déjà je sentais que cela ne pouvait pas aller jusqu’au bout, car João César était très agacé par les comédiens. Puis en visionnant les rushes, nous avons découvert quelque chose qui n’avait pas de sens. João César a constaté que ces images n’allaient rien apporter au poème magnifique de Blanche-Neige. Sa décision d’aller vers le noir a été une démarche raisonnable. Il disait : filmer pour filmer, cela ne m’intéresse pas. Pourquoi filmer, comment filmer : telles sont les deux questions essentielles. Le mieux, c’est de filmer en noir. 3 » Tout d’abord on a trop souvent répété le cliché mensonger selon lequel le film ne tiendrait qu’à de trop longs plans noirs, qu’il n’y aurait donc pas grand chose à voir d’où la polémique à la sortie du film dans un cinéma de Lisbonne : « c’est du gaspillage d’argent public », polémique à laquelle le cinéaste a répondu (aux journalistes, de faux critiques qui par cette réaction instantanée se tiraient une balle dans le pied et se rataient) par un simple, juste et laconique : « allez vous faire foutre ! » Manuel de Oliviera quant à lui a affirmé que ce film était le plus beau de Monteiro…

Branca de neve (2001)
Il y a exactement treize plans en couleurs qui ponctuent le film, ceux déjà évoqués d’un ciel bleu parfois traversé de nuages qui relancent à chaque fois le récit vers le début d’une autre action et dans un lieu différent. Plus les quatre images photographiques conservées aux archives de Zurich 4 , celles qui ouvrent le film en silence : Robert Walser retrouvé mort de froid et d’épuisement dans la neige le 25 décembre 1956. Elles sont une ouverture blanche, une variation fixe sur la rupture, un déterminisme formel à la fois poétique et violent. Puis vers le milieu du film, un plan de ruines, de vestiges filmés en un lent panoramique presque au ras du sol vient s’inscrire en contrepoint d’un lieu théâtral soudain invoqué : celui où les protagonistes sont censés rejouer l’épisode de l’empoisonnement et de l’arrachement du cœur de Blanche-Neige substitué au sens propre à celui d’un animal. Or au sens figuré, ce plan substitue justement à notre regard la ruine de toute représentation. Enfin, l’autre dernier plan visible est celui qui clôture le film, un plan fixe et muet sur João César Monteiro planté dans le jardin botanique de Lisbonne devant un arbre au tronc gigantesque. Il semble murmurer un au revoir, un signe, une parole muette face à la caméra, seuls les mouvements de ses lèvres laissent deviner une parole à l’adresse du spectateur à moins que ce ne soit un aimable salut à l’attention de Robert Walser…
« Filmer est une violence du regard, une profanation du réel. »
João César Monteiro
Lutter contre l’enfer terrestre c’est aussi refuser et repousser la vile image, celle qui serait un outrage inopportun face à la beauté d’un texte. Bien sûr celui de Walser n’a pas besoin d’images pour être vu. Il faut oser le sacrilège d’une posture contre le cinéma dont la nature est de faire voir. Selon Duras, le cinéma ne serait pas encore parlant, la puissance du visage serait sans égale avec la parole, la tentative — à venir — du cinéma réellement parlant serait d’arriver à la hauteur de cette puissance. Or Monteiro avec Blanche-Neige soustrait justement les visages à leur représentation, l’écoute de leur voix devient plus importante que toute visibilité. Il parvient de ce fait à atteindre une force d’évocation à la mesure du texte qui, dans l’espace sonore, se transforme en parole cinématographique pure. Il y a d’ailleurs une mystique dans le cinéma de Monteiro, une raréfaction de l’image, une épure en esprit contre tout ce qui aliénerait la parole à ce qui par nature est inférieure à elle.
« Le cinéma c’est le verbe (Gertrud), et le verbe fait cinéma viendra attester, à la limite, sur la surface noire d’un écran, la mort du cinéma et sa renaissance 5 . »
Monteiro avait eu l’idée d’adapter La philosophie dans le boudoir du Marquis de Sade, or à la place il décide de se lancer dans l’adaptation de Blanche-Neige. Au générique du film apparaît d’ailleurs une dédicace à l’adresse de Donatien Alphonse François de Sade. Cette inspiration déplacée vers Walser tient encore au primat de la parole et à sa transgression mais aussi à l’invocation (présente dans Blanche-Neige) de l’érotisme, de la violence et de l’humiliation infligée à autrui. Un précis d’éducation retenu et porté jusqu’aux puissances de l’ouïe et de la vue. À l’instar du premier film de Debord en 1952, Hurlements en faveur de Sade, fureur réalisée au bénéfice d’un terrorisme cinématographique, Monteiro réussit à maintenir avec sa Blanche-Neige tout le noir les yeux fermés sur l’excès du désastre. Dans ce film de Debord (une création en écrans noirs et blancs de situations parlées et silencieuses) les paroles flashées au blanc font à chaque instant sursauter le spectateur prisonnier de longs plans-séquences au silence noir (le plus long dure vingt-quatre minutes, ce qui fait écho à cette phrase de Sade, « les entractes de ma vie ont été trop longs », lui qui a été emprisonné à intervalle durant vingt-sept années). Espace noir s’ajoutant à celui de la salle obscure et de sa clôture, ces plans monochromes gardent pourtant la trace du temps et du mouvement, ils sont des « images malgré tout ».
« De tes lèvres je recevrai la fine esquisse de l’image, la peignant bien sûr tu auras l’adresse d’atténuer l’acuité du spectacle. » (Blanche-neige)
Chaque personnage a une vision et une version personnelles du conte de Blanche-Neige (de la haine à l’amour, mouvement que le récit maintient en suspension), celui-là est mis en crise et c’est justement par une certaine posture adéquate que le cinéaste rejoint en esprit (avec le langage qui lui est propre) et non à la lettre cette crise de la représentation et de l’interprétation. Au lieu de la prise de vue s’oppose le surgissement du texte et de son procès.


« Plus que voir j’aimerais entendre. L’image m’ôte image et voix. Veux-tu voir et rester sans voix ? Oh, non j’en aurais la nausée. » (Blanche-Neige)
Cette assertion et ce désir, le cinéaste les détournent à des fins à la fois poétiques et éthiques. Rendre un hommage cinématographique à la beauté du texte de Walser ce n’est surtout pas en rajouter (éviter l’indigestion de la surenchère en images et la plus-value d’une reconstitution mensongère). Il y a pourtant une transcription cinématographique fidèle à la teneur narrative du texte. La Blanche-Neige de Walser est d’une extrême lucidité, morte et vivante en même temps (blanche en son cercueil de verre et noire de tourments), « elle préfère la blancheur d’un silence à la cascade désormais trompeuse de mots qui ne veulent plus rien dire 6 ».
Monteiro a préféré mettre sa veste gris foncé devant l’objectif de la caméra plutôt que de tourner avec le cache sur l’objectif (trop facile) : renoncer à des images stériles, voiler, taire les images pour mieux dévoiler ce qui peut les faire naître : la parole et le silence. Et puis cette veste en appelle une autre : « De quelle étoffe es-tu donc faite/pour être morte et pourtant vivante ? » reproche le Prince à Blanche-Neige ; et c’est de cette même étoffe qu’est fait le film de Monteiro, il voue à l’instar du désir de Blanche-Neige les images au silence dans un lieu ad hoc. Image-textile exposée et voilée qui renvoie aussi au manteau de couleur sombre que portait le poète lors de sa dernière promenade…
« Terre aimée accueille moi en ta demeure. Il me fait si mal le soleil. » (Blanche-Neige)
Vivre jusqu’à l’hiver. La marche jusqu’à l’épuisement total a conduit le poète Robert Walser à s’écrouler sur la neige, le regard ouvert vers le ciel. Est-ce ce contre-champ là qu’offrent les plans de ciels dans le film de Monteiro? Haïkus topographiques visuels et sonores (on entend d’ailleurs des instruments à vent sur chacun de ces plans). Suggestion du départ, d’une envolée. À chaque fois ces plans trouent le film pour indiquer un changement de situation dramaturgique (qui s’emmêle et se contredit au regard de chaque personnage) ou de lieu. « A quoi bon voyager ? » Se demande ce singulier promeneur suisse, sans domicile fixe, qui se trouve un jour de 1929 interné à la Waldau de Berne, d’où il est transféré en 1933 à l’hospice cantonal de Herisau, où il vécut jusqu’à sa mort : 27 ans d’hôpital psychiatrique dans une existence de 78 ans. As de l’échec et champion de l’effacement, Robert Walser semble mettre toute son application et toute sa rigueur minutieuse à échouer de son mieux, à l’instar d’un personnage de Beckett : « No matter. Try again. Fail again. Try again. Fail again…Fail better. » Carl Seelig rapporte ses propos : « “À l’hospice, j’ai toute la tranquillité qu’il me faut. C’est au tour des jeunes, à présent, de se faire remarquer. Il me sied de disparaître aussi discrètement que possible.“ À l’asile, il n’écrit plus et tient à trier lentilles, haricots et châtaignes, à coller des sacs de papier ou à démêler des ficelles pour la poste. Loin de se plaindre de son sort, il envie celui de Hölderlin. « Non, je ne veux aller nulle part. Pourquoi un écrivain voyagerait-il tant qu’il a de l’imagination ? Sa posture rappelle la fin absolue de non-recevoir qu’oppose Bartleby, dans la nouvelle de Melville, à toutes les demandes : I would prefer not to. (…) Au fond je veux seulement vivre jusqu’à l’hiver. Robert Walser lui-même part le jour de Noël 1956 pour sa dernière et première promenade dans la neige, où il est retrouvé mort 7 . »
« C’est du noir qui colle à mon cœur et qui étouffe dans mon âme tout son de joie » (Blanche-Neige)
La voix est l’organe dans lequel se noue l’alliance de l’âme et du corps et dans cette adhésion organique de la voix s’exhibe une révélation nécessaire à l’esprit de la parole. De même que l’inscription physique des photographies de Robert Walser mort dans la neige s’annonce essentielle à la compréhension des longs plans noirs qui vont suivre dans le film de Monteiro. Phrases sans images ou dialogues ininterrompus grâce auxquels même les morts peuvent continuer à parler… Robert Walser enfermé durant de longues années dans un hôpital psychiatrique, considérait l’exercice de la promenade comme une condition existentielle indispensable et inéluctable à la provocation de l’écriture et de son évanouissement. Une écriture épuisée. Sa fuite au-dehors jusqu’à la mort (qui symboliquement coïncide avec le jour du calendrier de la naissance christique) rejoint ontologiquement et est de même nature que l’épisode de la Passion et de l’abandon dont il émerge (sa couleur noire et sa solitude implacable). Sortir de l’enfer : « Tout est accompli. Désormais je n’appartiens plus aux mortels 8 L’errance solitaire est le mouvement même de l’écriture, la mendiante chez Duras, la marche pour Walser, le lieu du souffle et du retrait. La superficie d’un mouvement persistant, celui de l’oubli, un espace sacré. Dans Blanche-Neige l’oubli des images est le sacrifice auquel doit consentir le spectateur lecteur. Dans cet autre film de Monteiro Souvenirs de la maison jaune (1989) d’inspiration autobiographique, le personnage Jean de Dieu lors de son arrestation qui va le conduire tout droit dans un hôpital psychiatrique présente à un policier ignare le livre d’Hölderlin, La mort d’Empédocle : « c’est un polar ? » demande le policier. « Non, c’est divin », répond Jean de Dieu. Réponse qui file droit à l’essentiel puisque le cœur du poème est celui d’une libre mort et dans la loi divine… Lors d’une séquence magistrale, Jean de Dieu (dont la seule raison de son enferment est qu’il n’est pas fou) se met à courir comme un forcené tout au long de la cour de l’hôpital, moment burlesque d’une fantaisie à couper le souffle (de manière littérale et organique), il retrouve son ami resté assis sur le banc et tout essoufflé lui lance : « c’est décidé. On ouvre les deux battants de la porte sacrée. Je m’en vais. Je vais partir. » Son ami lui répond « vas-y et donne leur du fil à retordre. » Les grilles de l’hôpital s’ouvrent alors devant lui, on entend le chant puissant des oiseaux puis l’adagio Notturno de Schubert. Au plan suivant, des enfants dans une rue de Lisbonne soudain apeurés par le surgissement d’un mort-vivant : Jean de Dieu émerge dans la fumée du dessous de l’asphalte, d’un soupirail ouvert comme un tombeau, en pleine réminiscence cinématographique venue d’un autre temps, Nosferatu, Murnau. Un homme nouveau qui vient de consentir à une mort libre et à une renaissance de même nature. Puis un lent panoramique ascendant s’élance de la silhouette hagarde vers le ciel sous les auspices d’une heure bleue. Le dernier plan du film est encore un écran noir sonore (comme celui qui ouvre d’ailleurs le film) où repose le chant du merle : « J’ai connu le merle. Il était noir, vibrant, luisant, matinal, jovial. Dès l’aube, il se mettait à sauter entre les arbres, de vrais éclats de rire de cristal… » Un merle, un oiseau, pour une physiologie des hauteurs et de la légèreté…

Mon hommage au cinéaste oiseau — à contretemps — via Hölderlin :
Larmes
Amour céleste ! délicat ! si toi je
T’oubliais, si vous, ô de la destinée,
O du feu, pleines de cendre et informes et
Déjà de toutes façon désertées,
Chères îles, yeux du monde des merveilles !
À vous seules en effet uniquement
Je m’attache, rives où l’idolâtre
Expie, l’amour, mais tout voué aux Célestes.
Car par trop reconnaissants les saints ont
Servi là-bas aux jours de beauté et
Les héros en colère ; et beaucoup d’arbres
Et les villes en ces lieux se tenaient,
Bien visibles, pareilles à un homme réfléchi ; aujourd’hui
Les héros sont morts, les îles de l’amour sont
Presque déformées. Mais floué ainsi doit être,
Partout, le tout-naïf, l’amour.
Mais, molles larmes, vous, ne m’éteignez pas
Complètement la lumière des yeux ; mémoire quand même
Laissez, afin que noblement je meure, vivre,
O trompeuses, rapines, après moi 9 .

João César Monteiro
Digressions
« Un film, presque rien, à peine visible. C’est ça qu’il faut, j’ai rien dans les mains. » M. Duras.
La mort du jeune aviateur anglais de Benoît Jacquot produit par l’INA, sorti en 1996 et récemment édité à la fin de 2009 en DVD aux éditions Montparnasse, est une conversation filmée avec Marguerite Duras dans son appartement parisien. Dialogue croisé avec des prises de vues à Vauville, petit village de Normandie, lieu de l’accident et de la mort d’un jeune aviateur anglais âgé de vingt ans et orphelin. Duras raconte à Benoît Jacquot le récit de cette mort qui l’a complètement bouleversée. La reprise de l’histoire prend forme dans l’intimité de la relation et sous l’impulsion d’une parole acquise à moitié grâce à la présence de la caméra (avec Caroline Champetier à l’image).

Marguerite Duras
Cette histoire-là, Duras affirme qu’elle ne pourrait pas l’écrire ou bien qu’elle ne le voudrait pas. C’est pourtant suite à ce film qu’elle écrira ce récit publié en 1993 « Le début, le commencement d’une histoire. » La dernière phrase : « (…) Et puis un jour, il n’y aura rien à écrire, rien à lire, il n’y aura plus que l’intraduisible de la vie de ce mort si jeune, jeune à hurler. » La béance douloureuse qui emporte l’écrivain jusqu’au bord des larmes est celle de la mémoire. Paul, son jeune frère mort en Indochine sans funérailles ni cérémonial rejoint comme un météore la mort du jeune aviateur anglais tué en plein ciel par les allemands tandis que la seconde guerre mondiale se terminait. Une image écrite plus tard : « À Vauville, la mémoire du chant de la mendiante me revient. Ce chant très simple. Celui des fous, de tous les fous, partout, ceux de l’indifférence. Celui de la mort facile. Ceux de la mort par la faim, celle des morts des routes, des fossés, à moitié dévorés par les chiens, les tigres, les oiseaux de proie, les rats géants des marais 10 . » Une histoire qui ne peut ni se filmer, ni s’écrire, ni se montrer en totalité, de nature inachevée mais qui pourrait pourtant exprimer la totalité de l’émotion et puis cesser. On retrouve aussi l’idée des haïkus topographiques dans ce film. Une longue séquence dans le jardin de l’église où au milieu de la pelouse il y a un tombeau, une pierre de granit gris sur laquelle est écrite le nom du jeune anglais, W. J Cliffe. En dehors du cimetière communal, la tombe isolée du jeune anglais a été dressée par tous les habitants du village et sans autorisation. Une situation à la fois archaïque et révolutionnaire. Décrire plutôt qu’inventer, insister en lents panoramiques sur ces quelques lieux désertés. L’image tend vers l’évidemment et la précision. Mettre en lumière le désert et le silence, cela trouve une certaine résonance dans cette phrase de Monteiro : «Je crois que pour filmer je n’ai même pas besoin d’une petite caméra : j’ai besoin d’un peu de lumière dans ma tête et puis c’est tout, mais, à l’époque, presque tout le monde me disait que les films que je faisais étaient de la merde (Monteiro évoque ici la révolution des œillets de 74, or ses débuts en cinéma coïncident avec la fin des années soixante), que je n’avais aucun talent et surtout (et ça je ne supportais pas) que je devrais plutôt écrire car j’écrivais vachement bien (…) j’ai commencé à être envieux du scribe Monteiro, donc j’ai décidé de le tuer pour que le rejeton puisse filmer librement 11 . »
À la manière de Robert Walser, selon la formule que lui consacre Walter Benjamin dans son essai sur l’écrivain poète, Monteiro déserte et fait s’écrouler lui aussi, « la falaise insolente de ce qu’on appelle la grande littérature 12 » pour s’en aller vers une forme a priori moins noble (en écho à la petite forme chez Walser, voire ses écrits « microgrammes ») vers le cinéma malgré tout. Duras, quant à elle, a une haute idée de la littérature et celle-là lui semble sans commune mesure avec le cinéma. C’est peut-être ce qui lui fait dire à Jean-Luc Godard, lors d’un entretien réalisé à Paris le 2 décembre 1987, « tu ne tiens pas le coup devant l’écrit ». Cependant avec l’histoire de la mort du jeune aviateur anglais, Duras assume la déficience originelle de ne pouvoir écrire ni filmer d’une certaine façon le récit de cette mort : « je ne peux rien dire. Je ne peux rien écrire » et elle l’écrit. Il faudrait peut-être filmer ça, dit-elle à la chef opératrice : à l’image, un lent panoramique ascendant le long du mur de l’église de Vauville, paroi grise criblée de balles, traces de la guerre, rien d’autre à voir. « Et puis après j’ai vu autre chose. Toujours, après, on voit des choses (…) Les arbres morts sont là, fous, figés dans un désordre fixe, tellement, que le vent ne veut plus d’eux. Ils sont entiers, martyrs, ils sont noirs, du sang noir des arbres tués par le feu. 13 » C’est en racontant face à la caméra, en retournant sur les lieux qu’elle voit avant d’écrire. La parole entre Benoît Jacquot et elle (parole filmée qui tient aussi à l’inscription physique particulière de la voix de Marguerite, une voix abîmée par la maladie) a donc préparé l’écrit puisque suite à ce film elle s’interroge (avec la même équipe et la même production) dans sa maison de Neauphle-le-Château sur la sauvagerie de l’écriture et sa caverne avec Écrire…
À travers ces différents films, l’écran de cinéma peut être transformé en fenêtre noire, devenir un lieu iconoclaste de vacuité et d’attente interminable. Un échange entre le ne pas tout voir jusqu’au ne pas tout entendre. Cet écart et cette lacune le spectateur doit les prendre en charge avec sa propre imagination, être travaillé (par le regard et par l’écoute) par les lieux désertés qu’offrent certaine œuvres. À partir de trois films : Blanche-Neige de Monteiro, Hurlements en faveur de Sade de Debord et La mort du jeune aviateur anglais de Duras se pose la problématique de la jointure entre le texte (sa transformation par le médium cinématographique) et une image entièrement noire. Image césure, arrêt de mort, suspension silencieuse dans le film de Debord. Image textile, explosée et voilée dans le film de Monteiro. Image inachevée dans le film de Duras. Interroger les raisons qui conduisent ces trois films à maintenir coûte que coûte une tension portée jusqu’à son plus haut degré entre le lieu noir rectangulaire de l’écran et celui incommensurable de la parole. Lorsque cela suppose la prédominance du verbe contre l’illusion et la reconstitution, le lieu lacunaire et noir devient alors le lieu juste ; plans monochromes blancs ou noirs qui substituent au regard du spectateur la ruine de toute représentation. Quelles sont les exigences qui font naître les images et qui ont le pouvoir d’interroger leur simple, trop simple apparition ?
Filmer est un acte conséquent et s’emparer d’un texte littéraire (ce que fait Monteiro avec Blanche-Neige) à des fins cinématographiques en est un autre. Soustraire plutôt que rajouter dans l’ombre et à l’écart, rejoindre en esprit et non à la lettre la crise de la représentation. Le détournement d’un matériau doit s’interroger sous les auspices à la fois poétiques (inventer de nouvelles formes pour de nouvelles situations) et éthiques (refuser le mensonge de la reconstitution, lui préférer la description rigoureuse et clinique. Décrire plutôt qu’inventer). Phrases sans images et films imperceptibles. Pourquoi ne pas ouvrir, pour finir, sur un ultime renversement : est-ce que le fait de voir (la puissance d’évocation de certains lieux et faits) ne permettrait pas aussi d’enclencher d’autres procédures d’écriture, de cinécriture ?
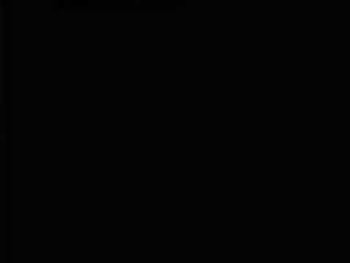
Notes
- Georges Bataille, Le bleu du ciel, Paris, Gallimard, coll. « L’imaginaire », 1992, p. 150. ↩
- Michel Chion, La voix au cinéma, Paris, Éditions de L’Étoile, Cahiers du cinéma, 1993, p. 112. ↩
- Propos recueillis en 2003 par Sandrine Loiseau et Aurélien Py, dans Pour João César Monteiro, ouvrage collectif, Bruxelles, Yellow Now, 2004, p. 180. ↩
- Les archives Robert Walser qui étaient jusqu’à présent à Zurich se trouvent depuis avril 2009 en partie à Berne à la Marktgasse 45. Les Archives littéraires suisses de la Bibliothèque nationale ont récupéré l’autre partie c’est-à-dire les manuscrits et les éléments les plus précieux. On peut y trouver tous les textes de Robert Walser et de Carl Seelig au format numérique, les éléments qui n’ont pas été transférés aux Archives littéraires suisses et une exposition sur l’auteur. Ce nouveau centre d’archives est la plus grande bibliothèque du monde spécialisée dans l’œuvre de Robert Walser. ↩
- Monteiro au pied de la lettre, Notre cinéma et le leur, p. 28. Publié initialement dans O Tempo e o Modo, n°64-65-66, oct-nov-déc. 1968, dans Pour João César Monteiro, Bruxelles, Yellow Now, côté cinéma, op. cit., 2004. ↩
- Robert Walser, Blanche-Neige, José Corti, 2001, dans dossier complémentaire établi par Fabienne Raphoz-Fillaudeau, Avatars de Blanche-Neige, p. 144. ↩
- http://psyfontevraud.free.fr/2004/garre2004.htm, consulté le 29/12/09. Actes de la XIX ème journée de psychiatrie de Fontevraud intitulée « Sur le chemin voyage thérapeutique, voyage pathologique », samedi 5 juin 2004. Texte du Professeur J.B Garré, « Psychiatrie du voyage, voyages de psychiatres, voyage en psychiatrie. » Son héros et son double, Simon, dans Les enfants Tanner, se trouve très heureux de ne rien faire et de ne jamais quitter son pays : « Il faut bien aussi qu’il y ait dans le monde des gens qui regardent. (…) Tu n’auras vraisemblablement aucun succès dans la vie, mais cela n’enlèvera rien à ta tranquillité. » A quoi bon voyager ? « Je reste et je continuerai à rester. C’est si agréable de rester. Est-ce que la nature, elle, va à l’étranger ? (…) Les rivières et les nuages voyagent, mais c’est une tout autre façon de s’en aller, autrement profonde, sans retour. (…) Le vrai voyage, le seul voyage serait un voyage sans retour. Comme Bachelard l’indique dans L’eau et les rêves, la mort ne serait peut-être pas le dernier (et le grand) voyage, mais bien le premier. Le cercueil, associé à ce qu’il propose de nommer le « complexe de Caron », tel qu’Arnold Böcklin par exemple l’illustre dans ses versions de L’île des morts, « ne serait pas la dernière barque. Il serait la première barque. » Simon encore, ce propre-à-rien absolu, dans ce roman qui se clôt sur une apostrophe et un tiret insolites : “ Venez – “ ↩
- Friedrich Hölderlin, La Mort d’Empédocle (troisième version, trad. de R. Rovini) dans Hölderlin, Œuvres, publié sous la direction de Philippe Jaccottet, Paris, Gallimard, «La Bibliothèque de la Pléiade», 1967, p. 578-579. ↩
- Friedrich Hölderlin, Nachtgesänge (Chants de nuit), Éditions grèges, coll. « Lenz », octobre 2002, p. 23-24. ↩
- Marguerite Duras, Écrire, La Mort du jeune aviateur anglais, Paris, Gallimard, 1993, p. 66. ↩
- Citation de Monteiro dans Les sanglots longs des violons de l’automne, lettre à Jacques Déniel en réponse à sa question «Pourquoi filmez-vous ? », datée du 8 septembre 1991 et écrite à l’occasion de la première rétrospective en France de l’œuvre du cinéaste. Lettre reprise dans le numéro 50 de la revue Trafic, Qu’est-ce que le cinéma ?, été 2004. p. 91. ↩
- Walter Benjamin cité dans Bruno Tackels, Walter Benjamin, une vie dans les textes, Paris, Actes Sud, 2009, p. 308. ↩
- Marguerite Duras, Écrire, op. cit., p. 65. ↩
