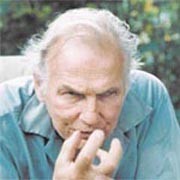Stéphane-Albert et les viscères du monde
« L’art est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art. » – Robert Filliou
Un acte de foi
L’œuvre de Pierre Perrault, bien que relativement respectée, citée et discutée, semble pourtant largement méconnue et incomprise dans la grande histoire du cinéma documentaire et du cinéma en général, au Québec comme ailleurs. Pourtant, son entreprise du cinéma-vécu est aussi riche, brillante et complexe que le travail des grands noms incontournables du cinéma documentaire, comme Frederick Wiseman aux États-Unis et Jean Rouch en France. Du moins, son héritage n’est certainement pas partagé unanimement, quand on pouvait lire sous certaines plumes locales, lors de sa mort en 1999, que Perrault était l’une de ces bonnes vieilles figures d’un Québec et d’un cinéma révolus. De tels propos peuvent être tenus à son endroit à une époque et dans une culture où l’intérêt pour la réalité est en déclin, ainsi que la capacité de la comprendre à travers des images.

Pierre Perrault
Perrault n’a peut-être rien fait d’autre que de mettre en application une promesse depuis toujours inhérente à l’invention du cinéma sonore : faire parler la réalité. Proposition banale? Mais dans un premier regard, que comprenons-nous vraiment des gens, de leurs liens les uns aux autres, à la nature, à l’histoire? La réalité se montre, mais s’explique-t-elle? Elle se déploie sous un voile, peu importe que celui-ci soit tendu par elle ou par notre esprit. Supposant que la réalité contient bien plus que ce qu’on en perçoit au premier regard, et que la parole d’une personne, lorsque juste, naturelle, honnête, dévoile une partie de son « âme », alors le cinéaste venant choisir, enregistrer, puis monter cette réalité de façon intelligible, est la médiation par laquelle cette réalité vient nous dire de quoi elle est faite et par laquelle il nous est possible de se reconnaître dans les autres.
La réalité est là, mais elle est comme le Fleuve Saint-Laurent, qui coule dans bien des films de Perrault, grande route silencieuse. Perrault savait que ce silence renferme du sens sur la vie des gens qui vivent dans son courant et il passa une partie de sa vie à « faire parler le fleuve à travers les hommes qui lui parlaient du fleuve », et réciproquement le fleuve lui disait « voici comment je porte la vie de ces hommes ».

Ses films sans voix off, dont toute la narration n’est construite qu’à partir de la parole des gens vivant l’expérience filmée, dont aucun mot n’est écrit ou soufflé par le cinéaste, sont bien entendu les plus éloquents à ce niveau. Il faut cependant se garder de rejeter dans l’ombre les premiers et derniers films de Perrault, qui procédaient par la narration de textes écrits par l’auteur. Des oeuvres (Au pays de Neufve-France (1958-59), Cornouaille (1994)) d’une beauté et d’une force aussi remarquables, qui interdisent toute affirmation de la suprématie du « direct » comme forme absolue du documentaire. Mais Pour la suite du monde (1963) et La Bête lumineuse (1982) sont sans contredit les deux plus grands films de Perrault, deux monuments du cinéma, bien que le second fut en bonne partie rejeté par la critique et voué à un certain silence dans notre cinématographie, ou au mieux est-il bien catalogué dans le grand registre historique du « cinéma-vérité ».
Faire parler la réalité
Le montage propose l’une des synthèses possibles de la réalité; il en extrait un sens et un récit latent. Même principe chez Wiseman, parler par ce qu’on fait parler, et tous deux montent environ 20% de tout le matériel recueilli. Montage? « Alors la subjectivité! On s’éloigne donc de la réalité », entend-on vite monter des discours sur le cinéma documentaire. Perrault disait que les théoriciens du documentaire semblent souvent plus intéressés par la fiction, cherchant par où elle s’infiltre et croyant qu’elle seule ordonnera le regard en face d’un réel toujours fuyant. Mais c’est forcément toujours par une perspective subjective que le monde s’ouvre à la compréhension et laisse entrevoir un sens quelconque. Encore ne faut-il pas confondre subjectivité et fiction si l’on ne veut pas rester au large de la réalité. Tout semblant de vérité doit se faire complice de cette perspective pour s’incarner. La subjectivité n’est pas coupure irrémédiable avec le monde, ou alors elle devient autre chose, narcissisme peut-être. Le montage arrive à révéler quelque chose s’il est un dialogue avec la réalité, bien que généralement, au cinéma, il soit un monologue.
Quand on dit « lire la réalité », c’est dans le même sens que l’on voit et interprète sa propre vie, comme quelque chose de familier qui en même temps garde sa part d’opacité et d’étrangeté, que l’on comprend partiellement et qui permet de se connaître soi-même seulement par le rapprochement de certains événements, faits saillants, attitudes récurrentes. Ceci ne veut pas dire, toutefois, que seul certains événements « majeurs » ont une signification. Tout est susceptible de parler. Mais ce sont ces rapprochements qui nous disent quelque chose. Regarder sa vie de bout en bout, dans la suite de tout ce qui la compose, sans montage, sans ellipse, c’est composer un tableau objectif sans vérité particulière. De même dans le « cinéma-vérité », de quelle vérité parlerions-nous si un film de Perrault ou de Wiseman n’était que l’amas désordonné des 25 ou 50 heures de matériel tourné?
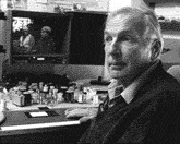
Perrault au montage de La bête…
Ou un plan-séquence en vidéo qui capterait un événement dans sa totalité dirait-il autre chose que ce qu’on saisirait sur place, du même point de vue? C’est justement parce que le monde n’est pas immédiatement intelligible dans toute sa complexité que le cinéma peut devenir « moyen de lecture ». Mais de toute façon, dirait-on alors, même toutes les images sans montage serait déjà marquées par la subjectivité du cadrage de la prise de vue. Bien sûr, mais qui a dit que la réalité se donnerait d’elle-même à l’œil de la caméra, si elle ne se donne même pas clairement à l’œil nu? Perrault savait que la réalité, ou que « l’âme » d’Alexis, de Bernard ou de Marie, ne parleraient pas à n’importe quelle caméra. Il fallait que la caméra ne devienne que l’accessoire d’une équipe qui partageait un certain vécu avec les personnages du films, et ce, aussi bien dans une maison en fête qu’au cœur de la forêt. Perrault a eu la chance de rencontrer Michel Brault, Bernard Gosselin et Martin Leclerc. Pour chacun d’eux il disait : « la caméra qui marche », « la caméra en bois rond » et « la caméra qui rit ».
Bref, si la théorie veut rendre sa juste part au documentaire, ce doit être en construisant des ponts entre le subjectif et l’objectif, entre le personnel (ou le particulier) et l’universel, bien que dans la pratique on se lasse de ces termes, car on est pris dans l’exigence d’une relation concrète et paradoxale avec la réalité, faite de réciprocité et de conflits. On peut ici entrevoir la position délicate de la vision de Perrault par rapport au statut de la réalité dans la pensée et la société contemporaines. Une pensée qui semble souvent jongler avec le subjectif et l’universel comme deux pièces d’un puzzle qui ne s’emboîteraient sous aucun angle, problème dont les implications actuelles sont, il va sans dire, autant politiques qu’artistiques. On trouve dans le Coran ce magnifique trait d’esprit : « Dieu nous a fait différents pour que nous puissions nous reconnaître. »
Si Perrault se défendait contre la fiction, il disait lui-même que c’est bien parce qu’on tentait toujours de la lui opposer. Inutile donc de faire le procès de la fiction. Certes, il voulait proposer la réalité contre la « fictionnalisation » de la vie en général, mais quant au cinéma de fiction, il s’y intéressait tout simplement très peu. Il a fait des choix l’engageant sur une autre voie. Inventer et jouer des histoires, ou bien monter des histoires à partir du vécu, c’était pour Perrault deux mondes distincts, se ressemblant peut-être, mais ne parlant pas le même langage et répondant d’exigences très différentes. On peut écrire une bonne histoire sur un pêcheur, avec un acteur qui devra faire vivre le personnage. Mais que ce soit Rémy Girard ou Gérard Depardieu, ils ne sont pas pêcheurs, on décide simplement d’y croire. Perrault ne s’intéressait qu’au vrai pêcheur. Il a choisi de partir du personnage auquel nous n’avons pas le choix de croire. C’est en des termes semblables qu’il s’expliquait quand on lui demandait s’il ne serait pas possible de raconter le même récit et exprimer les mêmes idées avec des acteurs qu’il pourrait mieux diriger. Et quand on lui disait, à propos de Pour la suite du monde : « mais c’est vous qui avez initié le projet de relancer la pêche au marsouin à l’Île aux Coudres, vous êtes derrière toute l’histoire, vous êtes intervenu pour faire le film… », il répondait simplement : « Le film, c’est la pêche au marsouin telle que les gens de l’île l’ont vraiment vécue. »
Perrault était donc, en quelque sorte, athée envers la fiction. Son entreprise témoigne par contre de l’un des plus formidables actes de foi au cinéma, celui de croire en la révélation de la vie et de la réalité à travers des images, et par le fait même d’y voir là la plus grande difficulté.
Lire la réalité présentée dans un film demande plusieurs visionnements. On peut convenir d’un très bon film à la découverte de Pour la suite du monde ou de La bête lumineuse, mais il faut les revoir encore et encore pour y trouver toujours davantage, parfois des chapitres entiers qui nous avaient échappé. Cinéma centré sur la parole, il n’est sans doute pas fortuit que Pour la suite du monde raconte l’aventure d’une « pêche aux marsouins » et La bête lumineuse celle d’une chasse à l’orignal. Perrault a parlé de la très probable importance de la chasse dans le développement du langage. Pour les premières communautés humaines, toutes les famines justifiaient l’effort d’une représentation, d’un récit de la chasse autour du feu, une fois le groupe nourri par le gibier durement traqué et vaincu. Le spectre de la famine disparu, il demeure la nécessité du récit qui accompagne l’aventure, la confrontation aux éléments, la camaraderie et la transmission des connaissances sur la nature, en des pays où la « parlure » reflète une histoire, un mode de vie et une « âme ». Mais si d’un côté le réel ne se coule pas aisément dans le moule du cinéma, peut-être sommes-nous aussi, comme disait Perrault, des « analphabètes de la réalité ». Il y a certainement différents degrés de résistance à la lecture de la part du spectateur. Car le réel n’est pas familier dans les images. On passe d’abord par le sentiment d’une matière crue, d’une surface rude, le réel peut même susciter un certain malaise par sa présence à l’écran. La résistance est d’autant plus forte quand le spectateur est mis en face de « vraies personnes », et encore davantage s’il s’agit, comme dans La Bête lumineuse, d’une bande d’hommes qui se saoulent au fond des bois une semaine durant. Aussi ces personnes n’ont rien à voir avec le « réel-type » de la télévision et du cinéma, à mille lieues de la télé-réalité qui finalement ne fait que reproduire les conventions et les stéréotypes de la fiction, elles évoluent aussi dans une toute autre avenue que le documentaire « folklorique » et informatif. Ceci dit, il faut tout de suite écarter l’idée, tout aussi contemporaine et mass médiatique, que Perrault voulait faire des films avec « les gens du peuple », au sens du monsieur-tout-le-monde de la télévision. Ce sont des rencontres marquantes qui sont à la source de ses films, ce sont certaines personnes en particulier qu’il a voulu filmer, pour leur intelligence, leur caractère et la réalité existentielle, culturelle et historique qu’elles expriment. Il n’espérait pas non plus que ses films s’adressent à tout le monde, ni à ses sujets, ni aux cinéphiles éblouis par les stars. Et même si ses films le menèrent quelques fois à Cannes, ce fut pour marcher à côté du tapis rouge. Les gens sortaient des projections, les autres Québécois se sentaient gênés devant Pour la suite du monde, film néanmoins défendu par Les Cahiers du cinéma de l’époque. « On n’aime pas la viande crue… Le langage en haillons », disait Perrault, ces « demeurés », selon les esthètes cannois dédaignant plus tard La Bête lumineuse.

De gauche à droite : Albert, Pierre Perrault, Bernard, Nicolas. (ONF)
La chasse à la bête lumineuse
Il y a encore, et pour longtemps, beaucoup de choses à dire sur Perrault et sur ses films, mais tout en étant d’une telle envergure, d’une telle richesse, son oeuvre est pour ainsi dire faite d’une évidence éblouissante et désarmante, propre à s’esquiver de tout discours qui voudrait trop vite la circonscrire sur le terrain connu du cinéma. Contentons-nous de revenir sur La bête lumineuse, en abordant un personnage en particulier, Stéphane-Albert, tentons de voir ce qu’il donne à lire sur lui-même, sur les autres et sur le cinéma de Perrault.
Ce film est l’histoire d’une partie de chasse à l’orignal. Stéphane-Albert, plus communément appelé Albert, y retrouvera son éternel compagnon d’enfance, Bernard, avec d’autres amis et membres de la famille. Albert, bavard, un peu vantard et très cultivé, physiquement moins aguerri que ses compagnons, est le « poète » du groupe, faisant d’abord apparaître les autres, moulins à jurons, comme étant plus simples et plutôt rustres. Dans la quête de l’orignal tant convoité, l’atmosphère réchauffée par l’alcool et la vie en commun, le groupe devient vite une meute de loups qui encercle sa proie, c’est-à-dire Albert. Bernard trône en chef de la meute. « Même si tu portes le panache », dit-il à Albert, du fond de son ivresse, « tu sais que je t’aime quand même ».

Pour la suite du monde
Plusieurs s’entendront pour dire que Pour la suite du monde est le meilleur film de Perrault, le plus achevé. Par contre, La bête lumineuse constitue l’ultime accomplissement de sa vision, l’horizon insurpassable de sa quête, le goût inaltéré de cette « viande crue » qu’il recherchait. Car il s’agit d’une réalité à laquelle le cinéma ne peut rien arracher, rien imposer. Ces hommes saouls à la chasse offrent des images sans séduction, un réel difficile d’accès, le plus brute, le plus rugueux, un réel intouché et irrécupérable par le cinéma. Après Pour la suite du monde, il y eu à l’Île aux Coudres des autobus de touristes qui s’arrêtaient pour voir les attachants personnages du film. De plus, d’exceptionnelles prises de vue enchantent le regard, même si on n’en saisit pas toute la profondeur au premier coup d’oeil. Rien de tel n’est possible avec La bête lumineuse.
L’épreuve
Albert peut tout sublimer dans le langage, poétiser toutes les expériences. Il veut souvent tout exprimer par la créativité de sa prose, sa culture littéraire. Cependant, il est celui qui bute sur la réalité, sur le monde concret qui fonde ses expériences, qui le met à l’épreuve. Il magnifie le monde à distance mais il lui est difficile d’entrer dans la matière de la réalité, les viscères du monde pourrait-on dire, exactement comme le démontre et le symbolise son expérience avec le lièvre : il entend apprendre quelque chose en éviscérant le gibier, surmontant un dégoût naturel, bravant les moqueries des camarades, mais une fois les mains dans les entrailles de l’animal, Albert ne peut s’empêcher de se détourner pour s’appuyer à un arbre et vomir. Il lui est par ailleurs très difficile d’être prêt à l’heure prévue, d’affronter le climat capricieux de l’automne, de supporter les longues heures d’attente immobile, de participer aux tâches ménagères dans le chalet, etc. Le matin du départ, lorsque son ami lui demande s’il a vraiment besoin du coussin qu’il vient d’ajouter aux bagages, Albert dit : « ben moi, j’suis fragile ». Ce pénible contact avec le monde réel, concret, naturel, ou disons l’exigence de l’action pure, culmine dans la scène du foie d’orignal, que l’on découpe pour goûter cru. Albert refuse, bien entendu, mais se sent vite forcé d’essayer et prend la viande saignante qu’on lui pousse sous le nez. Il mastique, avale, on lui en donne un autre morceau, mais alors que les autres entonnent “il est des nôtres, il a mangé son foie comme les autres”, Albert doit sortir pour vomir à nouveau. À partir de ce moment, Albert change, il redescend de sa belle utopie de l’aventure, il sait qu’il est la proie aussi, qu’aucune des vérités sur sa personne n’échappera au dur miroir que les autres s’emploient à lui tendre. Mais ce sont ses rapports avec les autres qui changent, jusqu’à l’inévitable explosion, tandis qu’Albert, en lui-même, ne pourra dévier de cette vérité constamment révélée sur son être. Il aura même à le dire à Bernard, à la fin, pour sa propre défense : « Mais si je retournais à la maison et que ma femme me voyait empressé de laver la vaisselle… Tu comprends, ce n’est pas moi, que veux-tu que je fasse… ». Mais qui, au fond et malgré la marge de liberté que l’on veut bien s’accorder, peut échapper à la vérité de son être, de son identité? La beauté des experiences fortes n’est-elle pas de révéler qui l’on est, permettre de toucher le fond dur de sa personne?
Peut-être que La bête lumineuse, c’est l’histoire du langage (d’Albert) contre le geste (des autres). Toutefois, nous rappellerait Perrault, c’est à peine si une chose existe quand elle n’est pas nommée, et la forêt, l’orignal, les amis, existent de tout leur poids pour les autres aussi. Ils ont le langage eux aussi, le langage de la chasse, de la forêt, de la longue amitié qui sait allier la « pudeur masculine » et l’art de la moquerie. En fait ils parlent sans arrêt, leurs blagues se succèdent plus rapidement que les poèmes d’Albert. C’est donc un certain langage contre un autre, issu de milieux différents, habitant des hommes différents, mais chacun avec son sens, sa nécessité.

La question n’est donc pas d’opposer le langage comme représentation contre le geste comme connaissance de la réalité, mais de sonder le rapport qu’un langage particulier peut entretenir avec la réalité. Sauf que le groupe d’hommes qui entoure Albert, s’il diffère dans le langage, se démarque peut-être plus profondément ailleurs, entre autre, par le silence. Prenons la scène du « litige du jeudi soir » : « … Si nous pouvons passer l’épreuve du jeudi… Il arrive toujours quelque chose, l’an passé on s’est battus », dit Nicolas. Il était décidé du « silence », du coucher tôt, la paix, le sommeil, avant la dernière journée. Mais tapis dans les bois, à l’affût du gibier, ou sous le toit de la cabane, les autres semblent trouver qu’Albert n’arrive pas à respecter le silence, à avoir une connaissance instinctive de la valeur du silence dans certains moments. Ceci est un épisode capital dans une lecture plus approfondie du film, des personnages, du sens de leur aventure et de leurs rapports. Car il est plus facile, au premier abord, de percevoir Albert uniquement dans son statut de proie, de victime, de sensibilité et de profondeur violentées par la rudesse de ses compagnons. C’est l’interprétation la plus commune, la plus immédiate du film. Ainsi verra-t-on cette scène, où il persiste à vouloir dire son poème et à exiger que tout le monde l’écoute, refusant toute consigne du silence avant d’avoir obtenu tribune, comme étant une scène héroïque pour Albert ; il lira son poème dans l’adversité, pour des oreilles impropres, pour précipiter malgré lui le rejet d’un ami, de qui il se sent trahi. Cette lecture de la scène et du film dans son ensemble peut aussi provenir tout simplement de l’attitude du spectateur « cultivé », son identification immédiate avec Albert et sa résistance à percevoir la vérité et l’intelligence des autres. Mais observons la scène dans un autre sens, avec un autre oeil, celui qui cherche à connaître Albert et non à s’identifier à lui. Albert est alors aussi celui qui ne comprend pas toujours les autres, autant que ceux-ci ne le comprennent pas. Il est celui qui ne sait pas respecter le silence dont tous ont convenu, il est celui qui, dans la confrontation à ses faiblesses et ses différences, va les réaffirmer pour ne pas perdre la face. Il est celui qui demande, voire ordonne toujours qu’on l’écoute, peu soucieux de savoir se faire écouter. Celui dont l’ego ne panse ses égratignures qu’en voulant s’épancher davantage, se mettant donc toujours à découvert pour les flèches des chasseurs. C’était pourtant lui « l’archer » du groupe, qui voulait par « l’art » silencieux du tir à l’arc surpasser le métal et le bruit des carabines. Même s’il finit par s’affaisser, en avoir assez et dire, la mine basse, « vous m’lâchez pas », fera-t-il réellement un effort, au-delà de l’épisode du lièvre, pour être respecté? Le poète a-t-il droit de cité avant d’avoir connu la réalité, senti les épines du monde et affronté la meute des hommes, aux crocs cruels et fraternels? Albert dit « vous m’lâchez pas » alors qu’on lui avait demandé d’aller chercher de l’eau ; « tu ne fais jamais rien, tu es tellement paresseux, tu pourrais bien faire ça pour nous ». Ne voulant ni être l’esclave, ni justifier les railleries, il part vers le lac, traînant les pieds comme un enfant puni, la casserole à la main. Bernard lui dit : « tu devrais être capable, n’est-ce pas ce que nous sommes, les Québécois, des porteurs d’eau? La continuité, Albert, comme la continuité en poésie, non? ». Mais les berges du lac étant difficiles à pratiquer, vaseuses et embroussaillées, Albert fait demi-tour et rapporte la casserole vide. Il n’atteint pas le lac, ne plonge pas la casserole dans l’eau, ne se mouille pas les pieds, dans ce lac sauvage au milieu de la nature, sur lequel il pourrait écrire un poème, assis dans le confort de son salon. La réalité est-elle si inaccessible qu’elle lui paraît dans ses pire moments de défaite? Peut-être qu’il suffit parfois d’un autre regard ou d’autres mots. « Mais qu’est-ce que tu faisais là-bas, Albert? Il y a un beau ruisseau juste à côté! ».
Il était certes le seul à qui ses faiblesses lui sont balancées au visage sans arrêt. Devrait-il toutefois considérer cette situation comme une « chance »? Du moins c’est ce que lui dit Bernard à la fin : « pourquoi n’as-tu pas su aussi t’allier aux autres, et peut-être montrer à l’un de nous ses défauts? Pourquoi un autre n’a pas eu cette chance? »

Barney
La lecture plus patiente du film implique que chaque protagoniste qui y dépose son vécu donne à lire au spectateur une partie de la réalité. Ce n’est pas un personnage qui, chargé du sens, de la métaphore ou de la morale du film, demande notre identification pour nous conduire au message de l’auteur. C’est ce que veut dire Perrault, quand il écrit qu’il n’est pas l’auteur de ses films. Chacun, d’ailleurs, y apporte ses vérités, du silencieux guide, Barney, nourrissant la chèvre et « câllant » l’orignal, au ricaneur et insolent Nicolas, qui chaque instant guette d’un esprit vif les pointes d’ironie possibles à l’endroit d’Albert. Mais lorsqu’il marche effrontément sur l’estomac d’Albert qui est étendu au pied d’un arbre, le chapeau sur les yeux, est-ce par méchanceté ou geste enfantin de réconciliation? Perrault dira plus tard qu’il pensait à cette scène et voulait savoir ce qu’il en était. Il demanda à Nicolas. C’était simplement pour dire à Albert qu’ils étaient quand même de bons amis. Tendresse camouflée de l’homme orgueilleux, qui croit peut-être lui aussi que les blagues sont allées assez loin. Il ne veut donc pas réaffirmer la faiblesse d’Albert, lui signifier qu’ils le tiennent toujours, mais plutôt, en exagérant ainsi la provocation, il signifie : « Allez Albert, debout, tu vois bien que c’est juste pour s’amuser, on t’aime bien… »
Albert, avec ses poèmes et ses grandes phrases, est à certains moments peut-être ennuyeux pour les autres, sinon suffisant. À d’autres moments son sens des mots lui permet d’exprimer des choses indéniablement belles, son talent et sa vision poétique brillent d’une lumière inattendue au milieu de la viande crue, de la “swamp” et du délire éthylique. Par exemple la “prière” qu’il invente à Bernard, étendu inconscient sous une couverture, au terme de la beuverie. « … Ton nez est un ciboire, ta joue est un calice… mais ce que j’aime par-dessus tout en toi, mon tendre ami, c’est ton sens du péché… ». Et toute la poésie réelle d’Albert y fleurit un instant, puis il se taît et entame une pièce sur sa guitare, moment où les autres aussi se taisent et enfin l’écoutent sans se moquer, puis ils allument une bougie auprès de Bernard. On retient aussi que c’est Albert qui suggère le titre du film dans un passage de ses expressions lyriques, “la bête lumineuse” est sa perception à lui de la chasse, de sa propre quête qui entretient alors un rapport étroit avec celle de Perrault.

Albert et Bernard s’expliquent
Si chacun se révèle par la parole, ou le silence (Barney parle plus aux orignaux qu’aux hommes), Albert, quant à lui, incarne parfaitement une situation de la parole par rapport à la réalité, c’est-à-dire qu’il représente authentiquement le paradoxe du langage, le double mouvement d’une mise à distance et d’un pouvoir de révélation. Parfois les mots lui permettent de faire vivre une chose, un événement, une émotion, en même temps qu’ils le maintiennent à distance des réalités qu’il veut nommer et embellir. Albert devient donc, dans l’épreuve de la réalité, l’alter ego de Perrault avec ses outils du cinéma, il est l’expression concrète du problème de l’art, la voix intime de la conscience du cinéaste. Perrault qui, autant par sa vision du cinéma que dans ses écrits, était avant tout lui-même un poète. À l’instar d’Albert, il venait d’une culture littéraire, sans laquelle d’ailleurs il n’aurait sans doute pas fait ce qu’il a fait, malgré ce qu’il en dirait peut-être lui-même. Mais au cours de diverses circonstances il se sentit poussé à fuire les livres pour aller connaître le fleuve, la forêt, goûter la sueur, sentir le froid, découvrir des mots qui parlent du pays et des âmes qui l’habitent, trouver la poésie dans la vie et la parole des autres. Il voulait trouver « un Ulysse qui n’est pas Homère, un Menaud qui n’est pas Savard ». Perrault était cinéaste par la force des choses, l’artiste qui ne croit pas à l’art. On ne reviendra jamais assez sur la pertinence d’une vision où la réalité vient avant l’image, dans une culture où se vit de plus en plus l’inverse. Il y eut d’abord des rencontres, une pêche, une chasse, une expérience vécue par le cinéaste, ses collaborateurs et les gens qu’ils filment, et en plus, avec l’aide de la chance, il y eu un film fait avec la foi que quelque part, entre une parole et un geste, le cinéma peut bel et bien saisir la vie.
« … L’homme imite, plus ou moins confusément, les mythes qu’on lui propose, s’acheminant en apparence vers un nouvel âge. Au lieu de ce monde illusoire de la vénération, je propose la réalité pure et simple. Personne n’en veut. Et j’ai l’impression d’être celui qui n’allait pas à la messe du dimanche dans les années cinquante. Aujourd’hui on l’approuverait. Peut-être qu’un jour à la porte des cathédrales électroniques on me comprendra. Mais j’en doute fort. Et je me déclare satisfait de révéler maladroitement peut-être de petits éclats de réalité, que je ne transforme pas en idoles et auxquels on n’élèvera pas de monuments. Et pour cause. On ne vénère jamais que le mythe. Mais à cause de cette lunette fabuleuse qui agrandit la mémoire, j’ai cru que l’homme s’intéresserait au monde qui l’entoure. Je me suis grossièrement trompé. La lune n’intéresse que Galilée, et l’homme, que quelques amis qui m’approuvent, sans doute par amitié. » [[ Pierre Perrault, CINÉASTE DE LA PAROLE, Entretiens avec Paul Warren. Éditions de l’Hexagone, 1996, p. 150.
- Les idées et propos de Perrault rapportés dans ce texte sont principalement tirés de Pierre Perrault, Cinéaste de la parole, Entretiens avec Paul Warren ainsi que de Pierre Perrault parle de l’Île-aux-Coudres, entretien inclus dans le coffret de la collection Mémoire qui regroupe tous ses films, Office National du Film du Canada.
** Certains des extraits des dialogues de La bête lumineuse sont cités de mémoire, d’autres sont retranscrits. Bien que fidèles au film, il est donc possible que quelques extraits ne rapportent pas mot pour mot l’intégralité des paroles des protagonistes.
*** Hors Champ remercie Joël Pomerleau, de l’ONF (et cofondateur de Hors Champ), pour l’autorisation de reproduire les images de La bête lumineuse. ]]