Journal d’après
(choses vues, oubliées)

Highview (Simon Lui, 2017) (détail)
J’écris après. Alors que déjà se dissipe le souvenir de ces nuits projetées. Que s’émousse ce qui était encore il y a quelques jours, quelques heures, saillant dans la mémoire. La précision de certains rythmes, sensations, bruits, non décantés, revenait simplement. Il faut désormais faire un peu d’effort.
Mais je réalise que le fait d’écrire, de revenir par l’écriture à ce qui s’est joué au cours de ces heures enfouies dans les salles, est aussi une manière de les faire remonter, mieux, de les faire exister, bel et bien (tout en rappelant tout ce qui s’est forcément sans doute perdu à tout jamais, qui ne s’est pas laissé prendre dans les filets du souvenir). Et sûrement autre chose apparaît alors, avec d’autres contours, d’autres traits, d’autres parcours, d’autres saillies, dessinant une autre trame dans la mémoire. Ne pas se demander à quoi tout cela peut servir. Répondre plutôt au désir de voir se prolonger sous une forme scripturaire ce qui échappe précisément à toute écriture (je réalise que, de textes en textes, je reviens sans cesse, comme une obsession, une maladie, au problème, non, mieux, à l’énigme de l’impression).
Voilà toujours, quelques-unes de ces choses retenues, pianotées sur un clavier, retranscrites, mises au propre. Des impressions, à peine de réflexions, encore moins un compte rendu critique, qui n’ont en commun que de s’être imposé à moi, au fil de l’écriture, en y repensant…

Auto Portrait / Self Portrait Post-Partum (Louis Bourque, 2013)
Auto-Portrait Post-Partum, Louise Bourque. 8 octobre, 21h. Cinémathèque québécoise
Vu dans un programme des dits Nouveaux alchimistes (le #3 je crois). Merveilleux sentiment de familiarité et d’étrangeté renouvelée de rentrer dans un film de Louise Bourque. Familiarité et étrangeté redoublée par le fait d’entendre cette voix susurrant des mots qui sont et ne nous sont pas adressés. Ces mots sous la forme d’un impossible adieu à celui qui n’est déjà plus là. Et puis ces éclats vibrants, ces rayures, ces éclaboussures qui forment des cristaux de lumière. Un visage plein cadre, yeux ouverts. Baigné de larmes. Une douleur qu’on dirait sous-marine. Qui se déverse par grandes bouffées, sans possibilité de reprendre le souffle. Des larmes aux angles des yeux, ruisselant sur les joues. Des chansons populaires larmoyantes, en sourdine (Neil Young, Harvest Moon, un blues langoureux, quelques chansons désespérées —on ressent la douleur que l’association génère — dont la pointe acérée se loge dans le cœur). Et à la différence de Self-Portrait Post-Mortem (2002), autre chef d’œuvre de Bourque, où la pellicule était tout à la fois un écrin, un tombeau, un linceul, un masque mortuaire, auréolant et engloutissant un visage revenu d’un temps jadis, aux yeux clos, ici la pellicule évoque il me semble quelque chose d’aquatique, une expérience en apnée, aussi violente qu’elle peut être salvatrice, mais dans le présent d’une douleur qu’il faut traverser, affronter, les yeux ouverts. Avec ce bleu incroyable, profond, nocturne, qui occupe la deuxième partie du film, qui ballote ce corps de douleur en suspension 1 Un œil, grand comme l’écran, contenant toute l’eau du monde. Et toute cette douleur lancée sur le plan — mais l’ai-je rêvé, ce plan ? — d’une maison ancestrale se consumant sous les flammes (est-ce une évocation de cette « maison familiale », qui occupe une place centrale dans l’œuvre de Bourque ?)2 .
Tant de choses qu’il a fallu brûler pour pouvoir sortir de l’eau.

Auto Portrait / Self Portrait Post-Partum (Louis Bourque, 2013)
Je croise Louise quelques semaines plus tard. Je lui mentionne, en passant, un peu timide, que j’ai écrit une petite chose à propos de son film, tout en lui indiquant à quel point mon souvenir est sûrement imprécis, et ma description, peu assurée. Généreuse, elle m’envoie le lien Vimeo et des tonnes d’informations passionnantes que j’ose à peine regarder. Je me promets d’y retourner, mais une fois que le texte sera publié et que je ne serais plus tenté de le retoucher. Je tiens à mon souvenir vague, pour l’instant.
Pourquoi est-ce que le reste du programme m’est complètement sorti de la tête (ou à peu près) ? Quoi, du Hoolboom, par exemple, et des autres films (une route rougeoyante, un volcan, une chandelle qui brûle, une voix lancinante qui lance des injonctions cryptées, etc.) ? Peu de choses demeurent. Qu’est-ce qui explique, plus généralement, cette saisissante volatilité des programmes de films expérimentaux ? L’instabilité du matériel, la difficulté de traduire en termes rationnels ce qu’on a vu et éprouvé (au-delà de la qualité objective des films vus) ? Le haut degré d’abstraction des images, la disparité et la diversité des objets, leur absence de socle commun (surtout sur des durées brèves) rend souvent leur prégnance problématique (combien de fois a-t-il fallu que je voie — pour ne parler que d’exemples canoniques — Anticipation of the Night, Mothlight, Dante Quartet, Chartes Series de Brakhage pour que le mouvement interne du film s’imprime durablement dans ma mémoire ?). Mais cette défaillance de la mémoire est à bien des égards une condition de possibilité de ces œuvres, son exigence : une expérience indissociable de la nécessité de les saisir dans un présent à ce point chargé, qui exige une telle présence, qu’il est toujours un peu condamné à l’évanouissement.
15 octobre, 19h, Quartier Latin
Au dernier soir, à peine remis de l’annulation du Hong Sang-soo (qu’il a fallu rêver, reconstruire au gré des récits emballés des amis qui l’avaient vu plus tôt dans la semaine), devoir choisir. Song of Granite dont on disait le plus grand bien (n’est-ce pas, Olivier ?), sachant que le film jouait du coude avec Le grand silence de Corbucci, qui commençait une petite demi-heure plus tard, dans une autre salle, au même étage. Il s’agissait alors de donner au film 25 minutes pour nous clouer sur notre siège, nous enlever le désir d’être ailleurs. Et peut-être n’a-t-il fallu que trois ou quatre plans pour nous convaincre — à tort, me dirait Olivier — qu’on serait bien mieux assis devant le Corbucci. En terrain plus à l’aise.
Terrible règle que celle du « trois plans » (vous savez, cette idée de Serge Daney selon laquelle si un film ne vous a pas convaincu avec ces trois premiers plans, rien n’y fera, ce film ne sera pas pour vous). Terrible parce qu’infaillible, si on y prête attention. Non pas qu’il puisse y avoir des choses à dire (et même des choses très bien) d’un film qui n’est pas à vous, que vous n’habiterez jamais (comme le Dumont, plus bas) mais je constate fois après fois que cette distance affective, une fois constatée, est sans appel, infranchissable.
Alors, Song of Granite. Pourquoi m’est-il tombé des yeux, ce brave film ? Pourquoi ce noir et blanc trop léché, cette larme perlant aux yeux de la vieille dans une barque, la nuit, cette légère surenchère musicale, ce choix de focal qui joue du joli flou, cette trop grande propreté, ces grands espaces vides, ce mélange d’ethnographie et de trop grand sérieux, m’ont-ils laissé de glace ? Pourquoi soudain ce désir de se retrouver, à ce moment-là, devant une autre définition du cinéma ?

Song of Granite (Pat Collins, 2017)
Il grande Silenzio, Sergio Corbucci. 15 octobre, 19h30. Quartier latin
Réaliser avec une honte perplexe que ce devait être mon premier Corbucci (il n’y a pas d’âge pour rattraper ses errances, et confesser ses manques, même inavouables). N’ayant du coup que très peu de points de comparaison, je ne sais si ce film est exemplaire ou exceptionnel de sa carrière. Il a de toute évidence laissé une empreinte décisive sur des bonhommes comme Tarantino et ses univers de seconde main (et on goûte ce que les connaisseurs de Corbucci — j’en connais une poignée — ont pu à la fois retrouver avec joie ou repousser avec dédain, du bout du pieds, en découvrant The Hateful Eight).



Il Grande Silenzio (Sergio Corrucci, 1969)
La grandeur de ce film est multiple, et totale. La neige, d’abord. Rare dans les westerns (Day of the Outlaw de De Toth demeure sans doute le plus magnifique) et si puissante comme matériau plastique et narratif (plus de joyeuse cavale, tout s’empêtre, hommes, chevaux s’enfoncent, le paysage, le vent sont une menace permanente, les doigts se gercent, oui, tout est plus compliqué, et plus riche du coup). Jubilation du doublage en Italien (entendre les mots « sheriff », « Snow Hill », avec l’accent), décuplée par le fantasme d’une Amérique conçue dans le cerveau et sur les plateaux de Cinecitta (on ne résiste pas au charme de voir ces acteurs dont aucun n’est Américain pointer sur une carte sans sourciller l’état de l’Utah, monter à dos de cheval, tirer du pistolet en prononçant des noms étrangers). Et s’il existe plusieurs westerns dépressifs et désespérés (c’est souvent le propre des crépusculaires, même spaghetti), celui-ci les supplante assez allègrement. La liquidation finale, qui en quelques plans coupe les ailes du héros (le magnifique Jean-Louis Trintignant, dont les pouces viennent d’être torpillés par une tir de pistolet, sorte de Christ muet venant au secours des misérables, et dont la mort ne rédimera personne, surtout pas ceux, par dizaines, ligotés, suppliants, qui seront abattus sans appel quelques secondes plus tard). La violence impitoyable de la loi, l’injustice effroyable de la justice (car toutes ces assassinés le sont « légalement ») atteint dans les dernières minutes du film un assommant paroxysme — avec cet hallucinant Kinski, calme, jamais aussi fou que quand il ne joue pas le fou, avec ces yeux verts globuleux, portant cette extravagante fourrure de femme, dans le cadre de la porte où il vient d’assassiner cette assemblée d’innocents, repartant, impuni, avec sa troupe d’imbéciles, dans le blanc de la neige. Aucun revirement de dernière minute — on a tous rêvé un bref instant à cet improbable sheriff qui se serait extirpé de son tombeau d’eau glacée pour venir jouer les justiciers —, rien pour sauver même une lisière d’espoir. Le film se clôt comme une plaie ouverte.



Il Grande Silenzio (Sergio Corbucci, 1969)
Et puis il y a bien sûr cette cicatrice qui traverse la gorge de Trintignant (« Il ne parlera pas », dit le vilain, en flashback, et on nous laisse imaginer tremblant ce qu’a pu être le carnage commis sur ce garçon, qui venait de voir ses parents assassinés, pour que cette lame puisse atteindre pour les sectionner ses cordes vocales). Et puis il y a aussi cette bouleversante scène d’amour, tout en plans rapprochés, fiévreux, quand on sait déjà que tout est un peu perdu. Et puis. Et puis Morricone a-t-il jamais composé de choses plus belles ?
Étrange a parte mental que le cinéphile est capable de commettre devant les films. Dans Le grand silence, il y a une scène banale, dans une carriole (source avouée d’une scène dans The Hateful Eight), où se retrouvent, tendus, l’un en face de l’autre, le sheriff improbable, Trintignant et, plus tard, Kinski. Un champ contre-champ alterne entre le visage de Silenzio/Trintignant et celui du sheriff qui l’interroge, sans que l’autre ne lui réponde (pour les raisons que l’on apprendra plus tard).




Qu’est-ce qui dans ce champ contre-champ m’a rappelé celui qui apparaît au début de Sicilia! de Straub-Huillet, qui oppose le pseudo-employé du cadastre et le héros du film (et qui forme une scène cruciale et souvent citée du documentaire de Pedro Costa, Où git votre sourire enfoui). Est-ce la moustache, l’hiatus communicationnel entre ces deux personnages, le cadrage serré, la justesse du montage, lle fait que Trintignant ne croit pas un mot de ce que lui raconte le pseudo-sheriff, pas plus que le héros des Staub ne croit un mot de ce que lui raconte son voisin de cabine ? Est-ce aussi le fait que, grâce à cette association suspecte, malgré que tout puisse les séparer, la politique de Straub-Huillet n’est peut-être pas si étrangère de celle de Corbucci dans ce film ?


Sicilia! (Jean-Marie Straub, Danièle Huillet, 1999)
La part du diable, Luc Bourdon. 10 octobre, 19h, Cinéma Impérial
Je dois me remettre dans mes notes, souvent illisibles, indéchiffrables, enchevêtrées, mais nombreuses à propos de ce film. J’y lis : « C’est souvent quand les ressemblances crient que c’est le plus beau ». Ailleurs : « Ce qui unit n’est pas le thème, mais le ton, la couleur, le choc, le contraste. » J’aurais pu reprendre à ce propos, la phrase de Reverdy souvent citée par Godard : « Une image n’est pas forte parce qu’elle est brutale ou fantastique — mais parce que l’association des idées est lointaine et juste. » J’ai noté, à titre d’exemple : « un garçon compte sur ses doigts / plans de mer ». Je ne me souviens pas exactement à quoi cela renvoie, précisément. Je ne retrouve pas exactement l’image, mais je sais que cet enchaînement existe quelque part dans le film, et que c’est bouleversant de vérité.
Entreprise complexe que celle de Bourdon et de son monteur dans ce film (et j’ai très envie qu’on s’assoit pour en parler, bientôt), de façon encore plus frappante que dans La mémoire des anges qui, pour magnifique qu’il était, restait encore trop dominé par un ton nostalgique, absent ici. Le défi aura été de parvenir à faire parler les archives, en se mettant à leur écoute, avant tout. Il s’agit non pas tout à fait de raconter une époque, une décennie de l’histoire du Québec (et du monde, et du Québec dans ces liens au monde) — bien que ce soit aussi le propos, ou le sujet — mais de parvenir à faire flotter l’époque comme un corps en suspension, aérien, accroché à ces lambeaux de pellicule qui voltigent sans direction précise (en échappant, partout, je le disais, au piège de la nostalgie). Le montage va où il veut, et ce n’est qu’après coup, après cinq ou six plans que l’on voit se profiler un principe de rassemblement, toujours provisoire, qui construit autant qu’il débobine la pelote de l’histoire. Comment répondre à la commande sans tomber dans le film à thèse (toujours douteux), l’exposé didactique (pire), l’élégie réactionnaire ou encore le documentaire transparent, où l’archive n’apparaît que dans sa fonction référentielle ? Comment expliquer que le film tout en évoquant un monde (une époque, sa couleur, ses discours, ses grands événements) par le biais de ces archives qui portent la trace de ce monde en voie de disparition, échappe à un ensemble de pièges dont on perçoit sans peine les sillons, les crevasses ? D’où un film fait d’évitements brillants (mais sans compromissions), qui prend les choses de biais, en opérant une série de pas de côté, mais qui fait d’autant mieux résonner l’époque qu’il a su se déprendre de ses clichés les plus pugnaces (et si ces clichés existent dans les films, ils sont traités comme des « images de clichés », non les clichés eux-mêmes, ils sont des signes du cliché, donnés à travers une distance).
Je prends un exemple, parmi d’autres (car il est impossible, et ce serait trop long, de décrire toutes les merveilles, tous les petits miracles que fait remonter ce film). Le discours de René Levesque, le soir des élections de 1976. Chose entendue, dans tous les sens du terme. Incontournable pour une telle entreprise. Mais plutôt que de montrer l’archive directement, l’événement apparaît, de biais, à travers sa retransmission sur une chaine anglophone, par la double médiation de la télévision et de l’anglais. Il en complexifie soudain la réception et le statut au sein du film. Il en va de même pour l’évocation du FLQ et de la crise d’octobre, qui est appelée par une série de plans sur de circulation dans la ville. La voiture devient soudain le véhicule qui nous permet de rentrer, toujours de biais, dans l’événement. Et j’en passe.
Et puis des plans me reviennent, troublants. Car en effet, comment ne pas trembler, devant cette archive (je ne me souviens pas d’avoir vu ce plan dans un film, peut-être le Spry ?), où un journaliste questionne René Lévesque à propos de l’assassinat de Pierre Laporte et que, clope au bec, les traits tirés, la mine déconfite, honteux d’être un homme, agacé par ce journaliste, ne parvient pas à composer une idée cohérente, ne parvient au final qu’à dire : « Fuck. A guy dies, you know… » Rien de plus.
Des jeunes écoliers écoutent Quand on n’a que l’amour de Brel, leur jeune maîtresse pose une main délicate sur leur tête, les invitant au repos. Zachary Richard s’époumonant sur une scène, dans les années 70. La gueule de Charlebois aérien surfant sur Ste-Catherine. Aurais Lalancette devant le paysage abitibien, bleu vert, trempé de pluie. Quelques secondes de Serge Fiori en Californie, le temps que ça pince. La voix de Claude Gauthier. La lueur du kodachrome.
L’image de la forge ouvre et clôt le film. Allégorie d’une fabrique quasi-mythologique (en tout cas mythologisée) de l’histoire du Québec, qui jetait à terre autant qu’elle édifiait (on pense aux incroyables archives de démolitions d’église, mais aussi des nouveautés architecturales aujourd’hui ensevelies, banales, que ce soit l’échangeur Turcot ou le Stade Olympique, encore luisants, etc.). Cette forge, c’est sans doute quelque chose d’une allégorie de la marmite alchimique qui allait entraîner une transhumance morale de toute une société, portée par des corps, des visages, des voix, des musiques, et qu’a cherché à montrer Bourdon. Mais la forge, l’usine, est aussi, sans doute, pour lui, une image de la petite fabrique du film lui-même, son chantier propre, sa table de montage, son usine de transformation de toute cette matière brute, extraite des archives, et qu’il s’agit de transformer à coups de ciseaux, trempées dans le bain fluidifiant du temps qui nous sépare de cette époque et qui irrigue notre regard sur elle.
Comment expliquer aussi, autre mystère, qu’on finisse par oublier les films d’où ces lambeaux sont extraits, que ce soit au final l’archive, elle-même, qui devient le sujet du portrait. Que ce film finalement, au-delà des œuvres singulières, géniales, sublimes auxquelles il renvoie, tout comme aux auteurs qui les ont signées (dûment remerciés), n’est au final par autre chose qu’une plongée, personnelle, subjective, dans l’archive de cette aventure expérimentale, cette forge, cette petite usine sans pareil qu’a été l’Office et tout ce que cet organisme fédéral, empêtré dans sa bureaucratie, ses protocoles administratifs, accroché à un bout d’autoroute, qui bientôt sera coupé de ses racines, a été capable de produire comme regards sur nous-mêmes.
On m’a envoyé un lien Viméo vers le film. Comment expliquer ma réticence à aller vérifier, me replonger, en ce moment, dans le film ? Pourquoi vouloir maintenir le plus longtemps le joli flou qui l’auréole ?


La part du diable (Luc Bourdon, 2017)

La part du diable (Luc Bourdon, 2017)
How we Live, Gustav Deutsch.
Film étonnant, inégal, très personnel (chose rare), naïf aussi par certains côtés, pari risqué (vu avec honte, sur Vimeo, impossible de me déplacer pour la séance en salle). Oui, on peut s’ennuyer un peu par endroits, mais pour ma part, je lui pardonne. Je sais d’où il vient, ce qu’il a fait, de quel processus fascinant le film est né. Je l’imagine — et ça me suffit — avec Hannah en train de visionner ces kilomètres d’images en super8, 16mm ou vidéo, à épingler des moments, des couleurs, des sons (d’ailleurs, je remarque une impressionnante quantité de films super8 sonores dans ce collage). Difficile de ne pas succomber, au delà de tout référent, au bleu, rouge, jaune du kodachrome, à ces plans de caméras désarçonnés, où visiblement la personne tenant l’appareil n’a aucune idée ce qu’il fait (on voit vaguement une famille saluant une autre famille : « ciao nonno, ciao, ciao ») : le sens de ce film (celui de la famille Melchiore), et sa beauté, reposent sur sa simple existence comme attestation de ce qu’il est : une lettre audiovisuelle (avec des fautes d’orthographes, comme toute lettre). C’est, Deutsch le dit bien, la forme la plus pure de ces « messages aux familles ».
Pour ma part, de toutes les archives familiales qu’il dépoussière, pourquoi je ne retiens de ce film que ce court plan, incroyable, où le caméraman zoome in et out en suivant le rythme de la respiration du filmer ? Et puis ces quelques plans de Rimini aux couleurs pétaradantes, qui me donnent mieux que n’importe quel film de fiction, encore une fois, la couleur du temps.
Et puis, tout film digne de ce nom n’est-il pas après tout une carte postale ?
Olivier me dit que non. Et que c’est mieux ainsi.


How we Live (Gustav Deutsch, 2017)
Jeannette, L’enfance de Jeanne d’Arc, Bruno Dumont, 10 octobre, 21h, Cinéma impérial
Difficile de rentrer dans ce film sans inconfort. Pourquoi me trouvé-je incapable de répondre franchement à la question : mais que me veut ce film ? Comment dois-je poser mon regard, dans quelle position du corps ? De quel angle faut-il le prendre pour dépasser l’effroyable ennui mêlé d’imposture qu’il génère en moi ?
Cet inconfort est-il lié au genre de la comédie musicale (genre gênant par excellence, excessif, décalé, souvent débile, mais si souvent époustouflant) ? Tous les films de Dumont — malgré les apparences, quand on y pense — sont travaillés par le problème du cinéma de genre. Le film policier (L’Humanité), le film de guerre (Flandres), le drame mystique (Hadjewitch, Hors Satan), le slasher film (Twenty-Nine Palms), la comédie burlesque (P’tit Quinquin, Ma Loute), le bio-pic (Camille Claudel). Il restait donc la comédie musicale (on pourrait ajouter la porno et la science fiction, mais pour le coup, on aurait vraiment raison d’avoir peur). Une fois la case « comédie musicale » décochée, difficile de savoir exactement, maintenant, quoi en faire. Quel bilan tirer, franchement ? Pourquoi cette incapacité d’adhérer à ce film, alors que j’ai adhéré avec passion à tous les autres ?
Disons ceci. Si Dumont décide d’aborder encore une fois, comme à chaque fois, le genre de biais, de travers, à contre-emploi, la recette relève plus du pari stupide que d’un problème ou d’une nécessité de cinéma : ça passe, ici, par la médiation du théâtre de Péguy (lancinant et redondant comme une rage de dent), de la danse et du métal-pop (musique d’Igorrr, globalement insupportable), des actrices (surtout, peu d’acteurs) non professionnelles (qui donnent ce qu’elles peuvent, et qu’on imagine quelque peu martyrisées par le cinéaste), du décor immuable du Nord, le son direct (pour le chant), lumière naturelle.


Jeannette, l’enfance de Jeanne d’Arc (Bruno Dumont, 2017)
Pourquoi avoir eu le sentiment, tout au long, que Dumont avait succombé, une fois n’est pas coutume, à la tentation de la formule, du pitch : Jeanne d’Arc+ Péguy+comédie musicale+danse contemporaine+musique pop-métal=un laissez-passer pour Cannes. Car au final, le film doit (ou en tout cas gagne à) être vu comme un protocole expérimental, un devoir scolaire, un exercice pédagogique (on sait que tout cela a pris racine au Fresnoy), voire une gageure pour tester la résilience des producteurs et l’aveuglement volontaire des programmateurs de festivals qui se sont retrouvés avec un Dumont, sexy, impossible à refuser. Après tout, on me dira, Dumont a aussi le droit de s’amuser avec ses privilèges ; et on a, à notre tour, le droit de s’ennuyer à mourir devant son film qui nous prend en otage de son exercice de liberté à faire n’importe quoi.
Mais il reste que… ce qu’il peut y avoir de charmant dans ce film de Dumont, malgré tout cela, c’est cette dimension documentaire (jamais absente de son cinéma, mais jamais autant qu’ici, son film le plus artificiel et faux). Jeannette peut être intéressant (mais pas moins insupportable pour autant) dès lors qu’on décide de voir non pas un film, mais la mise en scène d’un tournage alambiqué avec des acteurs en train de lutter avec un texte dense qu’ils ne parviennent pas à habiter tout à fait, de plier et balancer leurs têtes et leurs corps mal entraînés à réaliser des contorsions qu’ils exécutent sans trop savoir à quelle nécessité elles répondent (le gamin, au début, qui demande à Jeannette, possédée par une rage de danse trépidante absurde, « mais pourquoi tu fais ça? », me semble très à propos). Que les corps chez Dumont soient appelés souvent à se déboiter, à ployer sans justification, n’enlève rien à l’embarras que produit la tactique ici (au contraire, l’effet comique de ces corps mal ajustés au monde, cherchant à trouver des postures justes mais complétement folles, était parfaitement jouissif dans Ma Loute par exemple, alors qu’ici, ils sont une démangeaison).
Mais il reste que… c’est aussi, précisément, cette dimension documentaire qui est la plus douloureuse dans le film, puisqu’elle fait apparaître, en négatif, le grand imagier Dumont, derrière sa caméra, se foutant peut-être (ou pas, je n’y étais pas, c’est mon impression) de la gueule de ses pauvres actrices (et par la bande, jusqu’à un certain point, du public) à qui aucune ironie ne semble autorisée, à qui aucune complicité, semble-t-il, n’est permise, n’a été proposée (comme si Dumont avait gardé toute l’ironie pour lui, qu’il voulait pas nous la partager). Ces actrices ne participent pas du délire de Dumont, elles le subissent ; pareil pour nous. Cela n’a-t-il pas toujours été le cas ? Certes, le décalage entre le réalisateur et les acteurs, entre les acteurs et leur rôle, fait partie de son cinéma : décalage entre Pharaon et son rôle de policier, tout comme celui des soldats dans Flandres, du commissaire Machin dans Ma Loute ou celui du P’tit Quinquin. Mais on sentait alors que Dumont, malgré tout, était avec eux (même s’il devait user de stratégies souvent détournées pour obtenir ce qu’il voulait) et même si ces acteurs ne comprenaient pas tout à fait ce qu’on leur demandait, pourquoi on leur demandait, et l’effet que cela produisait, ils semblaient quand même faire partie de l’entreprise. Ils étaient, bon gré, malgré tout, les complices de Dumont, de son désir et de son idée de cinéma. Rien de cela ici. Dans Jeannette, pour la première fois, j’ai eu le sentiment que Dumont avait choisi de les tenir à distance, de leur demander de se débrouiller toutes seules (« faites ceci, dites cela, arrangez vous »), et que ces pauvres actrices, pas actrices pour deux sous, nous offrent non seulement un mauvais spectacle, mais avant tout le spectacle de leur solitude sur le plateau (« aidez-moi, je ne sais pas ce que je fais »).
Pourquoi est-ce que les seuls moments où un effet comique, salvateur, est introduit délibérément dans le film sont des moments où des personnages masculins sont présents (les gamins affamés du début, le personnage de l’oncle, qui font penser, tous deux, aux personnages de Ma Loute, en créant une sorte de respiration) ? Pourquoi les seuls moments où j’ai adhéré au film, sont des moments où Dumont glisse, par la bande, une invitation complice au décrochage ? Je pense, en particulier, aux braiements des moutons qui viennent ponctuer, à plusieurs moments, le pénible chant de cette pauvre petite, de sa copine, des sœurs volantes. Rappel du contexte bucolique de ces petits numéros trop sérieux, mais surtout, brèche sonore dans le tissu des choses montrées sans humour, qui semble nous dire, en a parte : « Ohé, les gars, c’est pas sérieux ce truc, je sais, je suis comme vous, je trouve ça assez ridicule. »
On peut, au sortir de la salle, avec les copains, déplier tout ça. Parler du cinéma de Straub et Huillet, avec qui il peut exister une accointance lointaine ; de Rossellini, de son St-François d’assise (la scène finale, inoubliable, avec les disciples toupies, tournoyant sur eux-mêmes, partant au gré du hasard semer la bonne nouvelle), de son opérette, Jeanne au bucher aussi, avec la grande Bergman. De Bresson et de son indépassable Procès de Jeanne d’arc (se rappeler un beau plan, typiquement bressonien, dans Jeannette, quand la main de Jeanne se plonge, distraite, tendre, pour agripper la laine du mouton, plan qui vaut pour moi tout le film, et tant d’acrobaties inutiles). Autant de choses qui pourraient nous faire aimer ce film peu aimable, où la générosité, la sincérité des actrices ne peut tout à fait faire oublier le braiement du cinéaste qui rigole tout seul dans son coin. Bien, qu’il y reste.

Crossroads (Bruce Conner, 1974)
The Exploding Digital Inevitable, Ross Lipman/Bruce Conner, 11 octobre, 21h, Cinéma du parc
Cette séance aurait dû être une présentation-performance de Ross Lipman, restaurateur, responsable du fonds Bruce Conner. En raison de divers ratés techniques, Lipman a préféré nous présenter une captation de cette même performance, présentée quelques mois plus tôt à Amsterdam (c’était pas plus mal, jusqu’à ce qu’on rencontre, dans la dernière minute de la vidéo, l’inévitable défaillance numérique du lien Viméo, qui n’a jamais pu repartir, et qu’il nous a, plutôt, lu la finale du texte « live »).
Lipman, qui nous avait donné l’an dernier l’incroyable Notfilm, au sujet de l’improbable aventure qu’est Film de Samuel Beckett, proposait ici un cours-essai à propos de Crossroads de Bruce Conner, sans doute son film le plus ambitieux (le seul qu’il a complété en 35mm, sur lequel il est revenu en 2003, qui cristallise à bien des égards plusieurs pôles de sa carrière de cinéaste-plasticien). Exposé magistral prenant à bras le corps, et s’appuyant sur des archives fascinantes, l’appropriation par Conner des images des essais nucléaires de Bikini-Atoll, en 1946. Entreprise complexe, délicate, paradoxale, tout comme l’était cet hallucinant déploiement d’appareils, de pellicule, de savoir-faire militaire et technique pour capter cet événement. Le film de 36 minutes qu’en proposa en 1974 Conner (avec la complicité de Patrick Gleeson et Terry Riley, qui ont composé la musique) demeure un des chefs d’œuvres du cinéma expérimental des années 70.
Enchassé entre les deux parties de sa belle leçon, Lipman nous propose une projection du film, récemment restaurée, en 4k. Le son, remasterisé, cristallin, s’autorisait du remaniement qu’avait introduit Conner dans le film en 2003, et qui ajoutait notamment un son en stéreo. Lipman, à qui j’avais parlé plus tôt, jubilait à l’idée que j’allais découvrir sa nouvelle copie du film (« you ain’t never seen nothing until you see this », semblait-il me dire).
J’ai dû voir ce film projeté au moins cinq ou six fois, en 16mm (à Bologne, à Cinema Ritrovato ; lors d’une projection extérieure de Kabane77; à deux ou trois reprises dans des cours). Des copies passablement rayées, usées par le temps, le son un peu défaillant (la copie de McGill, que je transbahute clandestinement depuis quatre ans… chhhhut, faut pas le dire). Est-ce cela qui explique le sentiment glacial que généra en moi cette projection numérique ? Ce sentiment d’assister à la dissection d’un corps mort ? Certes, on voit et on entend de nouvelles choses (notamment, la première partie, avec le bruitage de Gleeson, qui, tout en révélant la nature synthétique, non naturelle du son “réaliste”, fausse complètement l’expérience voulue par le compositeur, en apparaissant infiniment plus artificielle), mais quel est le gain si le corps restitué ne respire plus, que plus rien ne passe, si tout semble arrêté ? Si ce sentiment du temps qui palpitait dans le film, qui faisait briller chaque parcelle de grain de pellicule, s’est congelé en une masse solide et indifférente ? Toute la tension, au cœur de Crossroads, entre l’immobilité et le mouvement (notamment dans le tout dernier segment), entre la magnitude des explosions et l’expérience de de la durée, est complètement escamotée par la compression numérique, qui ne sait définitivement pas quoi faire avec l’indécidabilité et l’infinie variabilité du film, avec le temps du défilement ? « Video is dead light » avait lancé, sans appel, Brakhage, à Montréal, en 2001 (mais combien de fois avant, depuis) et nous étions quelques-uns à dire oui (tout en trouvant qu’il charriait un peu). Or, cette phrase me revient sans cesse, rappelée par de tels exemples (et on parle d’un cas exemplaire, d’un travail digne et respectueux, magnifiquement mené). Elle fait que je tiens, encore, allez savoir pourquoi, à mon vieux 16mm mono tout rayé.
Je croise Gustav Deutsch, à la sortie.
« What did you think ?
- It thought it was terrible. I hate it when they do such things. »
I can’t disagree.

Granular Film – Beyrouth (Charles-André Coderre, 2017)
Granular Film – Beyrouth, Charles-André Coderre ; Highview, Simon Lui. 14 octobre, 21h, Cinémathèque québécoise
Vus dans un programme des dits Nouveaux alchimistes (le #2 peut-être). Certainement parmi les propositions les plus fortes des programmes de cinéma expérimental, par la force explosive des couleurs, cette rythmique trépidante qui cherche à redonner du sens à une plongée dans une ville étrangère (Hong Kong, Beyrouth), mais tout en brouillant les signes. Le brouillage, l’impossibilité de déceler tout à fait quelque chose, devient alors le signe de la mémoire (la mémoire, c’est l’oubli, le contour flou, ce qui revient et qu’on ne peut saisir). Ce sont aussi deux films qui explorent au plus haut degré les possibilités de manipulation au laboratoire (c’est moins la captation in vivo, que le retour sur la matière captée, qui transforme le voyage en une image). Non sans rappeler, l’un et l’autre, l’extraordinaire Engram of Returning de Daïchi Saïto, chacun de ces films célèbrent tout à la fois les puissances du hasard (les masses de couches de surimpressions délirantes chez Simon Lui ; l’effet du mordençage — technique de manipulation de l’émulsion — chez Coderre) et la beauté explosive de ce qui s’oublie, tout en laissant heureusement des traces3 .
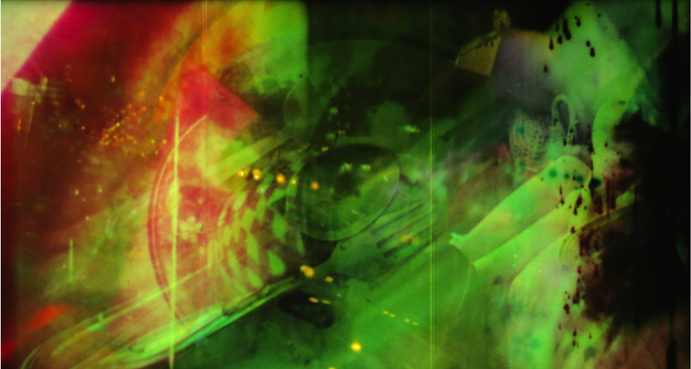
Highview (Simon Lui, 2017)

Phase 4, Saul Bass. 15 octobre, 21h15. Quartier latin
Passer zombie du Silence de Corbucci à Phase IV, film ovni de Saul Bass, sans battement. À 21h15, dernier soir du festival. Comment passer de la neige au désert, glisser, comme ça, de l’Amérique dystopique et sauvage des faux justiciers impunis et des héros martyrs, du sang rouge luisant Ferraniacolor au Technicolor seventies de la science fiction B frôlant le Z, à cette tout aussi dystopique vision en huis clos, symptôme d’une époque paranoïaque virant au cauchemar après le bref espoir des sixties (1974, c’est l’année de Crossroads de Conner, de The Conversation de Coppola, Pasolini s’apprête à tourner Salo, on est un an après La maman et la putain et La grande bouffe… bref, on a les repères qu’on peut), le corps encore lourd, toujours un peu assoupi, se trouvant traversé, passif, par des signes vitaux venant de mondes si contradictoires (même s’ils ont en partage un même cynisme, un même renoncement vis-à-vis du genre humain). Rentrer dans ça, alors. Ces lignes de codes verts défilant à l’écran, ce montage accéléré d’archives scientifiques, rotation des planètes, porté par cette voix détachée, nous déballant tout ça sans vraiment sembler se soucier de nous.

L’humanité est réduite dans Phase IV a une sorte d’abstraction, comme si l’enjeu qui consisterait à la sauver (en la débarrassant de ces terribles fourmis devenues soudainement intelligentes, sociables, organisées entre elles pour prendre le contrôle de l’univers) ne comptait au final qu’assez peu, comme si le film lui-même y croyait plus ou moins. Comme s’il nous disait : bon, au final, un monde dominé par des fourmis, serait-ce si terrible ? Pourrions-nous faire pire ? La musique des synthés sans mélodie, ces innombrables boutons qui n’ont d’autres fonctions que de donner l’illusion que les personnages agissent, vainement, sur le monde des insectes, et les mètres de pellicule consacrés à filmer en macro ces incroyables fourmis, plus réelles et vivantes au final que les personnages exsangues et désespérants du film. Quelques saillies, qui me reviennent : cette main du cadavre dont il faut briser les doigts pour ouvrir la paume, révélant une vilaine plaie d’où jaillissent des bunueliennes fourmis ; la main du savant fou, mordue par une fourmi, enflant au point d’exploser, au fil des plans, qui sombrera hurlant dans un trou de sable suivi par une nuée noire de fourmis qui se lanceront sur lui (imaginez être tué par des millions de fourmis ?) ; ce moment, proprement bouleversant, ou la petite armée de fourmis intelligentes ayant survécu à un assaut, rassemble les carcasses sèches des compatriotes mortes au combat, en rangées bien égales, bien militaires, leur offrant un dernier salut (la ritualisation de la mort comme point de bascule vers la civilisation) ; et puis ces derniers plans, hallucinés, quand le héros traverse un désert pour soi-disant tuer la reine de la colonie (folle entreprise !), le visage strié de morsures rougeâtres, bouffé par le soleil, qu’il s’enfonce dans la fourmillière-égout, se glisse dans un labyrinthe, et retrouve, enseveli sous la sable, dans une image digne de Jodorowski, la jeune femme « préservée » par les fourmis, et qu’il se rend compte qu’il est déjà depuis longtemps contrôlé par les insectes et que c’est à eux, maintenant, qu’il devra répondre (nouveaux Adam et Êve, partis pour repeupler la planète ?). Avais-je bien compris ? Ai-je halluciné tout cela ? Qu’importe. Ce couple de nouveaux humains-fourmis se tenant bras dessous bras dessous devant un désert au soleil couchant (ou se levant), contemplant la liquidation de l’humanité qui vient de se jouer pour nous en quelques plans, sera pour moi une sorte d’image définitive de ce que pouvait le cinéma en 1974.

L’air, dehors, s’était soudain rafraîchi. Le lumière dominicale, joyeusement automnale, vivifiante, quelques heures plus tôt, venait de se transformer en une chape de noirceur et de vent glacial que nous cherchions à secouer loin de nous, les mains dans nos poches, la tête enfoncée dans nos cols, mal couverts, devant le cinéma, rouspétant contre le froid, mais éblouis devant la belle dose de désespoir que nos corps avaient absorbée, riant les dents serrées, le teint blafard, hésitant entre la devoir de dormir que tous nos organes vitaux réclamaient depuis des jours et le désir de voir se prolonger infiniment cette temporalité si particulière de celui qui est en festival.
Merci au FNC.
À l’an prochain.

Phase IV (Saul Bass, 1974)
Notes
- Le film a été réalisé en bonne partie au fameux Film Farm de Phil Hoffman, et la procédure technique ou alchimique pour obtenir ce « bleu » repose sur d’innombrables étapes (Louise me parle de sept étapes au développement). ↩
- Louise m’explique que cette image, trouvée il y a plusieurs années au MIT, à Boston, faisait partie d’une bobine de bandes annonces qu’elle avait récupérée, à l’époque justement où se déroulait l’histoire dont ce film est le deuil (elle ne savait pas alors qu’elle se servirait de ce bout de film). Elle m’explique par ailleurs que chaque son, l’harmonica, le crissement des trains sur les rails, toutes ces musiques évoquent des souvenirs précis à la fois de son enfance, de son père, et de sa relation amoureuse. ↩
- Le film de Simon Lui a été conçu comme une projection-performance (c’est sous cette forme qu’il a été montré à Rotterdam). Quatre projecteurs 16mm : les deux premiers projettent côte à côte, le troisième, au centre, le quatrième, avec une lentille anamorphique, par dessus les trois autres. Il existe semble-t-il une version 35mm scope du film. Le Festival du nouveau cinéma a projeté un DCP, possiblement tiré de ce 35mm (qui était, je dois l’avouer, assez confondant,même pour un oeil averti). ↩
