LA VILLE (2e partie)
III. La ville
« [P]ourquoi la ville, où les êtres se sollicitent avec le moins d’égards, où les rendez-vous et les conversations téléphoniques, les réunions et les visites, le flirt et le combat pour la vie ne laissent à l’individu aucun instant pour la contemplation, prend sa revanche dans le souvenir et pourquoi le voile qu’elle a tissé en secret avec le fil de notre vie montre moins les images des hommes que celles du théâtre de nos rencontres avec les autres ou avec nous-mêmes. »
(Walter Benjamin 1 )
La rue urbaine dans Still (où une profondeur illusoire entremêle et fond les unes dans les autres des figures solides avec leurs doubles fantomatiques) rappelle un article que m’avait envoyé mon ami Yuri Tsvian, un spécialiste de cinéma de Latvia doté d’une perspicacité hors du commun. L’article avait été publié au tournant du siècle dans Rebus, un magazine russe d’ésotérisme. Ce texte, écrit par M. V. Pogorelski en 1899, me trotte dans la tête depuis un certain temps. Pogorelski annonce que (pour citer Tsvian), « la quantité et la multiplicité de reflets que la ville nous présente l’a transformée en un médium naturel de hantise. » Pogorelski appuie sa thèse à partir de la description d’une promenade dans Saint-Pétersbourg à bord d’un trolley conduit par un cheval avec des fenêtres en vitre, une description dont l’imagerie semble épouser celle de Still, Eureka et Shift. Je cite la traduction de Tsvian :
« Dans la vitre opposée on voit la rue réelle ; elle reflète également le côté de la rue derrière le dos de l’observateur. Les reflets du devant et du derrière des fenêtres s’y réfléchissent également ; hormis cela, le double reflet de la portion vraie de la rue observée s’y imprime. Le fait que la voiture elle-même se déplace crée une impression générale particulièrement complexe. Quand le ciel est dégagé et que le soleil brille les objets réels et leurs reflets se confondent, de manière à créer une image féérique, extrêmement complexe et entremêlée…
Les fiacres qui passent ne sont plus unidirectionnels, ils se déplacent de façon chaotique, les uns chargeant ou traversant les autres. Des voitures ou des passants semblent foncer droit devant, mais en même temps, vous êtes conscients du fait que, en fait, chaque pas qu’ils font les fait reculer. Si votre attention se relâche pour un instant vous perdez également le critère qui vous permet de distinguer les objets réels de leur tout aussi vivante apparition. »
Le cinéma de Gehr est profondément enraciné dans le monde tangible et ses lois, et il est peu prompt aux élucubrations spiritualistes. Toutefois, en explorant le travail invisible de ces lois et de ses effets sur la perception, sa minutieuse attention à la façon dont la lumière réfléchit et transforme l’espace — et la façon dont le mouvement forme et recrée notre champ visuel —, tout ceci fait en sorte que ses images évoquent de près le texte de Pogorelski. L’écriture spirite partage avec le travail de Gehr une même découverte de, et une réponse à, la gamme de phénomènes visuels disponibles dans l’environnement urbain moderne.
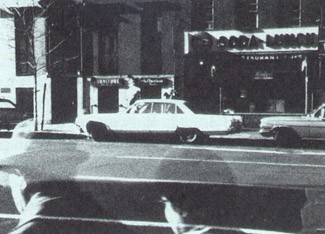
Ernie Gehr, Still, 1969-1971
Je crois qu’Annette Michelson fut la première à avoir identifié le rôle clé que jouait l’environnement urbain dans les films de Gehr. Si cette intuition importante pris autant de temps à survenir, c’est en partie lié au fait que la ville que Gehr découvre est en rupture avec les images de foules et d’animation métropolitaines que l’on retrouve dans la plupart de films dédiés à la ville. On pourrait presque décrire les films urbains de Gehr comme des méditations, tout particulièrement si l’on reconnaît la concentration et l’évacuation de tout but souvent lié à la méditation.
La ville dans les films de Gehr fonctionne en partie comme un laboratoire de perception, où les effets d’ombre et de lumière, des angles particuliers d’espace, le flux du trafic humain et automobile, et les effets du passage du temps s’entrecroisent. Elle constitue également un autre de ces systèmes complexes dont Gehr explore la vie secrète, qui constitue le sommet de ce triangle d’influence réciproque, dont les autres points sont le dispositif cinématographique et la perception humaine.
Pour Gehr, la ville est aussi le dernier endroit où l’on peut essayer de se retrouver soi-même, et où l’on se perd également. S’il existe un dénominateur commun aux films urbains de Gehr, ce sont les marques de signalisation. Ce sont eux qui contrôlent la circulation du trafic : les lignes qui délimitent les voies de la rue dans Still et Shift ; les flèches peintes au sol qui guident les virages dans Side/Walk/Shuttle ; les signaux pour les piétons et les feux de circulation dans Signal – Germany on the Air.
Peu de cinéastes ont représenté à ce point la ville comme un réseau de circulation, une canalisation de flux. Si la ville moderne se construit sur une logique en perspective, partagée entre des centres commerciaux et des grands boulevards en profondeur, Gehr révèle la dimension retorse de cette logique, ses échappées hors des rues principales, la complexité de ses intersections, et les centres multiples que permet de révéler une vision méditative sur la ville.
Si chaque spectateur est appelé à chercher sa place devant un film de Gehr, de la même manière ses films urbains tentent souvent de se négocier une place à travers le système circulatoire de la ville. Ceci est particulièrement vrai de Signal — Germany on the Air où Gehr juxtapose une série de vues prises à partir d’une complexe intersection de rues à Berlin. L’enchevêtrement de points de vue, au fil des plans, semble nous fournir la promesse de pouvoir dresser la carte de l’espace dans sa totalité, de pouvoir nous orienter au final. En même temps, la variété de panneaux de signalisation et la quantité d’objets urbains qui attirent notre attention, au lieu de nous orienter, traduisent au contraire, progressivement, la confusion qui doit être celle d’une personne qui se déciderait à s’arrêter pour contempler cette intersection. Le flux du trafic est souvent perçu dans ses autres films, de la même façon, avec une certaine dose d’effarement.

Ernie Gehr, Signal – Germany on the Air, 1982-1985
La vitesse de la circulation des voitures se fond en surimpositions non seulement dans Still, mais de façon encore plus évidente dans Shift où des voitures, tantôt opaques, tantôt spectrales, avancent et reculent, alors qu’une bande son souvent désynchronisée provoque non seulement l’hilarité, mais renvoie également au fait que la présence du trafic dans une ville est souvent donnée par l’ouïe plutôt que par la vue.
La ville accumule également des couches d’histoire, comme l’illustre le flot du trafic dans Still et Eureka. L’idée que la ville puisse conserver elle-même une mémoire de son passé fait partie des questions ironiques et passionnantes que nous adressent les films urbains de Gehr.
Le rythme saccadé de Eureka fait se superposer de façon presque stéréographique la course pressée de ces citadins affolés, qui s’empressent tous de se rendre urgemment quelque part, et la conscience que nous en avons aujourd’hui, maintenant qu’ils sont figés dans le temps, condamnés à répéter sans cesse cet effort de déplacement. Signal – Germany on the Air soulève la question des spectres de l’histoire de façon encore plus poignante, dans la mesure où certains signaux urbains nous rappellent le rôle qu’a joué Berlin en tant que centre de coordination privilégié d’une guerre industrielle et militaire menée contre le genre humain. Les signes du passé sont-ils encore là, sont-ils tangibles, ou ont-ils disparus ? La question posée de façon ludique par le titre et la forme de Still (Still ? Encore ?) prend ici une tournure plus angoissée.
On se rappellera, au milieu de cette congestion de voitures, à quel point un système de circulation efficace fut fondamental pour l’application de la « solution finale » : l’utilisation élaborée des chemins de fer pour transporter les juifs vers les camps de la mort, voire l’utilisation de chambres à gaz mobile montées sur des camions. Si une telle intersection charrie avec elle aujourd’hui un tel fardeau d’horreurs passées, comment peut-on y échapper ? Et si ce n’est pas le cas, si les traces sont véritablement évanouies et perdues, comment est-il possible sauver quoi que soit ?
Peut-on dire que l’histoire est aussi une question de position, de perspective, c’est-à-dire relevant de l’endroit à partir duquel elle se laisse apercevoir ? Comment m’est-il possible de parler de l’expérience que j’ai vécue alors que, pour préparer la rédaction de ce texte, je visionnais Still pour la première fois depuis des années ? Dans cette salle obscure, j’ai découvert (en plus des mystères de l’espace dans ce film) qu’il était capable d’évoquer pour moi la sensation d’une fin de journée de printemps, dans une rue du lower Manhattan au début des années soixante-dix — une évocation à ce point nette que je pouvais sentir le soleil sur ma peau et les odeurs que produit la ville avec le retour de la chaleur. Une bonne part de l’intensité (et du caractère méditatif) des films urbains de Gehr repose sur cette immersion profonde d’un regard singulier, capable d’être attentif au spectacle de la ville dans ses moments les moins spectaculaires.

Ernie Gehr, Still, 1969-1971
Les films urbains de Gehr donnent l’impression du lieu où ils ont été filmés, un lieu qui nous arrive avec une certaine distance spatiale, un lieu « arrangé » pour la vision. On voit souvent dans Shift, même si on l’aperçoit à peine, la grille d’une fenêtre devant les images. Et le zoom dans Untitled, Part I (1981), peut-être le film de ville le plus subtil et émouvant de Gehr, donne l’extraordinaire impression à la fois d’une observation et d’une mise à distance.
Alors qu’en général Gehr enregistre les aspects les plus impersonnels de la ville, ici il se concentre sur les gestes et la circulation des figures humaines. L’agrandissement produit par la lentille lui permet de capter les détails les plus intimes de la texture de la peau ou de la démarche hésitante du pied d’une personne âgée, tout en demeurant en quelque sorte en dehors de la scène. En documentant les actes périphériques des échanges et des rencontres de ce quartier peuplé par une immigration récente (majoritairement des juifs de Russie), Gehr capture les histoires de déplacements et d’exil inscrites sur les corps des habitants de la ville.
IV. À propos de trois films récents
Side/Walk/Shuttle
Side/Walk/Shuttle apparaît comme le plus spectaculaire des films récents de Gehr, et est certainement un des sommets de ses visions urbaines. En même, son caractère monumental permet d’éclairer la vision plus intimiste de This Side of Paradise et la nouvelle version de Rear Window. Les différences entres ces trois films confirment le fait que le cinéma de Gehr échappe aux classifications, voire à toute tentative de définition simple. Puisque chacun de ces films occupe une place à ce point à part, ils nous permettent de réévaluer l’étendue et l’importance de l’œuvre de Gehr.
L’opérateur des premiers temps qui a tourné les images d’Eureka répondait à une nouvelle technologie urbaine de transport (le tramway) et essayait de proposer une vue qui fonctionnait à la manière d’une attraction touristique. Il filmait une rue animée par des interactions constantes, où à tout moment un risque de collision pouvait survenir, à mesure que les piétons et les bêtes se négociaient un espace entre les véhicules.
Près d’un siècle plus tard, Side/Walk/Shuttle met en scène une technologie différente, révélant aussi une ville différente, même si les deux films ont été réalisés à San Francisco. Gehr a tourné son film dans un ascenseur en verre qui longe l’extérieur d’un grand hôtel. L’ascenseur porte les touristes vers un restaurant luxueux en leur montrant une vue de carte postale. Malgré le fait qu’un visionnement répété du film rend cette modalité du film explicite (le bord de l’édifice et des fenêtres visibles dans certains plans, la structure en arche de laquelle monte et descend l’ascenseur, et qui constituent un leitmotiv tout au long du film), ce n’est pas aussi clair à première vue.
Parvenir à se retrouver dans ce film s’avère particulièrement retors puisque l’espace filmé se déplace constamment, et encore plus parce que l’angle de la prise de vue n’est jamais le même. Gehr n’a visiblement pas abordé ce « petit tour », ni comme une vue touristique, ni comme une voyage expresse vers un restaurant exorbitant, mais comme le lieu d’un labeur intensif.
Il prit l’ascenseur à de très nombreuses occasions, notant les plans et les cadrages dont il aurait besoin, sachant qu’il aurait à travailler rapidement au moment du tournage. Le tournage allait devoir se réaliser au milieu de touristes affamés de bouffe et de panorama, et les postures que Gehr devait prendre pour obtenir ses cadrages durent en faire sourciller plus d’un.
Gehr a dû faire ce travail de concentration intensive de manière clandestine. Les gardes de sécurité comprirent assez vite qu’il n’était ni un résident de l’hôtel, ni qu’il était obsédé par le menu du restaurant, et ils l’ont escorté vers la sortie à plusieurs reprises, de telle sorte que le tournage dut s’étirer sur plusieurs mois. Il est clair que l’acte de tournage de Gehr pouvait être perçu comme une menace à la propriété privée.

Ernie Gehr, Side/Walk/Shuttle, 1991
Le lieu choisi pour tourner le film n’était pas seulement mobile, il servait également de transition entre des espaces plutôt que comme un simple lieu de contemplation, nous rappelant du coup que les lieux privilégiés dans les films urbains de Gehr sont les rues et les trottoirs, des zones de passage. Au-delà de sa fascination pour la circulation, il semble que Gehr soit à la recherche de lieux intermédiaires qui permettent des échappées rapides (même Serene Velocity se déroule dans un corridor).
Bien que seulement deux des quelque vingt plans qui composent ce film comportent des vues sur le skyline de San Francisco, ou une attraction touristique comme le Coit Tower, la majorité de ces images montrent la ville sous des angles peu familiers, et le mouvement de l’ascenseur accorde aux édifices une perspective sans amarres. À aucun moment sent-on que la caméra de Gehr se limite au cycle utilitariste de la montée et de la descente de l’ascenseur, avec ses angles inclinés et ses cadrages renversés qui donnent l’impression que la caméra s’arrache au sol et trace une trajectoire au-dessus de ses constructions humaines. Mais cette impression de fuite aérienne est une illusion temporaire, et le départ ou le retour de l’ascenseur nous rappellent assez rapidement la niche dans laquelle nous sommes confinés.
La géométrie tranchante et angulaire que l’on perçoit de la ville est similaire à celle que Gehr a déjà documentée, même si elle n’a jamais été présentée à partir d’une perspective à ce point « aérienne ». On voit en bas (même si peu de films ont jusqu’ici aboli aussi totalement la notion du haut et du bas) des piétons sur le trottoir, la circulation des véhicules (les voitures dont les couleurs vives à l’occasion surgissent à l’avant-plan, des autobus avec des numéros inscrits sur leur toit, et même un tramway) ainsi que les flèches peintes qui dirigent le trafic de voie en voie.

Ernie Gehr, Side/Walk/Shuttle, 1991
Mais c’est au premier chef l’élévation des édifices qui est transformée par ces courts voyages ascendants ou descendants. Au niveau le plus simple, les parcours verticaux de la caméra dessinent la perspective changeante de ces structures quadrilatères : les lignes orthogonales s’étirent et changent d’orientation, les toits et les murs renversent leur ordre dans le cadre ; les dimensions sur l’écran se rétrécissent, s’agrandissent, et se rétrécissent à nouveau ; des immeubles s’éloignent pour révéler des panoramas jusqu’à là masqués.
Le cadre est à ce point rempli de changements que l’on oublie à un certain à quoi ressemblent en réalité ces formes mouvantes. Comme une leçon de choses sur les fluctuations de la perspective, Side/Walk/Shuttle met en scène un conflit permanent entre ce que l’on sait (ou pense savoir) à propos de ce qu’on voit, et ce que nous avons effectivement devant nous à l’écran.
Alors qu’un point de vue mouvant à une telle hauteur procurerait inévitablement un plaisir visuel (en particulier si on n’est pas en train d’essayer de reconnaître un paysage touristique familier), la caméra de Gehr dessine ses trajets afin de maximiser les effets de défamiliarisation. La caméra adopte une telle multiplicité d’angles à l’intérieur de cet espace restreint, qu’on pourrait soupçonner Gehr d’être un contorsionniste. Tout comme dans Serene Velocity, l’illusion surgit dans les endroits les plus rationnels. Les immeubles semblent moins passer devant la caméra que jaillir et s’étirer, comme la vue miraculeuse de la croissance d’un champignon, filmé en pixillation.
Souvent la cime d’un édifice semble pointée vers la caméra, comme si elle se déplaçait latéralement à travers l’espace, un vaisseau interstellaire gigantesque flottant au-dessus d’une ville futuriste. Le mouvement vertical constant combiné avec ce type de cadrage donne l’impression de renverser l’impression de gravité et de poids, avec l’architecture qui flotte de façon sereine devant nous.
Cet effet de désorientation m’a procuré la plus forte sensation de voler qu’il m’a été donné d’éprouver au cinéma, rappelant ces vols sans efforts que l’on fait dans les rêves, lorsqu’on transgresse les lois terrestres. Mais Gehr nous ramène à chaque fois à la dimension illusoire de cette liberté, nous rappelle le fait qu’elle est fabriquée par la caméra, nous rapportant à la vue obstruée de l’arche de l’entrée de l’immeuble dont les flares de lumière à la fin des plans nous procurent des brefs moments de repos visuels.
Mais la magie n’en est pas atténuée. Les choix de cadrage mettent souvent notre sens de l’orientation sens dessus dessous, et quand Gehr nous présente littéralement une image renversée, de telle sorte que le haut des édifices apparaisse en descendant à partir du haut de l’image pour s’enfoncer dans un ciel bleu, on fait l’expérience d’une liberté aérienne qui rappelle l’enthousiasme pour l’aviation manifesté par l’avant-garde dans les années vingt — Blaise Cendrars et El Lissitzky.
Dans un des plans, Gehr parvient à placer sa caméra de telle sorte qu’un édifice brun demeure presque stationnaire dans le cadre tout au long du plan, tandis que le changement de perspective et de distance font subir à l’édifice une étrange métamorphose, étirant et pliant les bords tranchants de ses côtés.
À d’autres moments, Gehr a fait pivoter la pellicule pour obtenir un cadre particulier, ce qui a pour effet d’inverser le mouvement, de telle sorte que le trafic dans la rue se déplace à reculons. On se rend compte alors de la profondeur de notre désorientation, particulièrement quand on se rend compte que les cadrages des plans où le mouvement est inversé ne sont pas radicalement différents des autres. Devant ce film, nous faisons l’expérience d’un monde possédant ses propres lois.

Ernie Gehr, Side/Walk/Shuttle, 1991
Gehr a relevé le fait que la prise de vue de l’ascenseur dans son film était située tout près de l’endroit où Eadweard Muybridge avait tourné un panorama de San Francisco, il y a plus d’un siècle. La photographie panoramique illustre bien le désir du XIXe siècle de circonscrire la totalité du monde visible. Les études du mouvement que Muybridge réalisa quelques temps après (et qui ont ouvert la voie au dispositif cinématographique) étendaient cette curiosité visuelle au phénomène du mouvement et à la mesure minutieuse du temps.
Gehr semble littéralement planer sur ce désir moderne bien répandu de voir et de cerner le visible en une image cohérente et compréhensible. Toutefois, son dispositif cède la place à une image plus fragmentée, elle ne peut pas servir à la cartographie et à la surveillance comme les différents types de panopticons de l’âge moderne. Gehr s’attaque néanmoins à ce désir de la modernité de contrôler de vastes étendues et de dominer tout ce qui est sous ses yeux. Tout comme l’espace urbain dans Signal – Germany on the Air évoquait le système des nazis, la perspective aérienne de Side/Walk/Shuttle évoque aussi les ambitions impériales de la diplomatie des « navettes spatiales », en particulier quand les gratte-ciels apparaissent comme des vaisseaux planant au-dessus d’un domaine urbain, avec les tours d’eau et les bouches d’aération brillant au soleil comme autant de mécanismes d’une navette.
La rumeur en son synchrone du vent sur un microphone semble s’apparenter pour un moment au grondement d’un moteur puissant, redéfinissant encore plus profondément la façon dont Gehr est capable de transformer le champ visuel par une utilisation complexe du son. Ce film partage avec Signal – Germany on the Air une bande son fort élaborée qui élargit la portée spatiale de ses images.
Le titre Signal – Germany on the Air nous encourage à écouter la bande son comme s’il s’agissait d’une radio-diffusion, et effectivement une bonne part fut enregistrée à la radio. Dans Side/Walk/Shuttle la dimension spatiale du son naît initialement de sa contradiction avec la verticalité de l’image. Plus souvent qu’autrement, ce que l’on entend sont des sons captés au niveau de la rue, principalement des bruits de pas, de trafic, du tramway ou du métro, auxquels se mêlent des conversations de trottoirs. Le retour régulier du martèlement ou du bruissement des pas — à la traction et à la gravité rassurante —, contraste avec l’apparente apesanteur de la caméra. Les sons sont proches et familiers et les voix que l’on entend ont un aspect bien « terre à terre ». Toutefois, on soupçonne assez rapidement que les sons proviennent de bien plus loin que la rue en dessous de nous.
Les premiers sons que l’on entend sont des bribes de conversation étouffées qui pourraient venir de l’ascenseur (même si rien dans le champ visuel ne permet de le confirmer). Puis, après un moment de silence, on entend la rumeur d’un restaurant ou d’un déli avec des serveurs qui prennent les commandes, ainsi que le cliquetis des assiettes.
Il ne faut pas être un New-Yorkais particulièrement chauvin pour savoir que cet assemblage particulier de bruits ne peut venir d’aucune autre ville. D’autres sons signalent une origine étrangère, comme l’accent britannique d’un vendeur de T-Shirt haranguant des passants sur la rue.
Les sons dans ce film proviennent de plusieurs lieux lointains, et pas seulement de New York et de Londres, mais aussi de Venise et Genève. Même si je ne peux prétendre reconnaître le claquement spécifique d’un talon dans une rue de Venise, ou la différence entre le tintement de la cloche d’un tramway en Suisse et à San Francisco, je crois que l’on reconnaît sans peine que les sons de ce film viennent d’au-delà de son environnement immédiat, créant ainsi une série de liens qui nous entraînent dans des endroits éloignés, mais aussi dans des espaces purement psychiques.
Le son des oiseaux et d’un avion lointain qui accompagnent certaines vues du ciel et de la baie de San Francisco ont été enregistrés, je crois, dans une cour arrière à Genève, mais de façon plus importante, ils font en sorte de transformer ces immeubles en de gentils habitants de l’air.
This Side of Paradise
Les forces de circulation que les villes créent (et qui créent les villes) s’étirent bien souvent au-delà des limites de la ville, déplaçant les gens autant que les marchandises. Parvenir à trouver sa place, un processus absolument fondamental du cinéma de Gehr, prend un sens littéral dans des films comme Signal – Germany on the Air, qui renvoie à l’expérience de Gehr cherchant à s’orienter en tant qu’étranger Berlin, ou Untitled, Part I (1981) qui montre des nouveaux immigrants échoués sur les rives de Brighton Beach.
This Side of Paradise est concerné par un autre type de circulation des gens et de leurs marchandises à travers les frontières et les circuits organisés d’une grande ville.
Gehr était à Berlin Ouest en 1989 pour enregistrer des sons pour un film, lorsqu’il tomba sur un marché aux puces improvisé où des Polonais venant du bloc de l’Est, en visite pour la fin de semaine, tentaient de vendre divers objets qu’ils avaient amenés avec eux afin d’obtenir de la monnaie occidentale, qu’ils pouvaient ensuite échanger sur le marché noir chez eux en faisant un profit appréciable.
Ironiquement, à peu près immédiatement après que Gehr ait croisé cette forme plutôt attristante de circulation monétaire, l’Allemagne fut réunie et le mur de Berlin s’écroula. Ce petit groupe de gens accroupis au bord d’une immense flaque de boue et qui, comme Gehr le dit, « vendaient leur misère », était le produit du Mur, de la construction de frontière entre les idéologies et les systèmes économiques qui (pour abstraits qu’ils puissent paraître) ont des conséquences tangibles et visibles.
L’histoire familiale de Gehr — réfugiée et immigrée durant la Seconde Guerre mondiale —, a sans doute aiguisé sa conscience de la précarité des lieux d’appartenance, dans un monde sujet à des violents soulèvements et aux redistributions des frontières. L’ironie liée au fait que de tels murs peuvent exclure et transformer un endroit en le divisant en des zones séparées, donne un ton amer au titre de Gehr. Pour ces réfugiés économiques en vacances, l’Ouest est une sorte de paradis artificiel, et ils espèrent pouvoir échanger leurs assemblages improvisés de marchandises pour amener avec eux un petit morceau portatif de paradis financier de l’autre côté.
À la difference de Side/Walk/Shuttle, qui fut précédé d’une longue préparation avant le tournage, The Side of Paradise a été filmé et le son a été enregistré comme une réaction spontanée à la découverte de ce site, et la quasi totalité des images tournées ont été utilisées (le film est presque entièrement monté « in camera », directement au tournage). Le filmage de Gehr témoigne de cette immédiateté (souvent il ne regardait pas dans le viseur) et il se déplace dans la foule avec une proximité qu’aucun autre de ses films ne possède. Les sons émanent naturellement du lieu, en majorité des conversations dans une sorte de polonais-allemand. Le son n’est pas synchronisé, malgré le fait que le couplage minutieux du son et de l’image crée à l’occasion des effets étonnants (comme quand un étrange bruit métallique accompagne le mouvement d’une onde s’étendant dans la flaque de boue).
La nature aquatique du site est particulièrement fascinante. Cela donne l’impression que les transactions dans ce marché y sont particulièrement pénibles. Pour reprendre l’expression de Gehr, il semble que ces gens sont en train de « suinter hors de l’eau ». Vu de la sorte, ils apparaissent comme des êtres liminaux, voguant d’ici et de là selon les courants du monde, comme ces canettes et ces mégots de cigarette flottant dans les flaques autour d’eux.
Gehr était étonné par l’indifférence avec laquelle ils se tenaient debout dans l’eau, et même y plaçaient leurs marchandises à vendre. Dans les plans de Gehr, l’eau devient la surface d’un autre monde, un double aquatique qui mime et se moque même du monde au-dessus. À plusieurs reprises, Gehr opère des cadrages sur ces réflexions nées dans la boue qui ne permettent pas de distinguer à première vue si on regarde le monde ou son reflet.
Tout comme dans Side/Walk/Shuttle, notre sens de l’orientation entre le haut et le bas est souvent renversé, les reflets apparaissant à l’envers (parfois cela semble être dû au fait que la caméra est tenue à l’envers, à d’autres moments le mouvement inversé indique plutôt que c’est la pellicule qui a été retournée). Dans certains plans les individus semblent percher par-dessus leurs doubles liquides, le talon d’un homme dans l’eau clonant une autre paire de jambes et un torse en dessous de lui.
L’étonnante solidité et la vivacité des couleurs de ce monde inversé apparaissent dans leur intangibilité éphémère quand une ondulation de l’eau (comme celle causée par la roue d’une poussette de bébé) dissout l’image dans son flux. Et néanmoins ces images reflétées ne sont pas moins éphémères que le monde au-dessus, ou la collection émouvante, absurde et abjecte de pacotilles qu’ils essaient de vendre : un sapin de Noël miniature, des bouts d’habits, un abat-jour, des rouleaux de ruban, des foulards, des horloges, des jouets.

Ernie Gehr, This Side of Paradise, 1991
Ce monde renversé, où l’on voit un oiseau voler à travers le ciel dans une flaque au-dessous, nous rend inconfortable, comme devant les premiers plans de La grève d’Eisenstein, qui nous montre également des images inversées de l’usine dans la flaque de boue de la cour de l’usine.
Ces habitants d’un monde divisé dont les frontières étaient sur le point de s’effondrer rappellent ce mythe chinois que décrit Borges dans son Livre des êtres imaginaires. À une époque, selon ce mythe, le monde des reflets et le monde des vivants s’interpénétraient et les deux sortes d’êtres pouvaient traverser les miroirs. Mais une nuit les êtres-reflets envahirent le monde des vivants. Après une bataille sanglante, l’Empereur remporta la victoire et les reflets furent emprisonnés derrière leurs surfaces de verre et furent condamnés à imiter les actions de leurs doubles humains. Toutefois, un jour viendra où une révolte surviendra, et peu à peu les reflets cesseront d’imiter nos actions et traverseront éventuellement leurs frontières. Juste avant cette invasion, on entendra un entrechoquement d’armes surgir des profondeurs de nos miroirs.
Rear Window
Montré il y a quelques années dans une version muette, Rear Window réapparaît aujourd’hui dans une version sonore (avec apparemment quelques légers changements dans les images). Il serait difficile d’imaginer un film plus différent que Side/Walk/Shuttle, tant du point de vue de son échelle que de son effet, bien que plusieurs des questions liées au fait de se trouver dans un univers visuel urbain se retrouvent ici, mais sur un mode différent.
Peu de films de Gehr sont aussi beaux, aussi délicats que celui-ci. Avec une lentille à longue focale il explore une forme de vision qui est plus voyeuriste que dans la plupart des œuvres urbaines de Gehr, même si la distance magnifiée par la lentille rappelle la douce pénétration du monde de Untitled et sa prise de vue à partir d’une fenêtre donnant sur une sortie d’évacuation peu s’apparenter aux vues de fenêtre de Shift. Mais à la différence des vues sur le trafic ou le trottoir que l’on retrouvait dans les autres films, cette « fenêtre sur cour » est tournée vers l’autre côté de la vie… là où les gens accrochent leurs habits à sécher.
La caméra de Gehr se penche sur la vision la plus quotidienne qui soit et révèle une dramaturgie de lumière et d’espace aussi éblouissante que les paysages urbains de Side/Walk/Shuttle. La lumière fonctionne comme un sujet plutôt que comme un médium (même si Gehr n’a jamais utilisé la lumière comme un simple éclairage) : les objets que nous reconnaissons pendus à la corde à linge surgissent d’un flux de lumière. Bien que l’étude des textures de la lumière s’approchent, plus que dans tout autre film de Gehr, du travail de Brakhage, la comparaison ne rend que plus éclatante ce qui le distingue de la vision de Brakhage.
Ces images lumineuses ne donnent pas lieu à une association libre de montage à l’ambition encyclopédique. Plutôt, même dans un film aussi libre que celui-ci, où les limites entres les plans sont difficiles à déterminer, Gehr épuise méthodiquement les possibilités du visible en se concentrant sur le matériau devant lui, à partir d’un seul point de vue fixe.
Une barre de métal de la sortie d’urgence d’où Gehr a réalisé le film demeure visible dans plusieurs plans (même si elle est souvent presque transparente en raison du plan focal de la lentille), et nous ancre solidement à un point de vue à partir duquel nous observons un monde constamment en train de changer.
La lumière n’est pas qu’observée ici. Gehr, littéralement, moule l’univers que l’on voit devant la lentille avec ses mains. Ses doigts agissent souvent comme des caches, obstruant une partie ou la totalité de la scène, et rappelle ces films que nous nous créions avec nos mains quand nous étions enfants, par des journées ensoleillées, lorsque nous regardions les choses à travers l’espace de nos doigts, ou en agitant les mains près de nos yeux afin de dématérialiser le monde solide.
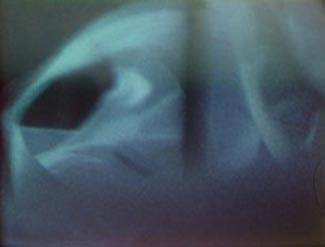
Ernie Gehr, Rear Window, 1986-1991
La longue focale fait en sorte que les doigts de Gehr sont dans le noir, en d’autres mots le dispositif qui crée l’image n’est pas très clair. Les mains de Gehr cadrent ce que l’on voit à travers elles, et en même temps elles forment et transforment la lumière elle-même. Gehr a employé une pellicule « intérieur » (tungsten) pour tourner ces plans d’extérieurs et à l’occasion a laissé de côté le filtre orange souvent employé pour équilibrer la lumière froide et bleutée de la lumière extérieure. Tout au long du film, les mains de Gehr servent à réchauffer la lumière, qui nous parvient à travers la chair et le sang, en produisant une teinte qu’aucun filtre industriel ne pourrait égaler.
Cette lumière tenue à la main permet de créer un rapprochement entre Rear Window et l’autre film de Gehr qui pour moi possède la même beauté et la même délicatesse, Mirage, dont j’ai toujours pensé que les rayures de lumière avaient été produites (comme les striations de Field) par le mouvement rapide de la caméra. En fait, la caméra de Mirage est fixe et les distorsions sont dues au fait que la lentille avait été remplacée par un tube de plastique. Alors que les couleurs de ce film venaient d’objets réels (y compris le bleu du ciel), et la distorsion en bandes non identifiables du tube lui-même, les transformations provenaient principalement des mains de Gehr qui recouvraient le tube de plastique, donnant une forme à la lumière avant qu’elle passe à travers le dispositif du film.
Les films de Gehr évoquent souvent le travail pictural. Ses recherches sur la couleur et l’espace partagent certes les interrogations de plusieurs artistes visuels. Mirage m’a souvent fait pensé aux bandes de couleurs de Kenneth Noland. Mais de telles comparaisons formelles (comme celles qui ont fréquemment comparé Serene Velocity aux peintures géométriques de Frank Stella) ont quelque chose de superficiel, puisque Gehr explore un processus qui constitue une part intégrale du médium filmique : l’image formée par la lumière et le mouvement, et non de la peinture sur une toile.
Ceci étant dit, Rear Window me semble profondément lié aux peintures de Morris Louis, même s’il ne ressemble aucunement à un tableau de Louis, mais plutôt parce qu’il livre une même expérience de voilement et de lumière. Comme dans une toile de Louis, un flot de lumière semble se fondre et survoler au-dessus d’un support en tissu, tout comme le froissement du vent dans les images de Gehr qui agitent les couleurs et les tons de lumière tombant d’une fine pellicule, entr’aperçue à travers un cache de chair.
Gehr a toujours raconté qu’il concevait Rear Window comme un film sonore, et a passé un long moment à recueillir des sons qu’il croyait seraient appropriés (y compris lors d’un voyage qu’il fit à Berlin, croyant qu’un son qu’il avait entendu là-bas un son qui pouvait cadrer avec ce film), mais aucun des sons qu’il n’avait collecté ne le satisfaisait. Même si la bande son qui désormais épouse ce film est peut-être moins élaborée que ce qu’il avait initialement imaginé, il serait difficile d’imaginer quelque chose d’aussi approprié.
À mi-chemin du film, après que nous ayons suivi notre exploration de la lumière et de ses vicissitudes en silence pendant plusieurs minutes, le bruit du vent sur un micro produit un son aussi brutal que celui du tonnerre, tandis que les habits sur la corde a linge sont secoués par le vent, au point de souffler presque transversalement au travers de l’écran. Cet orage de lumière crée une frénésie quasi-sexuelle, tandis que la lumière réchauffée adopte une tonalité de plus en plus charnelle.
Lorsque notre vision s’est calmée, on voit apparaître un des plans les plus nets de tout le film, avec une serviette et une chaussette à bordures rouges suspendues mollement sur la corde. Sur une amorce noire, le son se poursuit pour un bref moment.
Dans Signal – Germany on the Air, Gehr avait monté un bruit de tonnerre réel avec de l’amorce claire, afin de créer un éclair artificiel. Cet orage-ci vient d’une combinaison non littérale entre un son et une image, un mixte audiovisuel qui à la fois renvoie à un événement réel et en même temps se refuse à le recréer (le son de l’océan, à peine audible dans Rear Window, enterré par le grondement du vent, nous assure que le son n’émane pas simplement de l’image). Aussi puissant que cet orage puisse apparaître, il est le résultat de l’ingéniosité et de l’imagination. Cet orage n’a pas eu lieu ; Gehr a simplement associé des plans traversés de mouvements avec ce son éclatant.
Ici encore, Gehr a créé un entrecroisement entre les processus du médium et le jeu d’échange entre le monde et la perception. Dans cette vue sur une cour arrière à Brooklyn, on trouve un lieu où le cinéma s’ouvre à un monde de lumière et de mouvement, dévoilé au milieu d’une lessive quotidienne.
(Traduit de l’anglais par André Habib)
Notes
- Walter Benjamin, « Chronique berlinoise », dans Écrits autobiographiques, Paris, Christian Bourgois éditeur, coll. « Choix essais », 1990, p. 284 ↩
