L’OEIL DÉMONIAQUE
« [L]e mot “démon” me fait penser aux équations de Maxwell, à la fin du XIXe siècle, que la mécanique quantique, ensuite, a résolues par la théorie en montrant qu’une particule peut être à deux endroits à la fois, et que si, d’un troisième endroit, on observe la vitesse de cette particule, qui pourrait être un photon, on ne peut savoir où elle se trouve. C’est ce que j’appelle le vrai champ/contrechamp, qui est une figure connue du cinéma mais qui n’a jamais été utilisée comme telle. On a utilisé un autre champ qu’on appelle contrechamp, mais en réalité ce n’est pas cela. Et Maxwell se demandait comment on pouvait ainsi passer d’un endroit à un autre. Il ne trouvait pas la solution théorique. Il a donc appelé ce transfert le « démon ». C’est resté dans le jargon scientifique comme le « démon de Maxwell ». Ce qui est étrange, c’est qu’il a appelé cela le démon et pas le saut de l’ange, par exemple 1 » (Jean-Luc Godard).
Il y a quelque chose de terrible dans la fin de Saddam Hussein, comme une résonance primaire qui marque le début (ou la fin) de quelque chose. Filmer la mort d’un homme, fut-elle projetée en différée, fut-il un dictateur, se pose incontestablement comme une des limites de la représentation. Question d’éthique et de dignité.

Que se soit pour l’histoire, ou comme gage de vérité, était-il nécessaire de montrer publiquement la mort de Saddam Hussein sur les écrans ? Les autorités irakiennes, à l’instar de toutes les télévisions du monde, ont jugé qu’ils devaient montrer une « version officielle » de cette exécution, à heure de grande écoute : « l’exécution a été filmée et si Dieu le veut sera diffusée. Il y avait une caméra présente, et un médecin était présent aussi (sic) 2 ». En d’autres termes, la dignité d’un homme ne se joue pas dans l’acte même de filmer et cette image ne souleva que peu de critiques. Or, avec la diffusion d’une « vidéo pirate » filmée à l’aide d’un téléphone cellulaire sur Internet une trentaine d’heures après la première, l’opinion publique internationale s’est unanimement indignée de l’horreur de l’exécution. D’un jour à l’autre, les porte-parole du gouvernement américain sont passés d’une victoire sans appel pour la démocratie, à une désolidarisation (prudente, mais effective) : « si vous me demandez si nous aurions fait autrement, oui […] Mais ce n’est pas de notre ressort, c’était une décision du gouvernement irakien 3 ». Ainsi, pour les journalistes et les officiels, américains, irakiens ou anglais, c’est entre ces deux images, l’une « officielle », l’autre « pirate », que la dignité de Saddam Hussein s’est perdue.

Des deux vidéos enregistrées au même moment, au même endroit, l’une serait conforme à l’idée de « démocratie » naissante en Irak et l’autre en serait indigne, voire barbare. De fait, le scénario de la fiction globale Saddam Hussein, débutée il y a trois ans, n’avait pas prévu de contrechamp, et les indignations suscitées par la version Internet, ne font que mettre en exergue les stratégies de mise en scène généralisée du réel, telles qu’elles se définissent quotidiennement dans l’institution médiatique.
Le fait est que la « version officielle » ment sur 1 min 12. L’image et les couleurs sont parfaitement claires, le son synchrone a été coupé au profit d’un commentaire journalistique, posé, explicatif et rassurant. Le cadrage à la poitrine est soigné, la caméra ne bouge presque pas et panoramique légèrement en scrutant lentement l’espace. La vidéo se termine au moment où la corde est passée autour du cou du condamné. Durant 1 min 12, malgré les cagoules, malgré l’aspect sordide du lieu et de l’événement, la réalisation appelle au calme, elle dit que tout est sous contrôle, que ceci n’est qu’une formalité. Sans la vidéo « pirate », il est probable que cette image aurait été la dernière de Saddam, celle d’un dictateur qui a accueille dignement son sort.

La deuxième vidéo est venue apporter un autre discours. Bien que filmés pratiquement du même point de vue (en retrait environ à 100° à gauche) les deux enregistrements disent exactement le contraire. La vidéo dure 2 min 37, le son, imprécis et bruyant, laisse entendre des cris de haine. Quant à l’image, elle ne répond presque plus du réel, le cadrage est chaotique, inexistant, en très gros plan. On voit à peine Saddam Hussein tombé dans la trappe. L’ambiance est glauque et les couleurs très sombres. Quelque chose de proprement monstrueux se produit. Quand le dictateur tombe, les cris s’intensifient, tandis que le téléphone portable bouge de plus en plus, avant qu’il ne finisse pendu à l’image, balancé entre le noir total et des flashs blancs striés de rose.

Au terme de cette comparaison, peut-on vraiment affirmer qu’il y a une vidéo plus digne que l’autre ? La question est ouverte. Par-delà cette capacité à désorganiser l’entreprise de falsification de l’expérience (Serge Daney), il y a en germe, dans cette vidéo « pirate », un phénomène inédit à l’égard de l’actualité médiatique, pour nous, spectateurs, « complices et adversaires », qui regardons ces images 4 .
Godard, dans Notre musique (2005), propose une définition du « vrai » champ/ contrechamp, où ce qui se jouerait dans le rapport entre les images ne serait pas une question de positionnement physique dans l’espace (mise en scène et déplacements des personnages) mais un rapport politique. Pour lui, le « vrai » champ contrechamp, tracerait sa ligne sur l’Histoire, pour capter (par l’image) le croisement, le nœud, entre deux postures idéologiques différentes 5 .
De ce point de vue, en quoi peut-on dire que la 2ème vidéo se pose comme un contrechamp de la première. Et, si la première image représente la position officielle des medias et du pouvoir, quelle est la voix de la seconde ? Qui en est l’instigateur, de quelle nouveau « pouvoir » dépend-elle ?
Par-delà sa facture sauvage, filmée à bout de bras, sans « point de vue », c’est l’effrayant anonymat de cette image qui semble le plus marquant. Dans un huis clos et parmi seulement une vingtaine de personnes, les autorités n’ont pas été en mesure de désigner avec certitude l’identité du filmeur. De même, la vidéo a été diffusée en toute indifférence sur Internet, à côté de la masse abondante des autres images qui pullulent sur Youtube. Peut-on y voir là la manifestation d’une « nouvelle image », née de l’association entre les appareils cellulaires et Internet, une image à la fois (hyper)personnelle, brute et totalement anonyme ?
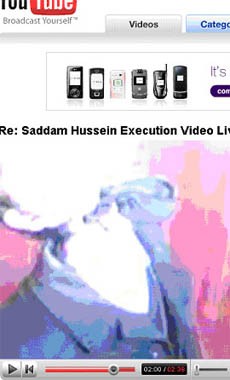
S’il est évident que la première vidéo s’inscrit dans l’institution médiatico-étatique, la deuxième vidéo s’est révélée comme un défi à l’institution télévisuelle (qui n’a pas osé la montrer en son entièreté) et aux pouvoirs politiques (qui ont dû revoir leur position « officielle »), comme si cette image représentait un « regard maudit », dénué de contrôle, se propageant comme un feu de poudre sur Internet. Quoiqu’il en soit, il suffira de prendre conscience du fait qu’un seul individu, doté d’un cellulaire et d’une connexion Internet, a été en mesure d’ébranler, pendant quelques jours, la solide charpente des institutions, en nous permettant d’entr’apercevoir le contrechamp d’un événement historique et médiatique.
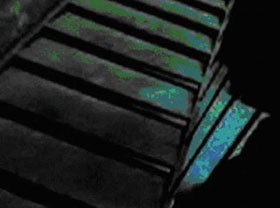
Notes
- Rencontre entre Jean-Luc Godard et Elias Sanbar sur la scène nationale le Volcan au Havre, [url=http://www.politis.fr/article1213.html]http://www.politis.fr/article1213.html[/url] ↩
- Agence Reuters, Agence France-presse et Associated Press, Le Devoir, 30 -31 décembre 2006. ↩
- « Une vidéo pirate qui devient affaire d’état », Agence France-Presse et Reuters, Le Devoir, 4 janvier, A5 ↩
- « Chacun de nous sommé par le spectacle d’y prendre part, en sera acteur et spectateur, consentant et non consentant, complice et adversaire à la fois. »( Raymond Bellour, « cinéma documentaire et innocence du regard ») ↩
- Il prend pour exemple deux photos, l’une d’un groupe d’Israéliens débarquant en bateau en terre de Palestine ; l’autre, montrant des palestiniens fuyant par la mer. Pour Godard, les Israéliens pénètrent dans la fiction, tandis que les Palestiniens entrent dans le documentaire. ↩
