Le plongeon (II)
Sur The Swimmer (1968)

Il y a quelques jours, en discutant avec René de mes histoires de plongeon et de piscine, il me parle d’un film que je ne connaissais pas, The Swimmer, avec Burt Lancaster, réalisé en 1968 par un obscur cinéaste du nom de Frank Perry, à la filmographie complètement échevelée et je soupçonne globalement déprimante (il finira dans le purgatoire de la TV dans les années 80, avec des téléfilms oubliés comme Dummy, Skag, Mommy Dearest, et quelques autres curiosités). Or, quiconque s’y est frotté conviendra que The Swimmer est un des secrets les mieux gardés de cette période si faste en expérimentation narrative et visuelle — zoom, surimpression, flous, jump-cuts, onirisme, caméra épaule — et très certainement un des plus grands films de piscine jamais réalisés (aux côtés de The Party, Palombella Rossa, La piscine, Cat People, Les bonnes femmes, Le maître-nageur de Trintignant, etc.). Lors de sa ressortie, en 2010, on aurait appris que le film aurait été terminé par un jeune Sidney Pollack (qui n’avait jusque là jamais été crédité sur le film, et continue sur bien des versions, de ne pas apparaître), Frank Perry ayant abandonné le tournage suite à un différend (avec Lancaster sûrement, qu’on imagine facilement mégalomane et insupportable). Barbara Loden devait jouer la maîtresse du personnage principal. Elle sera remplacé par Janice Rule (dans une des scènes justement tournées par Pollack). Je ne sais pas ce que ça explique, mais ça rajoute une sorte d’aura de mystère et d’intrigue à ce film, en tous points étonnants.
Un homme doté d’un joli corps de nageur traverse une forêt qui s’enfonce tranquillement, sans se presser, dans l’automne — les feuilles tombent, tout est un peu gris, jaune et orange, un chevreuil lève la tête. Cet homme — dont on soupçonne d’abord la présence par le truchement d’une caméra subjective, agitée, à l’épaule, qui fait fuir les lièvres, agace les chouettes et craquer les feuilles —, cet homme, en petit costume de bain marin cintré (seul vêtement qu’il portera tout au long du film, sauf pour une scène, où il l’enlèvera), arrivant de nulle part, et qu’une caméra portée sur une grue suivra le long d’un un sentier, s’élevant à travers des branchages, débouche dans l’improbable et chic jardin d’un couple et plongera sans crier gare dans leur piscine, avant de faire quelques longueurs (la musique pompeuse donne envie de pleurer, sans savoir pourquoi).






La journée est belle. Trop belle pour ne pas se baigner. Mais tous ces gens qui sont si extatiques de le voir (ils ne l’ont pas vu depuis si longtemps) refusent de plonger avec lui (tout le monde a trop bu la veille), malgré son indéniable puissance de persuasion. Séducteur, souriant, narcissique, beau gosse, Ned Merrill (Burt Lancaster, dans le rôle de sa carrière), est resplendissant. Avec ses cheveux coupés courts sur la frange, ses yeux bleus piscine, ses abdominaux et ses trapèzes dorsaux luisants. Tout son être semble nimbé d’une sorte de pureté et de joie idyllique, de santé et de confiance presque enfantine. Et alors entre deux phrases joyeuses et insouciantes (même si tout ça est quand même bizarre, ce type, cette sorte de premier homme, surgi quasi-nu des bois pour plonger dans une piscine), dans une sorte de vision hallucinée — surimpressions de ciels, de yeux bleus et de flares —, regardant l’horizon qui s’étend à ses pieds, en énumérant les noms de tous les gens qu’il connaît dans le comté et qui ont des piscines, et qui constituent alors dans son esprit autant de points de chutes chlorés, il décide de rentrer chez lui à la nage dit-il (« I’m going to swim home »), en suivant cette « string of rivers », qu’il renomme « The Lucinda River », en hommage à sa femme. Tout le monde le trouve un peu fou, rigolo, mais après tout, c’est l’Amérique, tout le monde est libre de rêver et de faire ce qu’il veut.

Et voilà notre Ned parti à la conquête d’un collier de perles de piscines de banlieue de la vallée du Connecticut. Rarement aura-t-on vu un synopsis plus curieux sur papier (et comment cela a-t-il pu être vendu à un studio ?). Je ne suis pas allé voir le résumé ni la cote de Mediafilm, mais ça doit ressembler à : « Un homme décide de rentrer chez lui à la nage en passant par toutes les piscines de gens qu’il a connus dans le passé. Film fichtrement bizarre. » (6)



Le film — qui peut faire penser à une sorte de Broken Flowers mouillé — fera défiler différents tableaux de sa vie mondaine et superficielle, passant d’une piscine cossue à une autre, renouant avec toutes ses connaissances, vieux amis, anciennes maîtresses, flirts, tous et toutes trop bien nantis, hypocrites, fêtant, souvent gros et affreux, certains éblouis de le voir, d’autres beaucoup moins (sans qu’on ne sache toujours exactement pourquoi). Ned poursuit de scènes en scènes sans sourciller ce projet insensé de se rendre comme un coureur des bois jusqu’à sa demeure, d’un cours d’eau à l’autre, faisant du « portage » entre les brasses. Il est devenu un explorateur. Il cherchera —bien sûr — à plusieurs reprises, à embarquer des filles dans son aventure aquatique (l’ancienne et trop jolie gardienne de ses enfants, une ancienne maîtresse abandonnée, une femme aux cheveux platine qui se plaint que l’eau de la piscine lui ruine ses cheveux, toutes repousseront au final ses avances, dès qu’il se montera trop insistant). À première vue, cet homme des bois, cet homme de la nature — il a une sorte de connexion mythique, dans une séquence incroyable, avec un cheval qu’il défie à la course, il court dans les bois, il jouit de l’eau, il saute et bondit comme une gazelle —, est totalement invincible, avec des allures d’homme bionique.


Mais chaque piscine qu’il traverse lui fera perdre un peu de son lustre : il s’effritera, montrera des signes de faiblesse, apparaîtra fragile, solitaire, suffisant, un peu fou, plongeant et replongeant dans l’eau de toutes ses piscines (où personne ne semble se baigner) pour oublier, pour oublier encore et encore (la piscine de banlieue comme reprise mythologique du fleuve du Lethé, quand même), alors même que chaque rencontre, chaque piscine, fera au contraire remonter des indices contradictoires de son passé, le forcera à se rappeler et nous apprendra des choses sur sa vie (quelque part entre Citizen Kane et L’année dernière à Marienbad).

Chaque scène de transition, d’une piscine à une autre, chaque “portage”, sera aussi l’occasion d’une dépense fabuleuse dépense de moments expérimentaux, dignes (quand on les épingle comme ceci) d’un Clipson ou d’un Mekas (surimpressions, surexpositions, flous, ralentis, reflets lumineux). C’est la grande époque des zoom, de la vaseline sur la lentille, de l’érotisme sixties, où le cinéma subissait de plein fouet l’effet Elvira Madigan (1967). Mais on le droit, avec la distance, de ne pas résister au charme parfaitement kitsch de ces images.



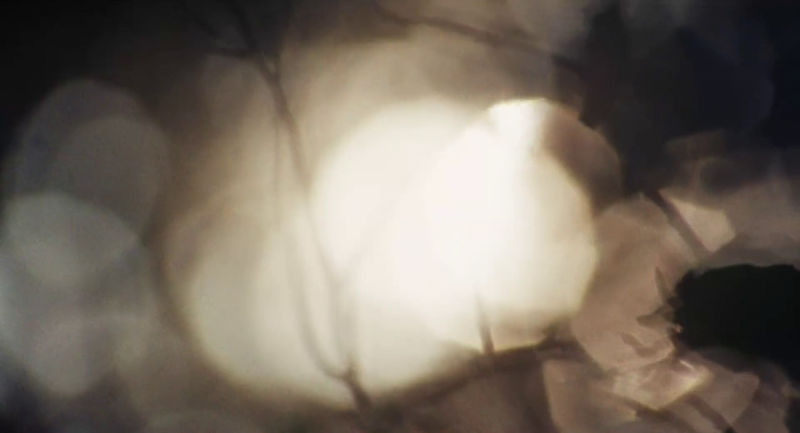





The Swimmer — comme trois bons films sur quatre de l’époque (de Night of the Living Dead à Midnight Cowboy à The Conversation) — doit sûrement être lu comme une allégorie du déclin de l’Amérique, de sa virilité, de sa confiance : sûr d’elle-même, sûr de sa puissance, de ses capacités irrésistibles de séduction, de son charme, du respect, du plaisir et de l’amour qu’elle inspire partout (il devient fou dingue quand quelqu’un lui dit que ses filles se moquent de lui, « they think you’re a joke » ; il se décompose littéralement quand sa maîtresse lui avoue qu’elle a toujours fait semblant de jouir quand ils faisaient l’amour). Il est aussi convaincu de vivre en harmonie avec la nature, propulsée par une mission quasi divine, mais aussi — et ce sera l’arc du film —, il est aussi, comme l’Amérique, complètement timbré, oublieux de son histoire (ou cherchant à l’oublier), vivant dans un monde d’artifices : hypocrite, fourbe, imbécile, narcissique, menteur, violent dès qu’on lui résiste, décalé et vaguement pédophile. Au fil du film, Ned commencera peu à peu à boiter, à avoir froid, à réclamer une serviette en sortant de l’eau. Sa masculinité finit par en prendre pour son rhume. Il apparaîtra aussi que le rêve dans lequel il se drape (sa femme va bien, ses filles jouent sont en train de jouer au tennis) est en réalité une sorte de fantasme délirant, d’image-écran. Cette traversée aquatique sera au final un chemin de croix, une odyssée sans consolation, au contraire, qui ne fait qu’accumuler les humiliations et les défaites. Par exemple, il devra, vers la fin du film, sortir de la piscine — imaginez vous — en prenant l’escalier, parce que trop faible pour se hisser avec la seule force de ses bras hors de l’eau (tôt dans le film, un personnage dira admiratif : « Wouldn’t use a ladder, no, not Ned ! »).

Avant de rentrer « chez lui », il lui restera une ultime piscine, la piscine municipale, celle à l’eau trop chlorée, qui brûle les yeux, celle des pauvres gens qu’il a sans doute regardé de haut toute sa vie, devant qui il devient soudain moins que rien, sur qui on jouit de déverser son fiel et des chaudières de mépris. Le gardien refuse de le laisser entrer sans payer (il devra emprunter de l’argent à un pauvre type, une vague connaissance, qui semble lui en vouloir à mort). Passé le premier cerbère, un autre gardien exigera — avant qu’il ne puisse se plonger à l’eau — qu’il prenne une douche chaude avec du savon, même qu’on l’oblige à retourner se doucher une deuxième fois après s’être mieux lavé les pieds, sales et blessés d’avoir traversé la moitié du comté sans chaussures. On lui demandera même d’écarter les orteils pour s’assurer qu’ils sont bien propres (imaginez un instant l’idée de demander à Burt Lancaster d’écarter les orteils pour vérifier leur propreté ?). Épuisé, à bout de force, haletant, il devra traverser cette piscine trop pleine d’enfants fous, petits de prolétaires, hurlant et lançant des ballons colorés — vision s’il en est du 6e cercle de l’enfer de Dante pour notre personnage. Et comme dirait Brel… « … Et c’est pas fini ».

Je vous laisse découvrir la fin.
Je peux simplement vous dire que quand il sortira de cette ultime piscine, escaladera une paroi rocheuse en s’éraflant les pieds déjà meurtris (ce film est un véritable massacre pour les pieds) pour rentrer chez lui en traversant une forêt devenue hostile et impitoyable, il pleuvra des cordes. Et l’été sera, depuis longtemps, loin derrière lui. Comme celui de l’Amérique. Un cauchemar peut avoir le goût du chlore.

