LA VIE SECRÈTE DES MACHINES (1ère partie)
Dans le cadre du programme de films d’Ernie Gehr présenté par Hors champ à la Cinémathèque québécoise, Tom Gunning (professeur à l’Université de Chicago, pionnier des études sur le cinéma des premiers temps et spécialiste du cinéma de Gehr) a gentiment accepté que nous traduisions et publiions un de ses textes magistraux sur ce cinéaste, disponible pour la première fois en version française. Pour la version originale anglaise : Tom Gunning, Films of Ernie Gehr, San Francisco, San Francisco Cinematheque, 1993, p. 3-13. On peut également consulter le texte en ligne. Nous tenons à remercier Tom Gunning de nous avoir permis de publier cet article sensible et puissant, qui offre une excellente introduction à l’univers infini d’Ernie Gehr.
——
I. La vie secrète des machines
« Surprises infinies dans un cadre fini. » (Robert Bresson 1 )
Une rencontre décisive avec ce « mystère » est à l’origine du travail de Gehr comme cinéaste. Après avoir réalisé quelques films en 8mm qui ne lui donnèrent pas l’impression d’aboutir à grand chose, Gehr décida de faire une pause. Au cours d’une interview, au début des années 70, Gehr se rappelle : « ce qui a été le déclencheur, ce qui m’a véritablement convaincu d’arrêter, fut d’être soudain face à cette caméra, sur son trépied, debout là, et de me trouver vraiment confus, à me demander ce qu’elle avait à voir avec ce que j’essayais de faire. »
Ce temps d’interruption fondateur fut à l’origine de l’intuition centrale des premiers films de Gehr, et qui continue à animer son œuvre encore aujourd’hui, bien que sous une forme transformée : le cinéma, le dispositif cinématographique en entier, vit une vie secrète, à part entière. Gehr a exploré les dédales de ce corps étranger qui le confrontait en tant que cinéaste, et il ne pouvait désormais plus le percevoir simplement comme un outil permettant l’expression de quelque chose qui lui serait extérieur, qu’il s’agisse d’une histoire, d’une idée ou d’une émotion.
Chacun de ses films explore les facettes de cette vie secrète de la machine, et la façon dont les composantes qui l’habitent interagissent les unes avec les autres : la souplesse et la translucidité du celluloïd ; l’instabilité de l’émulsion photosensible ; la caméra, qui fait défiler une pellicule devant une lentille, suivant un mouvement intermittent à vitesse variable ; la lentille qui concentre et donne forme à la lumière ; et le projecteur, avec ses vitesses de défilement et sa lentille conçues pour ré-animer les empreintes de lumières, magnifiant, masquant et aspirant le rayon de lumière.
Ironiquement, plusieurs critiques et spectateurs considérèrent ses œuvres comme minimalistes, alors que, dans les faits, Gehr était en train de révéler, en entrecroisant les différentes dimensions du cinéma, des processus complexes d’une grande intensité dramatique.
Prenons History (1970).
Si l’on devait se contenter de la description de ce film, il apparaîtrait comme le nec plus ultra de l’art minimaliste, ou même comme un canular néo-dada. Gehr a réalisé ce film sans mettre de lentille devant la caméra, de telle sorte que le film exposé n’enregistra aucune image figurative, mais seulement la danse de l’émulsion, rongée par la lumière et digérée au développement. Malgré le fait que ceci pourrait sembler comme la conception la plus aride de l’art conceptuel, une fois projeté sur un écran, l’action de ce processus est tout simplement éblouissante.
Certes, cette danse infinie et sans cesse renouvelée de fils de ténèbres et de points de lumières pourrait évoquer un imaginaire cosmique, comme si on assistait à la naissance des étoiles et de la nuit, ou au chaos originel avant que le démiurge ne sépare la noirceur de la lumière. Mais il y a plus en jeu ici qu’un simple test de Rorschach mystique. On se rend compte assez rapidement que le processus que nous sommes en train de regarder ne renvoie à aucune prétention métaphorique : il ne fait que démontrer. Nous sommes en train de voir, non le cosmos, mais, comme Gehr le décrit, « le cinéma dans son état originel, où la division entre les couches de lumière et d’obscurité n’a pas encore eu lieu. » Il n’est pas nécessaire de chercher une image au-delà de l’histoire ou du langage ; on saisit directement la pulsation de la vie secrète du film, un rythme qui, de façon invisible, est sous-jacent au développement de n’importe quel film jamais réalisé. Ce film de Gehr n’est pas plus minimaliste qu’une radiographie, et il n’est visiblement pas un canular.
History pose une des règles centrales du travail de Gehr : une réduction presque ascétique des moyens peut donner lieu à des richesses perceptuelles quasi-infinies. Dans presque tous les films de Gehr, on retrouve cette stratégie : la simplicité de la forme ou de la démarche conduira à la découverte d’un monde de variations et de complexités inattendues. Et ceci pourra adopter différentes formes.
Par exemple, prenons un élément presque anecdotique de l’un des derniers films de Gehr [au moment de la rédaction du texte], Side/Walk/Shuttle (1991). Après avoir vu à deux reprises cette succession de vues en plongée et en mouvement sur un panorama urbain, j’étais certain que Gehr avait tourné le film dans plusieurs lieux différents, puisqu’à aucun moment la composition du paysage ne se trouve répétée. Par contre, après l’avoir regardé de nombreuses autres fois, et avoir très minutieusement noté certains monuments dans le cadre, j’ai découvert ce que Gehr lui-même me confirma, que tous les plans avaient été filmés à partir du même site, en explorant constamment des nouveaux points de vue et en renouvelant à chaque composition l’impression de découverte.

Ernie Gehr, Side/Walk/Shuttle, 1991
Penser le cinéma comme le lieu d’un processus de découverte, infini et renouvelable, est ce qui lie l’œuvre de Gehr au cinéma des premiers temps. Tout comme les premiers opérateurs cinématographiques, Gehr s’intéresse à la « nouveauté » du cinéma, sa capacité de représenter un monde qui nous était jusqu’à là invisible, et il retrouve la fascination des films des premiers temps pour le rapport dynamique entre le mouvement dans l’image et les bords du cadre.
Le travail que Gehr a réalisé dans Eureka à partir d’un film d’actualité du tournant du XXe siècle, montre bien son affinité avec la façon dont les opérateurs des premiers temps traitaient la dynamique du mouvement, tout autant que la capacité de Gehr à l’assimiler et la transformer. Le film qui fournit le matériel pour Eureka appartient à un genre courant dans le cinéma des premiers temps, le « film-panorama », dans lequel la caméra captait des vues de paysages naturels ou urbains à bord d’un moyen de transport : bateau à vapeur, gondole, locomotive, ou encore, comme dans le cas de ce voyage le long de Market Street à San Francisco, à bord d’un tramway.
Ce type de film combinait deux attractions dominantes du premier cinéma, à savoir la capacité à transporter le spectateur dans diverses parties du monde et une expérience vive de l’une des innovations déterminantes de la nouvelle invention, sa capacité à reproduire le mouvement. Gehr a réimprimé à la tireuse optique le matériel d’origine, répétant les photogrammes (tout en éliminant certains), créant ainsi une sorte de rythme bégayant, presque statique, étirant la longueur du film tout en atténuant son tempo.
Encore une fois, une transformation, fort simple en apparence, multiplie en fait notre degré de conscience du phénomène cinématographique. Premièrement, le ralentissement du mouvement par réimpression de photogrammes suspend l’apparente continuité de l’illusion du mouvement que le cinéma a introduite. Mais, paradoxalement, plutôt que de détruire l’expérience du mouvement, Gehr nous permet de recentrer notre attention sur lui : nous assistons à la naissance sans cesse relancée du mouvement à partir de la succession d’images arrêtées.
Aussi, en inversant (c’est-à-dire en dirigeant notre attention sur les photogrammes individuels plutôt que de les laisser disparaître dans le flou du mouvement) et en détruisant presque l’illusion du mouvement, Gehr nous autorise à refaire l’expérience de sa dimension miraculeuse, de sa surprise permanente. Eureka nous replace dans la position de ces premiers spectateurs de l’invention des Lumière qui s’exclamaient avec ravissement dès que l’image projetée se mettait en mouvement.
De plus, le tempo ralenti met en valeur chaque changement dans le cadre, nous permettant de relever toute nouvelle parcelle d’information. Noël Burch et Ken Jacobs ont tous deux parlé du caractère décentré du premier cinéma, c’est-à-dire le fait que n’importe quelle partie de l’image pouvait devenir un lieu d’information ou d’excitation. Ceci ne fut jamais aussi vrai que dans les scènes de rues où l’opérateur pointait sa caméra sur la vie urbaine qui inondait le cadre.


Ernie Gehr, Eureka, 1974
La transformation que Gehr fait subir au matériau nous permet de faire l’expérience de ce film à la manière d’un spectateur du cinéma des premiers temps, comme s’il s’agissait d’autre chose que d’un simple parcours en tramway avec une finalité en vue (bien que je reviendrai sur ce point), mais plutôt comme un survol quasi-encyclopédique des attractions visuelles de l’époque : les moyens de transport urbains, la démarche et le transport des citadins, des signaux écrits, des bouts d’affiches publicitaires et le défilé de l’architecture. Le cadre de la caméra semble aspirer comme avec un aimant tout matériel apte à captiver le regard, puis de le balayer au-deçà de ses quatre coins.
Le cinéma de Gehr n’est pas poussé par la recherche d’une forme minimale ou un désir de réflexivité. Plutôt, il découvre dans l’extrême complexité de ce dispositif de la fin du XIXe siècle, le « cinématographe », un petit monde fait de ruse, doté de ses propres lois et possibilités, et dont l’exploration vient tout juste de commencer.
La caméra et le projecteur lui offraient la possibilité de constamment manipuler et contrôler ce matériel brut, fait de mouvement, de lumière et de temps, et créant, plutôt qu’une représentation, un processus de transformation et d’équilibre directement visible à l’écran. La vie secrète des machines était visible à même la danse de particules de l’émulsion, tout comme dans l’enregistrement, vieux de plusieurs décades, de la vie du vieux San Francisco, ou une vue aérienne du skyline de San Francisco aujourd’hui.
Bien que cette vie secrète soit faite de surprises et regorge d’énergie, Gehr y accède à travers des actes d’ascèse, refusant les possibilités immédiates de représentation que l’appareil cinématographique peut livrer. Les découvertes que Gehr offre se sont faites au prix d’actes de contrition, de concentration de l’attention par des techniques de discipline, de contemplation et de silence. L’infini ne peut être atteint qu’en excavant en profondeur le fini.
II. Trouver une position
« Immobilité et stimulation autour de quoi la conscience oscille tout comme le cinéma. » (Ernie Gehr, 1971)
Les explorations de la machine cinématographique que nous propose Gehr n’ont rien de mécanique, c’est-à-dire de prévisible ou d’inerte. Au moment de cette confrontation fondatrice entre Gehr et la machine sur son trépied, la question que Gehr s’est posée était : « qu’est-ce que cette caméra a à voir avec mes intentions comme cinéaste ». La vie secrète que Gehr a découverte concernait de façon très profonde la relation entre les processus de la machine et les processus de la conscience humaine.
Encore une fois, History offre un exemple loquace. Plutôt qu’une démonstration conceptuelle d’auto-réflexivité, cette nuée de particules filmiques procure une expérience, la vivacité de l’interaction chimique déclenche la vie de la conscience. Pendant que vous regardez History, rien de concret n’apparaît auquel vous pourriez vous raccrocher, hormis la fluctuation constante de lumière sur l’écran. Mais vous finissez par habiter cet espace tacheté, ou du moins vous essayez de l’habiter, votre cerveau cherchant à suivre le rythme de ces motifs imprévisibles.
Comme Gehr le dit en interview, « les changements qui ont lieu sur l’écran ne sont pas — ou le sont-ils ? — les mêmes qui se déroulent dans le cerveau. » Encore une fois, l’image sur l’écran n’est pas une métaphore des processus mentaux, ou une représentation, mais plutôt un stimuli pour la pensée qui suit une voie parallèle, mais fondamentalement divergente, aux motifs tracés par la vie psychique. Cette énergie déferlante de lumière et de temps, sans configuration, à la fois fait résistance et engage une série de processus mentaux tout au long du visionnement.
Ceci rappelle la description que fait un texte boudhiste, le Hekiganroku, de la conscience d’un nouveau né : « Comme une balle lancée dans des rapides, savons-nous où elle se dirige ? »
Devant les films de Gehr on est toujours en train de chercher sa place, et ce processus joue un rôle clé dans l’expérience de visionnement et de compréhension qu’ils induisent. Même si les paysages que l’on retrouve dans les films de Gehr diffèrent énormément, parvenir à mettre un « pied à terre » est un défi et un plaisir constant : dans ses films du début des années 70, le sol semble souvent glisser sous les pieds ; Gehr crée un espace qui rompt radicalement avec l’espace perspectif et « toute orientation régulée semble impossible ».
Cependant, même dans ses films les plus « non-figuratifs », comme History et Field, Gehr empêche notre vision de s’en remettre à l’espace plat de l’écran. Non seulement le tournoiement des grains de History évoquent un espace infini, mais à la droite de l’image (par où la lumière a coulé sur la pellicule) apparaît un bord de lumière claire, donnant une impression presque humoristique de moulage tridimensionnel à la masse bouillonnante du magma de l’émulsion. Une partie de l’interaction entre la vie du cerveau et les processus à l’œuvre dans ce film ont avoir avec ce que Gehr décrit comme le « combat pour atteindre une forme spatialisée. »
De la même façon, malgré la rapidité extrême et la redondance des mouvements d’appareil dans Field, qui réduisent les images à des bandes contrastées de gris et qui ne permettent à aucun lieu de devenir reconnaissable, on ne perd jamais l’impression d’un mouvement transformant l’espace. L’écran ne se donne jamais l’apparence confortable d’un motif de striation, comme celui d’un téléviseur déréglé. Même s’il n’est pas toujours possible de déterminer la direction du mouvement (qui change sans signal, et qui peut sembler radicalement différente tout dépendant de l’endroit où vous concentrez votre attention — un mouvement de tête peut, par exemple, totalement changer votre impression du flux spatial), la présence d’un monde, rayé par la vitesse, ne disparaît jamais.
Les possibilités intrinsèques de représentation et de transformation du cinéma rencontrent le réflexe de notre perception à voir en trois dimensions, rejoignent notre propre combat pour saisir une « forme-espace » et de se situer par rapport à ce que nous voyons. Mais en bloquant la nature automatique de ces processus perceptuels, Gehr permet de les mettre en valeur et d’attirer notre attention vers eux, d’une façon à la fois dynamique et sensible.
Bien que Gehr soit revenu de façon glorieuse à un espace non-perspectif dans Eureka (où les diagonales en noir et blanc de Field cèdent la place à des bandes latérales de couleurs inimaginables), la plupart de ses films plus tardifs semblent plutôt faire appel à la perspective de façon intense, mais parfois ludique. Serene Velocity pervertit de la façon la plus profonde que l’on peut imaginer l’espace perspectif, en filmant un corridor qui s’éloigne à partir d’une position centrale, de telle sorte que les orthogonales convergent pour dessiner un X au centre de l’image.

Le point de fuite, les portes au bout du corridor, sont signalées par un panneau EXIT. Mais si le regard du spectateur est fortement sollicité, sinon canalisé vers cette voie de sortie, la structure du film (qui alterne à tous les quatre photogrammes — ou 4e de seconde — entre différentes positions focales) tire violemment le spectateur tantôt à l’intérieur, tantôt à l’extérieur de cette profondeur. À mesure que l’écart entre les positions de la lentille du zoom s’agrandit, le spectateur est mis au défi de maintenir une impression cohérente de profondeur et même de s’accrocher à une constance des objets à l’écran. Le panneau EXIT cesse de simplement gonfler et se dégonfler, dans un rythme pulsant comique, mais surgit tantôt menaçant dans la position la plus rapprochée puis se retire jusqu’au point de presque disparaître.

Ernie Gehr, Serene Velocity, 1970
Alors que Serene Velocity affiche un rythme mécanique absent des autres films de Gehr, le prévisibilité de sa structure conduit encore une fois à des résultat imprévisibles, passant d’un espace familier et habitable à la pulsation calme, à un cauchemar de désorientation où nous ressentons à la fois une poussée et une résistance à ce tunnel — comme l’espace dans la profondeur classique.
Untitled (1977) explore également les contradictions d’une traversée apparente d’un espace donnée par la perspective, grâce à la dynamique de la lentille de la caméra. Ici, plutôt que les effets contradictoires et agressifs du zoom, Gehr s’intéresse à un graduel changement de la mise au point. Tout commence par une image indéfinissable — une impression de mouvement et de couleur, c’est tout. Lentement, la mise au point devient plus nette et on reconnaît un tourbillon de neige derrière laquelle se trouve une masse colorée indéfinie. À mesure que la mise au point change, la zone de reconnaissance s’étire vers l’arrière, jusqu’à ce que la masse de couleur se solidifie en un mur de briques. Nous avons traversé l’espace de cette image, au fur et à mesure que la lentille nous permettait de définir les objets jusqu’à ce que nous rencontrions soudain cette frontière au loin. La reconnaissance finale nous permet de construire la profondeur de cet espace, mais tout aussi immédiatement, le restreint et le referme.
.
Eureka, également, voyage dans les profondeurs de l’espace, alors que les orthogonales de Market Street et le tour du Ferry Building au terminus fournissent (comme dans Serene Velocity) un point de fuite bien démarqué. Mais l’énergie du film résiste à une simple traversée directionnelle. Pendant que le tramway qui transporte la caméra procède inébranlablement vers son but, le flux de la vie se déverse à l’intérieur ou à l’extérieur des bords de l’image, disparaissant ou s’y introduisant. Le tirage optique du film permet à ce mouvement latéral décousu de carrément dépasser en intérêt la progression inéluctable mais heurtée du tram dans la profondeur.
De plus, le tirage optique a fait en sorte que chaque photogramme apparaît brièvement immobile, de telle sorte que son effet de surface est mis de l’avant. Les égratignures et les autres marques d’usure deviennent aussi saisissantes que les événements photographiés eux-mêmes, devenant des signes de l’histoire, au même titre que les styles d’habits ou les moyens de transport aujourd’hui démodés. Gehr fait se croiser l’implacable pénétration de l’espace en la mettant en tension avec ces phénomènes de surface.
Et tout comme le jeu d’arrêt et de reprise de la re-impression du film semble à la fois refermer et ouvrir l’espace de l’image, ce rythme transforme également notre expérience du temps. On ne refait plus ici l’expérience d’un moment passé réanimé, mais plutôt, c’est le temps écoulé entre nous et le tournage du film qui devient palpable. La progression temporelle converge ici en une impression du passé, où le temps devient de l’histoire.
Même si je me suis jusqu’ici principalement intéressé à la recherche de position spectatorielle dans les films de Gehr en employant des termes spatiaux, le positionnement temporel joue également un rôle déterminant, permettant le mouvement dans l’espace et la sensation de progression complexe que j’ai décrits. Still, l’un des films les plus subtils et fuyants de Gehr, superpose littéralement le temps et l’espace pour créer des rencontres fantomatiques. Still est composé de huit plans, parmi lesquels tous sauf le dernier sont des surimpressions. Si le cadrage des plans varie très peu, tous présentent à peu près le même point de vue : ils donnent sur une rue de Manhattan et, de l’autre côté de la rue, sur un restaurant et un magasin de meubles, permettant d’observer le trafic et le flot des passants à la fois tout près de la caméra et de l’autre bord de la rue. Puisque le cadrage des plans surimposés est identique (à l’exception d’un plan où un très léger changement d’angle déplace l’enlignement des deux images) cette scène de rue quotidienne apparaît encombrée d’images à la fois opaques et transparentes de voitures et de passants.
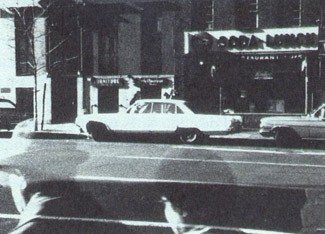
Ernie Gehr, Still, 1969-1971
Ces entités transparentes se déplacent de façon convaincante sur les surfaces solides, s’éloignant de la caméra en perspective, négociant le trajet sur la rue et le trottoir avec précision. Au lieu de se comporter comme des fantômes oniriques, ces êtres translucides s’intègrent parfaitement dans cette scène quotidienne. Et ils ont font partie. Leur perméabilité visuelle est le résultat du jeu de la caméra avec le temps, dans la mesure où la seconde image enregistrée a laissé une marque moins profonde et substantielle sur le film.
Tout comme les égratignures sur les images utilisées dans Eureka, cet enchevêtrement de personnes et de spectres est une trace du temps — de deux temps superposés. Elle invoque une fantaisie de vie urbaine transformée en surface photosensible, capable de retenir le tracé d’une journée de circulation, une image synchrone de la vie et des déplacements accumulés. Voir deux images simultanément dans le même espace fait en sorte que notre conscience se scinde entre diverses trajectoires et projections.
Cette coalescence de temps distincts en une seule image crée encore une fois une impression de pousser/tirer avec l’expérience de la profondeur. Les images surimposées semblent reposer sur le dessus (sur-imposées) de l’image, tandis qu’elles se déplacement vers le fond, créant ce que Gehr appelle a « teasing play with planes » [ndt. Que l’on pourrait maladroitement traduire par « un jeu de tension entre les plans »]. Mais ce jeu d’espace et de position implique plus qu’une simple tension entre des couches d’images.
Les variations d’ombres et de lumières des deux niveaux font en sorte que la double exposition se déplace constamment entre l’avant et l’arrière plan. Une ombre sur la première image crée soudain dans l’image surimposée un bloc de solidité. Gehr nous fait prendre acte de la multiplicité de marqueurs de profondeur qui sont à l’œuvre dans un film, ainsi que ce qui fait reculer l’effet de perspective.
Les zones d’indistinction entre les plans constituent une bonne part du plaisir que procure ce film : les automobiles foncent sur le fantôme d’un autre véhicule, ou encore les voitures réalisent ce rêve de tout New-Yorkais de pouvoir stationner au-dessus ou par-dessus une autre. Gehr était tout particulièrement fasciné par la façon dont les marqueurs de profondeurs créés par la couleur (les couleurs chaudes donnent l’impression d’être à l’avant-plan) participent de la logique de l’espace. Aussi les portes rouges de l’autre côté de la rue semblent par moments non seulement se projeter à travers les fantômes qui passent devant, mais carrément se situer à l’avant-plan des piétons.
Il n’est pas possible de définir par avance la place que nous aurons à occuper devant un film de Gehr, et au final tout positionnement nous échappe. En même temps, on ne se sent jamais abandonné ni ignoré par ses films. Au contraire, ils nous interpellent très directement et nous demandent de choisir entre différentes positions, parfois contradictoires, d’essayer diverses options, de nous déplacer de l’une à l’autre.
Ainsi, Gehr s’intéresse à l’interaction entre les différents processus liés à l’espace, au temps, au mouvement et au temps inscrits dans le dispositif cinématographique et à nos propres processus perceptuels et mentaux. Les jeux de Gehr avec les formes de l’espace explorent les contradictions et les tensions qui lui sont liées, et nous invitent à faire l’expérience de zones de l’espace qui demeurent pour la plupart d’entre nous des terra incognita.
(Traduit de l’anglais par André Habib)
Notes
- Robert Bresson, Notes sur le cinématographe, Paris, Gallimard, 1997, p. 106. ↩
