Entretien avec Mathieu Denis et Simon Lavoie
Ceux qui font les révolutions à moitié n’ont fait que se creuser un tombeau de Mathieu Denis et Simon Lavoie a suscité son lot de débats et de questions, d’éloges et d’attaques, depuis son passage sur les écrans au début de l’année. Acclamé lors de son passage au TIFF à l’automne, encensé par de nombreux festivals qui l’ont accueilli avec enthousiasme (prix à Berlin, meilleur film canadien au TIFF, etc.), et même lors de son passage au FNC (où nous l’avons vu) où il n’a pas semblé soulevé l’ire de qui que ce soit dans les médias. C’est plutôt à l’occasion de sa sortie en salle au Québec, au mois de février 2017, qui coïncidait avec le 5e anniversaire de la grève étudiante de 2012 (ce n’est pas innocent), et ce, malgré un consensus critique et une adhésion à peu près généralisée, que les cinéastes ont dû répondre de leur film auprès, notamment, des militants du mouvement étudiant, heurtés et irrités par cette œuvre qui trahissait et bafouait selon eux l’esprit et la lettre de l’événement auquel ils avaient pris part. Pendant que le film était célébré à Berlin et ailleurs, plusieurs actions d’éclats, des textes et des débats ont pointé du doigt les contradictions qui habitent le film tout comme ses zones grises, ses angles morts ou ses dérives. Nous publions dans ce numéro un article qui revient sur la sortie du film et pose un regard virulent sur le film.
Il est vrai que tout sépare ce film d’une démarche davantage documentaire, attentive au vécu des manifestants et qui aurait cherché à rencontrer et se brancher sur le réel contemporain de la lutte. Je pense en particulier au travail exemplaire du groupe d’action Épopée qui, depuis le film-manifeste Insurgence (le seul film à mes yeux encore pertinent à avoir traité du mouvement), réalisé dans la foulée des manifestations de 2012, jusqu’à l’installation Fraction, présentée sans parade ni trompète à la Cinémathèque à l’automne 2016, a su syntoniser le rythme et la puissance singulière de cette insurrection qui ne s’est pas totalement épuisée avec 2012 et qui continue, de différentes façons, à habiter les corps et les paroles : sous la forme d’une hantise, d’une blessure, bien sûr, mais aussi d’une énergie et d’un désir de poursuivre le combat, de trouver des nouvelles formes pour l’incarner (je pense entre autre au collectif Action indirecte).
Le film de Lavoie et Denis est donc à l’opposé de ce type d’approche. Et sûrement a-t-on raison de lui en tenir rigueur. Mais sans doute faut-il situer ce film sur une autre ligne de fracture politique, en fonction d’un autre horizon historique qui informe sa vision. Même si elle travaille le film en sourdine, il demeure que c’est la question de l’identité et du nationalisme québécois, des formes d’engagements culturels et politiques qu’elles ont permis de réaliser au cours des décennies et dont l’héritage n’est pas assuré, la stagnation de l’enjeu de la souveraineté ainsi que le malaise qui découle de ce que nos penseurs nationalistes décrivent comme un éternel inachèvement historique, c’est tout ceci qui nourri les partis pris idéologiques qui animent ce film, tout comme leur précédent opus, Laurentie. Le plus grand reproche que l’on peut faire au film, n’est-il pas d’avoir soufflé à ses révolutionnaires post-2012 des questions, des préoccupations, des méthodes qui n’étaient et n’auraient pas pu être les siennes ? Mais n’est-ce pas, en retour, un reproche que l’on pourrait adresser aux détracteurs du film, de ne pas avoir suffisamment été à l’écoute des questions, des préoccupations et des méthodes des cinéastes, en exigeant d’eux un film qui aurait synchrone avec leur lutte ?
Malgré la polémique qu’il a soulevée, il nous a semblé évident que le film était animé par un réel désir de cinéma, un désir riche et complexe, ne fut-ce que par la quantité de contradictions qui l’habitent. Nous avons donc voulu rencontrer les cinéastes pour leur poser des questions, leur faire part de ce qui nous avait emballé mais aussi ce qui nous avait irrités dans la proposition, en partant du principe que le dissensus critique est toujours salutaire. C’était peu de temps avant leur départ pour Berlin, au moment où les critiques commençaient à peine à fuser de toutes parts. (AH)
Hors champ [HC] : Le film que vous avez réalisé, Simon Lavoie et Mathieu Denis, nous a forcément beaucoup intéressé, interpellé et travaillé, depuis que nous l’avons vu à l’Impérial, durant le Festival du nouveau cinéma, à l’automne 2016. Je pense entre autre, dans le décor somptueux de la salle, à l’ouverture de ce film où toute la grandeur épique, la violence et les dissonances, les disharmonies internes du mouvement étaient représentées, simplement par le choix de ce long extrait musical d’Alan Hovhaness [Requiem and Resurrection] que vous nous faites écouter dans le noir (c’est pour moi le meilleur moment du film). Sur un autre plan, celui de l’enjeu politique, le film a soulevé chez nous beaucoup de questions et d’interrogations. On peut par exemple se demander quel rôle ce type de film peut jouer sur le terrain de l’action politique. Vous semblez le concevoir comme un film d’action, qui joue les éveilleurs de conscience, mais je crois que ça peut être très contestable. Alors pour lancer peut-être un peu brutalement la discussion, je vous demanderais de me dire où vous étiez au printemps 2012 ?
Mathieu Denis [MD] : Laurentie fut tourné à l’été 2010. La première avait eu lieu à Karlovy-Vary en juillet 2011, et sorti en salle en octobre 2011. Laurentie est vraiment un film sur le désengagement, sur l’apolitisme, celui de notre génération, à Simon et à moi. Clairement, en tout cas, on n’est pas de la même génération que ceux qui ont lancé le Printemps érable. Ça c’est sûr et certain. On faisait ce constat très sombre, de ce qu’on percevait être le Québec à ce moment-là, à travers un personnage un peu archétypal. Quand le Printemps érable surgit, il y a une énergie très différente de celle que l’on dépeint dans notre film. Il s’est trouvé qu’on a été invité, durant le printemps, à présenter Laurentie dans des ciné-clubs organisés par des étudiants d’université ou de CEGEP en grève. Nous nous trouvons durant ces projections confrontés par les étudiants qui nous disent : « Ne trouvez pas, en regardant autour de vous, que ce constat que vous avez fait, n’est pas juste, ou n’est plus d’actualité ? » Je trouvais évidemment très inspirant ce qui se passait parce qu’effectivement on a eu le sentiment à un moment donné que quelque chose était possible. Le mouvement prenait aussi de l’ampleur, transcendait ses propres bases. C’est sans doute la première fois que j’ai ressenti ça. J’ai voté pour la première fois lors du référendum de 1995 et même à cette époque-là, je n’avais pas eu le sentiment, à ce point-là, que quelque chose était en train de basculer, peut-être vers un monde un peu différent. Toujours est-il qu’avec le film qu’on avait fait, on se trouvait un peu bousculé. On répondait souvent aux étudiants qu’on trouvait cela extrêmement inspirant ce qui se passe aujourd’hui. On ajoutait souvent : « Mais reparlons-nous dans six mois. Car si au bout du compte, ce mouvement ne mène à rien, peut-être que notre constat ne sera que plus douloureux et plus pertinent. » Quand il y a un élan de cette envergure là, si ça ne réalise pas sa propre promesse, le recul est inévitable. On l’a vu. Au printemps 2013, il y a encore des étudiants qui ont tenté de relancer la machine, et l’énergie et la conviction n’y étaient plus. La conséquence directe de l’échec qu’a été le Printemps érable se faisait sentir de façon aiguë à ce moment-là.
HC : La question de l’échec est intéressante et j’aimerai vous entendre là-dessus. Peut-être faudrait-il parler plus justement, et pour rejoindre vos thèmes, d’un certain inachèvement historique. Cette question est celle de tous les penseurs nationalistes et souverainistes du Québec. Je pense, parmi une multitude d’autres, à Hubert Aquin que vous citez souvent dans vos films. Cette question semble vous hanter visiblement. Et je me demande si vous ne la transbahutez pas trop facilement sur l’échec, comme vous l’appelez, du Printemps érable. En revanche, on pourrait dire que le mouvement étudiant n’a pas qu’été un échec : il a contribué à défaire le gouvernement libéral de Charest, a mis un terme aux propositions de hausse exorbitantes de frais de scolarité, a montré la capacité de soulèvement d’une jeunesse qu’on croyait apathique. Il y a donc eu un gain politique, temporaire. Bien sûr, on ramène, un an plus tard, les Libéraux, mais dans un tout autre contexte qui est celui d’un rejet des politiques identitaires du Parti québécois. Mais certainement, pour beaucoup de jeunes qui ont été actifs en 2012, ils portent en eux des leçons durables et qui persistent en eux, et en tout cas qui ne renvoient pas pour eux avant tout à une expérience de l’échec.
Simon Lavoie [SL] : Peut-être qu’en effet parler d’échec est un peu fort et que le mot inachèvement est plus approprié. Ce mouvement aura permis à une nouvelle génération qui jusqu’alors était prédestinée à être des consommateurs ou des numéros, de prendre conscience qu’ils pouvaient devenir des citoyens, qu’ils pouvaient intervenir dans la société. Ça leur a fait réaliser qu’ensemble ils pouvaient être plus forts et changer les choses. Donc c’est déjà quelque chose, au-delà de ce qu’ils peuvent ressentir aujourd’hui : sont-ils résignés, sont-ils rentrés dans les rangs, ressentent-ils un abattement ? C’est peut-être un sentiment d’inachèvement qui donne lieu à des lendemains amers. Comme ce fut le cas pour le peuple québécois de se relever après 1980 ou 1995. Et même si on remonte plus loin dans le temps, c’est quelque chose qui est profondément inscrit dans notre histoire.
HC : Vous confirmez bien que pour vous cet inachèvement s’inscrit directement dans l’horizon politique de l’indépendance du Québec. Croyez-vous que l’indépendance a été un des moteurs politique du mouvement ? J’ai un peu l’impression en voyant le film que vous inventez une figure révolutionnaire hybride, qui a plus à voir avec le FLQ qu’avec le mouvement militant contemporain, même dans sa frange la plus radicale. Ceux qui ont pris la rue ne se conforment pas du tout au modèle politique que vous proposez, comme si vous avez tenté plutôt de mouler le militant de la grève de 2012 à ce que peut être ou devrait être, dans votre imaginaire à vous, un révolutionnaire au Québec aujourd’hui. Et ce modèle, je crois, a très peu avoir avec l’idéal révolutionnaire d’un jeune aujourd’hui.

Ceux qui font les révolutions… (2016)
SL : L’indépendance n’était en effet pas du tout présente dans le mouvement étudiant de 2012. C’est indéniable et on est bien conscient de ça. Ça pourrait être une critique que l’on pourrait servir à certains leaders de ces mouvements là. C’est d’avoir fait l’erreur de croire qu’on est né de la dernière pluie, que soudainement on vient au monde dans cette époque caractérisée par la mondialisation, où les luttes sont transnationales. C’est comme si certains voudraient se faire croire qu’ils sont détachés de leur propre histoire. Qu’ils sont dans les rues, qu’ils ont un idéal altermondialiste, pour faire court, mais en se refusant de constater que l’espèce d’aliénation ou d’asservissement dans lequel on est encore malgré tout au Québec, est une sorte de force qui nous tire vers le bas et nous empêche de faire quoi que ce soit. Le Printemps érable surgit durant le règne de Stephen Harper. Nous voulions tenter de reconnecter le mouvement social du printemps 2012 avec un continuum historique du Québec. On ne lance évidemment pas la pierre à ces jeunes-là qui sont des produits de la défaite référendaire et à qui on a toujours dit que la question nationale était dépassée, ringarde, tribale. Ils ont intériorisé ça et ils pensent avoir dépassé cette réalité qui renvoie à la réalité de leurs parents contre qui ils sont en révolte. On voulait avoir cette perspective-là. C’est aussi pourquoi on n’a pas cherché avec vérisme les tenants et les aboutissants du Printemps érable, mais plutôt tenter de mettre cela dans une perspective par rapport à l’époque contemporaine et ce qui vient avant.
MD : Ce qu’on avait envie de souligner c’est l’interconnexion entre les différentes questions sociales qui animent le Québec présentement. On ne peut pas seulement agir sur une partie des enjeux. Il y a quelque chose de plus global qu’il faut envisager, appréhender, et la question nationale reste un élément qui n’est pas réglé, qui est resté sans réponse. Ce flou, cette incertitude identitaire dans laquelle on vit, a des impacts à plein de niveaux. On parle de la question nationale, mais générationnellement tout est interrelié. La réalité, c’est que les choses vont changer quand collectivement la majorité du groupe décidera de changer certaines choses.
HC : On a beaucoup vu, durant le mouvement, ce désir de connecter avec les ouvriers, les syndicats, avec la société civile. Un peu comme à toutes les grandes époques, ce mélange de milieux et de générations, cette connexion là existe et fait naître du commun et du collectif. On croit soudain à du collectif, à l’idée que du commun peut émerger.
SL : Mais ça fait surtout apparaître les clivages et les schismes : ça a plutôt mis au grand jour la sorte de haine des québécois pour leur jeunesse. Un schisme également entre Montréal et les régions. Le drame de ces jeunes-là a été de voir l’appui très large de la population pour les actions de la police. Ils ont cru soudainement et naïvement au changement social, au grand soir. Il est certain qu’ils se sont butés rapidement à ces gens pris à la gorge à devoir payer leur monster house et qui doivent aller travailler le lendemain matin, et c’est quelque chose qui est immuable. Rapidement ils se sont frottés à la difficulté de rallier les masses et de trouver des prosélytes dans la population.
HC : Ce qu’on a vu dans la durée c’est un renversement de tous les règlements et de toutes les accusations déposées contre la plupart de ces jeunes. Et une très grande majorité de la population admettra sans peine aujourd’hui que le poids qu’aurait été une hausse des frais de scolarité sur la jeunesse aurait été intolérable. Je pense que tout le monde, y compris ceux qui réprimaient et gueulaient à l’époque, doivent admettre qu’il y a eu du bon au mouvement. Peut-être y a-t-il eu du changement, notamment à l’aune des politiques d’austérité de Couillard. Je ne suis pas angélique ni naïf par rapport au mouvement, qui a eu des failles, des contradictions internes, qui a dû subir la lourdeur des lendemains qui déchantent, mais je pense que votre constat est celui d’un échec qui mène à un repli radicalisé sur soi qui a fait l’impasse et le sacrifice de l’espoir du collectif, du commun.
SL : On n’est pas dans un repli sur soi comme dans Laurentie. Ils se regroupent, ils se retranchent dans un sous-groupe, oui, car ils voient bien que leurs aspirations ne rejoignent pas les aspirations dominantes, mais ils se regroupent quand même.
HC : Est-ce qu’il y a encore chez eux l’espoir que du commun, que du collectif puisse naître ? Leurs actions sont antagonistes, dirigées contre des cibles plus ou moins précises, mais on n’a pas l’impression que leur action est animée par une pensée du peuple, du commun, du collectif.
MD : Ils essaient d’abord de réveiller, de bousculer leurs contemporains. Et c’est peut-être ça leur erreur. Plutôt que d’être à l’écoute, ils vont par la provocation, par la bousculade. Ce qu’on peut comprendre. On imagine ces personnages très investies, très engagées, à l’époque du Printemps érable. Après l’effondrement de leur mouvement, ils se sentent évidemment englués.
SL : Ils refusent ce recul, et ça les fait se raidir.
MD : Et ce qui ressort de cela c’est une certaine colère.
HC : Mais cette colère elle semble être déjà là chez eux. On le voit dans la scène de l’AG, où le personnage de Tumulto est déjà dans la colère et la hargne…
MD : Oui, mais elle ne fera que s’amplifier… Au fond le film se passe aujourd’hui. Suite à la fin du mouvement de 2012, eux, ils se sont retirés. Ils ont vécu ensemble dans cet appartement, en essayant eux-mêmes d’incarner toutes les valeurs qu’ils revendiquent. Et peu à peu il y a toutes ces insatisfactions, à cause de leur purisme. Ils sont hors du monde, et en étant hors du monde, ils ne peuvent pas le changer. Ils voient autour d’eux que le monde n’a pas changé comme ils l’auraient souhaité. Ce n’est pas suffisant d’incarner ces valeurs. Et devant cet immobilisme qui les entoure, il y a une rage qui gronde en eux et qui leur donne envie de crier comme Péloquin : « Vous êtes pas écoeurés de mourir bande de caves ! » Leur premier élan est de dire à leurs contemporains : « Réveillez-vous ! Ne voyez-vous pas le monde dans lequel vous vivez ! Pourquoi refusez-vous de le voir ? »

Ceux qui font les révolutions… (2016)
SL : Constatant l’échec de leur canular dont tout le monde finit par se moquer, leur réflexe est de retourner cette colère là contre eux-mêmes. Dans la mécanique interne du groupe. Ils se divisent, ils se chamaillent sur des logiques internes de procédures. Des querelles sur ce qu’on doit faire, comment. Et cela mine tout mouvement social. Comme à la fin du mouvement étudiant de 2012, les groupes en sont venus à s’entredéchirer, devant cette incapacité et ce refus, qui fait que la violence se retourne contre eux-mêmes. On l’a souvent vu au Québec.
HC : Il me semble que vous reprenez là un modèle assez classique et galvaudé de la révolution qui, s’il a existé au Québec, a été très marginal. Il y a un schéma historique de la Révolution, qui est animé par un grand espoir et qui déchante et se transforme en autodestruction. Le cinéma en a produit tout plein. Je pense entre autres à United Red Army de Wakamatsu, qui est tout entier construit sur un procès sado-masochiste. Cela devient au final une question pathologique et qui fait réapparaître le petit égoïsme, et les petites perversités personnelles des uns et des autres. Ce qui disparaît à chaque fois, c’est le la cause du collectif. Et je me suis donc demandé, devant cette courbe de la Révolution que vous singez dans votre film — on pense à Buongiorno, Notte de Bellocchio aussi —, s’il y a quelque chose peut nous inspirer, qui peut nous donner envie de nous engager. Car vous l’avez dit et répété comme à l’époque de Laurentie : on veut élever les consciences, secouer les barraques, comme si vous cherchiez à nous dire, comme vos personnages : « Vous, spectateurs, ne savez pas que vous êtes malheureux, ce film va vous l’apprendre ». En même temps, le schéma dramatique, et leurs motivations profondes qui se révèlent au fil du film, et leur destin final, est loin d’être joyeux et heureux. C’est l’aspect le plus violent et autodestructeur qui ressort. En quoi ce film nous réveille ? En quoi peut-il nous inspirer et nous amener à nous engager, si, dans le film, ceux qui cherchent à nous réveiller finissent par être des mauvais exemples ? Idem pour le personnage de Louis, dans Laurentie, qui n’est pas un exemple à suivre. Rien dans ces personnages de révolutionnaires que vous avez fabriqués ne nous invite à la mobilisation. Au contraire.
SL : Cette question me ramène à ton préambule qui semblait nous prêter l’intention d’être dans un engagement, dans une espèce de volonté de proposer des solutions. Laurentie et ce film se voulaient problématiques, remplis de paradoxes. Ce sont des films qui veulent dresser un constat lucide, qui cherchent à nommer les problèmes, et de voir comment il peut y avoir en ça un début de solution. Au Québec, nous sommes souvent bien en deça de nommer les problèmes. Il y a une sorte d’angélisme, de positivisme, d’optimisme, où on réalise des films pour se rassurer. On voulait faire des films qui sont difficiles.
MD : Qui se veulent aussi le reflet de choses que l’on ressent à un moment très précis. Laurentie parle je crois vraiment de son temps. Nous étions là pleinement dans un questionnement identitaire québécois. C’est terrible à dire, mais certainement il y a des liens entre ce qui s’est passé à Québec le 29 janvier et Laurentie. Je lis une similitude dans l’inconfort qu’éprouve notre protagoniste. C’est quelque chose que l’on sentait de façon souterraine à l’époque de Laurentie et que nous avons envie de décrire, sans avoir la prétention de comprendre où ça s’en va. On veut être la chambre d’écho de ce qui gronde dans la société et qui peut exploser. Pour nous la question nationale et identitaire ne peut pas être simplement balayée du revers de la main. Si on n’en parle pas, ça crée des ressentiments, et on a vu où ça peut mener.


Ceux qui font les révolutions… (2016)
HC : Il m’a semblé que Ceux qui font les révolutions porte davantage un regard sur la figure du révolutionnaire que sur le Québec. La partie du Québec, ou de la société, qui apparaît, est au fond très mince. Il y a bien sûr les citations qui renvoient et décrivent une société aliénée. Le Québec, on le voit au fond très peu. Il y a bien cette séquence, où vous enfilez une série de plans documentaires, très curieux, pris dans le Vieux-Montréal, dans des parcs, à des fêtes de la St-Jean…
SL : On voulait en fait montrer le contraste entre ce peuple qui ne sait pas encore qu’il est malheureux et ces jeunes qui se croient être aux avant-postes, à l’avant-garde de l’histoire. Ce sont des images de cette province tranquille, qui est à la fois notre chance et notre drame, et ce groupe reclus…
MD : Certaines de ces images font aussi écho au texte de Rosa Luxembourg que l’on cite plus tôt dans le film. Pour eux, aller passer un après-midi au Parc Lafontaine est une impossibilité. C’est quelque chose auquel ils se refusent. Leur engagement est rendu à un niveau inhumain. Ils s’égarent là-dedans. Tu parles de la figure du révolutionnaire. Au fond ce qui nous intéressait c’était l’idéalisme. Jusqu’où être idéaliste, quand va-t-on trop loin, comment changer les choses ? On essaie de parler d’une complexité du monde contemporain. Les ennemis auxquels s’attaquer ne sont pas très ciblés…
HC : Justement, qui sont les ennemis ? La gentrification de certains quartiers, qui est traitée de manière assez frontale et caricaturale. Les parvenus bourgeois, le consumérisme ? La violence policière, qui l’on perçoit dans les vidéos… On prend également pour cible l’écologiste de quartier, trop angélique. Le constat est-il là ?
SL : Eux ne les nomment pas et nous non plus. L’important c’est qu’ils refusent le monde tel qu’il leur est tendu. Ils sentent, tout comme nous, qu’il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et qui doit être changé. Que le réel est décevant. Ils ont l’intuition que la vie pourrait être plus que ça…
HC : Mais leur identité n’est qu’une réponse critique au monde, mais ce monde, on le voit assez peu finalement. Tout ce que vous nous montrez semble s’inscrire dans un contre-courant. J’aurai voulu plutôt voir en quoi, par leur mode de vie, ils recréent une sorte d’utopie, une autre manière de vivre. Vous le montrez un peu dans les rituels, mais il me semble que tout cela est plutôt inscrit négativement par rapport au monde.
MD : Même s’il y a une complexité des enjeux, au fond, l’ennemi au final c’est l’individualisme. Leur groupe se défait quand les individus se détachent. Le personnage de Ordine Nuovo qui s’immole, pose un acte totalement individualiste. Ça signe la fin. Le groupe se dissout précisément quand chacun emprunte une voix personnelle.
HC : Il me semble que la motivation de l’engagement, à chaque fois, dans votre film, est rattaché à un contexte psychologique, qui a trait au milieu social ou à la famille, comme si la révolution était avant tout une révolte adolescente contre la famille. Rien de plus. Hormis Klas Batalo, dont on ne sait à peu près rien du milieu d’origine. Mais là encore, c’est comme si son engagement était inséparable d’une « déviance » par rapport à la norme et lui était entièrement attribuable.
SL : Ce n’est pas le cas pour tous les personnages. Même si certaines personnes nous en ont accusé, on ne voulait pas réduire les personnages à ça, ni on ne pense qu’il faille amalgamer comme ça les choses. Clairement, le personnage de Giudizia est dans une rupture de banc avec son milieu, pas juste avec sa famille. C’est avec ce milieu de québécois bourgeois satisfaits, de gauche bobo, souverainistes fatigués et repus.
HC : Un peu cliché d’ailleurs… Il me semble que cette psychologisation du militantisme est un peu limitée. On sait que le père d’Ordine a été absent, la mère un peu misérable vit en banlieue et prend des photos de son assiette de bouffe.
MD : À l’époque de la préparation du scénario, on a cherché à nous pousser davantage dans ses ornières psychologisantes et on s’y est refusé. On a intégré certaines informations, notamment sur le père absent d’Ordine Nuovo, parce que je pense qu’on a beaucoup de difficulté à croire que l’on puisse s’engager simplement par le fait de regarder autour de soi et d’avoir une soif de justice sociale. Sans vouloir faire de mauvais amalgames, mais quand Hubert Aquin a pris le maquis et qu’il s’est fait arrêté il a plaidé la folie pour ne pas aller en prison. Mais Ordine Nuovo, dans le film, refuse elle-même cette explication. Elle essaie de distinguer sa petite histoire personnelle de son engagement, qui repose selon elle sur des bases plus profondes.
HC : Qui ne sont néanmoins jamais parfaitement claires à mon avis. Je voulais vous parler de la place de la poésie, et du texte, dans ce film-ci ainsi que dans Laurentie. Il y a évidemment beaucoup de liens formels par la manière dont les textes apparaissent, qu’ils occupent l’image. Parfois en palimpseste, parfois en dialogue, en commentaire, parfois en contre-point, la poésie n’est jamais là systématiquement pour la même raison ni ne sert la même fonction.
SL : Il y a aussi beaucoup de textes sur les murs de l’appartement.
HC : C’est quelque d’assez classique dans le cinéma militant. Solanas, Godard, chez d’autres. On est au cinéma, mais au cinéma parfois il faut lire, s’éduquer, réfléchir.
SL : Ça suscite un effet particulier aujourd’hui. Ce n’est pas si fréquent que ça de nos jours.
HC : Mais vous faites appel par ce biais à une forme qui existe du cinéma politique depuis le cinéma soviétique, dont Godard hérite, qu’on retrouve dans des films comme L’heure des brasiers et d’autres classiques du cinéma militant ou engagé. La fonction de la poésie dans Laurentie, en même temps, est à la fois similaire, plastiquement, et en même temps assez différente. Le texte dans Ceux qui font les révolutions représentent les assisses politiques sur lesquelles les personnages s’arc-boutent pour assurer leurs propres convictions, leur système de pensée. C’est ce qu’ils se martèlent à eux-mêmes, et nous martèlent. Et c’est souvent, il me semble, votre voix qui parle à travers.
MD : En fait, c’est assez différent entre les deux films. Dans Ceux qui font les révolutions, la musique joue le rôle que la poésie jouait dans Laurentie. Dans Laurentie, la poésie elle ne commande jamais directement l’action. On est clairement à un autre niveau, que ce que l’on voit à l’écran, d’un point de vue discursif, dramatique et narratif. Pour nous, dans Laurentie, la poésie est le dernier espoir de ce film-là. Cette idée du sublime qui pourrait tirer Louis vers quelque chose d’autre que le geste qu’il va poser à la fin du film. C’est comme une main qui est tendue mais qu’il ne saura pas saisir, ou qu’il ne saisira pas assez tôt. Dans Ceux qui font les révolutions, la musique joue ce rôle là.
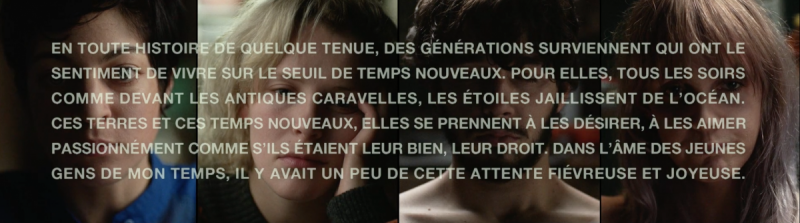
Citation de Lionel-Groulx dans Ceux qui font les révolutions… (2016)
SL : Même si formellement les textes apparaissent de façon similaire, je crois qu’ils fonctionnent sur un autre mode. Dans Laurentie il y avait aussi cet aspect plus conceptuel. Le personnage tombe sur cette anthologie de la poésie québécoise. Du coup, les textes pouvaient apparaître comme des textes qu’il avait lus. Les textes dans Ceux qui font les révolutions sont vraiment rattachés à nos personnages, à leur façon d’être. Ils sont sur les murs de leurs appartements, et de les accrocher à l’écran, il n’y a qu’un pas. Ils sont des intellectuels, mais sont hélas postmodernes. Et ne peuvent donc se référer qu’aux luttes passées. Les exemples qu’ils chérissent et fétichisent sont dans le passé.
HC : Mais je me demande si ça ne pose pas problème justement. Les références sont d’Aimé Césaire, Aquin, beaucoup de références concernent le néocolonialisme, les luttes anti-impérialistes ; il y a aussi des poètes très inspirants, des poètes québécois, Josée Yvon, Miron ; il y aussi des penseurs révolutionnaires, comme Rosa Luxembourg, des auteurs du XIXe siècle, Saint-Just, des penseurs nationalistes, comme Lionel-Groulx. Quand j’écoute et je vois ce que les jeunes militants, les intellectuels impliqués dans un questionnement politique, lisent aujourd’hui, on voit bien que vos références sont décalées, le vocabulaire et, partant, la conception du politique n’est pas du tout la même. Leurs auteurs sont Agamben, Rancière, Foucault, Butler, le comité invisible, et tant d’autres, qui posent la question du politique et de la révolution sur d’autres modalités que celles de la lutte armée anti-impérialiste. Et leurs actions politiques reflètent, de différentes façons, la pensée de ces auteurs. Ils ont une conception de la révolution moins verticale (où il s’agit de renverser le pouvoir), mais horizontale, où il s’agit de poser une série de gestes et d’actions qui vont enrayer le système et mener à des soulèvements, des insurrections qu’on espère permanentes. La résistance s’organise du coup horizontalement selon une logique du sabotage, du parasitage, du sable dans l’engrenage. S’y mêlent la culture des hackers, les tactiques très sophistiquées du black block. C’est une pensée de l’interruption et de l’anonymat. Les protocoles d’actions révolutionnaires contemporains ressemblent davantage à ça qu’à ce que vous dépeignez dans votre film. N’y a-t-il pas un décalage entre un front d’action et de lutte réellement contemporain et ce que vous montrez dans votre film ?
SL : C’est voulu. On ne voulait pas faire un film qui explorait de façon précise le Printemps érable et le mouvement étudiant. Le film va au-delà de ça. On ne voulait pas se limiter à faire de la recherche au style human interest et rester collé aux penseurs qui les inspiraient. On voulait aller dans quelque chose de plus large, d’où le fait de citer Camus, de remonter à des penseurs un peu oubliés comme Kropotkine, Renan, Lionel-Groulx, même St-Just. C’est sûr qu’il y a un décalage, il est voulu. C’est pas un portrait du jeune révolutionnaire de 2012 ou 2017. C’est pas un film réaliste en ce sens-là et les gens qui nous pourfendent sur cette base là ont tort…
HC : Quelqu’un qui a milité durant le mouvement étudiante et qui est encore actif politiquement qui tombe sur votre film en disant je vais aller voir ma génération à l’écran, a de quoi être totalement désemparé ou fâché. Il ne se reconnaîtra pas. Il dira : « Ce n’est pas ma révolution ! »
MD : Il va être fâché. Et il ne devrait pas aller voir le film pour ça. Parce qu’effectivement il ne se reconnaîtra pas. On n’avait pas cette prétention. C’est pas par méconnaissance ni par manque d’intérêt. On aurait pu s’assoir avec des jeunes qui étaient engagés. Cet exercice je l’ai fait quand j’ai fait Corbo. J’ai rencontré de felquistes, des camarades de Jean Corbo.
HC : Parce que tu faisais un film ouvertement historique ?
MD : C’était un récit historique. En effet. Dans ce cas-ci, c’est assez différent. Nous partions d’un événement qui nous avait fasciné, interpelé, confronté. Mais on avait envie de le transcender. On avait envie de parler d’autre chose que du Printemps érable. On voulait le présenter dans un horizon international, dans un horizon historique, et de parler de notions qui transcendaient le caractère ponctuel de l’événement historique. Pour cette raison-là, nous nous inspirons d’événements précis qui se sont déroulés, comme l’épisode des bombes fumigènes dans le métro, ce qui se passe en cour, etc., mais ultimement on n’avait pas envie d’être limité au réalisme.
SD : C’est incroyable André à quel point on nous reproche ça, comme si c’était un crime de de lèse-majesté. Comme si on n’avait pas un droit de regard sur ces événements-là. Comme s’il avait fallu absolument se faire frapper par les policiers et passer des nuits en prison pour pouvoir un tant soit peu savoir de quoi on parlait. Mais bien au contraire. Nous on revendique une position comme un peu en retrait. On est partie prenante du monde mais on a une perspective… pas en périphérie mais avec une vue d’ensemble. Ces lectures là ne nous viennent pas d’une recherche qu’on a faite en écrivant le scénario. Elles nous viennent d’un cheminement intellectuel que moi et Mathieu partageons depuis 6-7 ans. D’un film à l’autre, d’une découverte à l’autre. Quelqu’un nous révèle l’existence de Jean Bouthiliette, on découvre Fernand Dumont, etc. L’idée c’est plutôt de faire un film qui transcende le mouvement social de 2012, mais qui le poétise…
HC : Alors il y a ça qui peut porter à confusion. À la fois dans la mise en marché du film, mais aussi dans la manière — et la même chose m’avait frappé pour Laurentie — dont vous présentez le film sur deux niveaux qui se côtoient et qui créent des frictions : vous dressez, ou prétendez en tout cas dresser un constat qui se veut réaliste, ou du moins qui rend compte de la réalité contemporaine, et en même temps, le chemin que vous adoptez pour parler de cette réalité-là a une dimension transhistorique qui dépasse le présent historique auquel vous vous attaquez. Il y a une dimension archétypale, mythique. On y retrouve une propension mythologisante qui peut me convaincre en soi, mais qui du coup n’a plus rien à voir avec la réalité contemporaine à laquelle vous semblez vouloir vous attaquer.
MD : Avec des films de ce genre-là, on a tendance à oublier que nous, on est des dramaturges finalement. On fait du cinéma de fiction. On s’intéresse à la fictionnalisation de certains éléments. On pourrait reprocher à Shakespeare de ne pas avoir été très précis historiquement par rapport aux événements auxquels il faut allusion. C’est qu’il s’intéresse à quelque chose d’autre. Sans vouloir nous comparer à Shakespeare, pour nous, c’est un peu la même chose. On ne prétend pas faire des documents sociologiques, ethnographiques, anthropologiques. On fait des films. Il y a toute une valeur artistique, formelle, qui nous intéresse, dramatique.
HC : Est-ce que vous sentez que vous donnez à vos personnages tout ce que vous pouvez leur donner par rapport au conflit qui est là ? Quand je lis des textes contemporains sur les révolutions, ce n’est pas du tout le type de considérations qui sont dans votre film. Aller puiser dans des références qui sont datées, forcément, c’est voué à l’échec, ça ne peut plus s’actualiser dans la complexité du monde aujourd’hui.
MD : Peut y a-t-il des leçons à tirer. Tu parles de quelque chose qui est perpétuellement voué à l’échec, et justement dans notre film, il est question de ce perpétuel inachèvement. Il y a peut-être des leçons à tirer du passé. Cet inachèvement qui se répète sans cesse, d’où vient-il ? Et peut-être y a-t-il dans certaines lectures qui ne sont pas actuelles, des réponses. Encore une fois, ce film, on a voulu le placer dans un contexte plus large que celui dans lequel il est né, qui transcende le côté très ponctuel de son événement.
HC : Mais à ce compte-là est-ce que vous leur donnez toutes les armes possibles ?
SL : On a essayé de tout faire en trois heures ! On a essayé de rentrer dans ces personnages-là, leur logique interne, leurs tiraillements, essayer de les construire, et en même temps on avait toutes sortes d’autres ambitions, de telle sorte que ça a fini par faire un truc baroque qui explose. À un certain moment il faut aussi que les personnages nous glissent des mains, parce que leur logique interne les font se déployer. Les acteurs, eux, amènent des choses. Charlotte et Laurent qui ont participé au mouvement, ont participé à la construction de leurs personnages.
HC : Est-ce que les acteurs ont influencé le scénario ? Ont-ils participé à l’élaboration de leurs personnages ?
MD : Les acteurs n’ont pas eu un rôle direct dans l’écriture si ce n’est dans la réécriture de certains dialogues qu’on a fait en cours de répétition. Mais ils apportent énormément d’eux-mêmes dans leur jeu, dans leur manière d’être. Ça apporte énormément au personnage. Il y a des personnages qu’on avait écrits d’une certaine manière et on les a complètement changés une fois qu’on a tourné le film parce que…
SL : Même au moment du casting. Quand on a trouvé Gabrielle Boulianne-Tremblay, par exemple…
HC : Le personnage était transgenre à la base ?
SL : Oui, mais disons qu’on avait un transgenre d’un autre type. C’était très difficile de trouver l’actrice telle qu’elle était dans le scénario.
MD : Il y a deux choses. D’une part, on ne connaissait pas de transgenre personnellement. On n’en avait pas rencontré. Une partie de la représentation qu’on en faisait n’était peut-être pas tout à fait juste par rapport au caractère qu’une telle personne peut avoir. Et puis ensuite, la chose qui pour nous était une condition sine qua non, était qu’il n’était pas question qu’on engage un acteur à qui on allait mettre une perruque, ou une actrice à qui on allait mettre une prothèse. On avait envie d’avoir une vraie personne transgenre qui avait l’apparence que Gabrielle a dans le film et donc ça, ça ne court pas le bottin de l’UDA. Je crois qu’il existe une actrice transgenre dans le bottin. Donc on a dû faire un gros processus d’audition, de rencontres, de discussion. On allait dans des événements pour rencontrer des gens, pour parler…

Gabrielle Boulianne-Tremblay dans Ceux qui font les révolutions… (2016)
SL : Même pour les autres rôles, beaucoup s’est joué dans le casting. Il y a toujours des rencontres. Le scénario s’est beaucoup nourri de ce processus de casting. Éventuellement, les répétitions et les ateliers qu’on a faits, une part d’improvisation aussi qui s’est faite sur le plateau. Ce film là aurait pu être complètement différent en fonction du casting.
HC : Vous nous avez précisé que Charlotte et Laurent avaient été impliqués dans le mouvement en 2012, qu’ils étaient engagés. Est-ce que c’était important pour vous que ce soit des gens qui soient, dans leur vie, impliqués et engagés, d’une manière ou d’une autre ?
MD : Personnellement, ce n’est pas nécessairement important, car au final ce sont des acteurs qui interprètent des rôles. Ceci étant dit, dans ce cas là, ça le devenait par la force des choses puisque quelqu’un qui n’est pas engagé ne voudra pas prendre part à un film comme ça. On a eu des gens qu’on a convoqués en audition qui n’ont pas voulu venir parce qu’ils trouvaient que c’était trop controversé, qu’ils ne voulaient pas se mouiller avec ce genre de projet là. Il y a la portée politique du film, bien sûr. Il y a aussi le fait que les gens étaient sous-payés parce qu’on avait peu d’argent. Par la force des choses les gens qui venaient devaient être engagés.
HC : J’aurais voulu vous entendre parler de la musique, qui joue un rôle très important dans le film, notamment avec cette grandiose ouverture, avec la pièce d’Alan Hovanhess, Requiem and Resurrection. Ce qui nous ramène à la forme du film, avec ce caractère je dirai « grand film », avec Ouverture dans le noir et Intermède, qui récupère une part spectaculaire de l’histoire du cinéma, qui va de Ben Hur à 2001 disons. Ça confère un caractère épique au film.
SL : Pas juste épique. Ce type d’ouverture crée aussi des effets. Plutôt que d’être confronté à des bandes-annonces et des couleurs criardes, suite à quoi ton film commence, ça crée un moment de recueillement. Ça fait un sas, un tampon entre les inévitables publicités et, avec ce cinq minutes de noir, qui place le spectateur dans un certain état d’esprit dans lequel il se trouve rarement, parce qu’il vient tout juste de voir une publicité de McDonald. Il y avait cette idée-là. Bien sûr, il nous est venu à l’esprit les grands peplums, mais c’était davantage l’idée du recueillement qui nous attirait.
MD : Tout à fait… Tu parlais de cette référence à l’histoire du cinéma. C’est vrai. Mais ce n’est pas juste là. Il y a tout un dialogue avec l’histoire du cinéma. Il y a cette idée qu’à l’époque on faisait des ouvertures et des intermèdes. Pourquoi ne le fait-on plus ? Ça nous semblait intéressant pour la réponse que Simon vient de donner, mais aussi parce qu’on joue avec diverses époques du cinéma dans ce film-là. On est obligé pour des raisons économiques, de tourner en format numérique. Cette même caméra tourne 30 vies et des publicités. Elle donne un fini un peu standardisé. On avait envie de s’éloigner de ça. Donc on est allé chercher des vieux objectifs russes anamorphiques qui datent des années 1960, et on les place sur une caméra qui ne devrait pas être utilisée avec des objectifs anamorphiques parce qu’elle a un capteur 16:9. Mais soudain, cela crée un dialogue entre les époques, en faisant s’entrechoquer des technologies qui n’auraient jamais dû se rencontrer.
HC : Est-ce que c’est aussi ce qui explique le changement de format, entre le scope, le 1,85 ou des formats plus carrés.
SL : C’était souvent la nature des images. Toutes nos images d’archives étaient en 4:3 ou en 1,66. L’idée d’avoir nos propres images dans ces formats-là nous plaisait et l’idée de transgression : pourquoi se limiterait-on ? Puisqu’on s’est donné la licence, certains pourraient ne pas être d’accord, de faire à notre sens un essai cinématographique. En partant de là, il y avait l’idée du film de montage. Tu parlais plus tôt de L’origine du XXIe siècle et de d’autres films de Godard. Il y a quelque chose d’inspirant dans les effets que ça peut produire, dans une œuvre au long cours…
HC : On retrouve un peu ce type d’hybridité matérielle qu’on a aussi chez Godard, où on oscille souvent dans le même film entre une image numérique très léchée et des images terriblement pixélisées, au niveau du son et de l’image.

Image d’archives dans Ceux qui font les révolutions… (2016)
SL : Il y a une création de sens qui peut naître dans l’opposition que peut produire le fait de voir le chanoine Lionel-Groulx, de voir soudainement des images en couleur qui sont bouleversantes pour moi, quand on voit la procession aux Éboulements. Ce sont des images en couleur de 1943.
MD : C’est des images de Jane Marsh, tournées en kodachrome [Terre de nos aïeux, 1943].
HC : J’aimerai rebondir puisque vous en parlez, à ce montage, où vous juxtaposez cette procession religieuse des années 1940 avec des plans de manifestation en 2012. Le son des cloches et les chants du film de Marsh se poursuivent sur les plans des manifestants… Est-ce qu’il n’y a pas quelque chose de problématique à associer ainsi ces deux types de manifestations ? Dans votre esprit, comment sont liés ces deux moments de procession ?
MD : On parle d’individualisme tout à l’heure. Je pense qu’il existe une désagrégation des communautés, des espaces communs, des rassemblements communautaires. Dans le film, on en met deux en parallèle. On ne pose pas de jugement sur l’un ou sur l’autre. Ce qui nous intéresse, c’est le fait qu’il s’agisse de deux rassemblements communautaires. C’est que ce sont deux images où le peuple se réunit…
SL : Qu’à peine soixante-dix ans sépare…


Terre de nos aïeux (1943) et Image d’archives d’une manifestation du printemps 2012, reprises dans Ceux qui font les révolutions… (2016)
HC : Certes, mais dans un cas il est réuni par une obligation sociale qui forçait tout le monde à aller assister à la messe ou aux processions. Dans l’autre, ce sont des manifestants qui se font tabasser par les flics. Je suis d’accord qu’il y a deux formes de rassemblements, mais…
MD : Oui, mais ils se réunissent pour célébrer quelque chose qui les transcende, qui est plus grand que leur propre individualité. Et ceci nous semblait intéressant. Et je pense qu’il est là le parallèle. De la même manière qu’on met en parallèle un passage des Justes de Camus avec cette image de Lionel-Groulx. Ça parle aussi de notre histoire. On ne dit pas du tout qu’on regrette le joug que la religion avait, mais il faut qu’on se souvienne de ces choses-là, qu’on sache d’où on vient.
SL : Il faut aussi voir par quoi on les remplace ces choses-là. Le vide qui fait place à ces tables-rases, il faut le questionner aussi.
HC : Oui, mais les formes que peuvent prendre ce type de questionnement diffèrent grandement. Ça peut prendre les formes d’un discours éclairé et d’ouverture. Ça peut aussi avoir l’effet inverse d’un repli identitaire autour d’un « nous » idéalisé et essentialisé autour d’une histoire collective qui n’a jamais vraiment existé sous cette forme. Ça condamne souvent à l’idée d’un destin de la nation lié à son passé, qui peut dériver dans des directions assez terribles. Sans dire que vous vous réclamez de la pensée de Lionel-Groulx, il demeure que ceux qui évoquent le plus souvent Lionel-Groulx aujourd’hui ne sont pas nécessairement des enfants de chœur.
SL : Je suis bien d’accord. Ce contre quoi on proteste, c’est le fait que ce penseur soit devenu persona non gratta. Il y a des limites au révisionnisme, quand on désire renommer la station Lionel-Groulx par exemple, c’est complètement déconnecté. On sait que c’est litigieux, et on se cachera pas qu’on a un désir de provoquer, pas au sens cabotin du terme, mais au sens d’une transgression de la rectitude politique. Mettre cette cérémonie à côté d’images de manifestants…
MD : … ça nécessite une réflexion à tout le moins. Dans ce film, je crois qu’on lance beaucoup de questions, plus qu’on a envie de lancer des réponses. Ce sont des questions qu’on se pose. On est confrontés à tout ça à chaque jour. Cette provocation est aussi un appel au dialogue, à la réflexion, à une interrogation, à une remise en question. Il y a tout plein d’idées préconçues qu’on reçoit et qu’on ne peut pas remettre en question. Nous on a la prétention de dire qu’il faut parfois remettre certaines idées en question et aller au fond des choses.
HC : Le film a eu un immense succès à l’étranger, dans le circuit des festivals. Or, l’essentiel des références, sauf exception, renvoie à un ancrage culturel québécois très précis. Est-ce que ce succès est dû au fait que ces questions sont universelles ou à autre chose ? Est-ce que, plus précisément, pour vous, c’est l’aspect universel de ces questions qui vous intéresse, ou l’ancrage dans le contexte québécois ?
SL : Le film est destiné aux Québécois. C’est extrêmement satisfaisant ce succès puisqu’on essaie de témoigner d’ici et de maintenant et non de faire un film désincarné et décontextualisé, sans repères, dans l’espoir d’intéresser un public international. Ça valide notre démarche, et ça invalide ces films qui se déroulent dans des non-lieux.
HC : Je me suis demandé si ce n’est pas un aspect du film. Il est tout à fait ancré dans un lieu, mais il y a une qualité archétypale au film. Il y a beaucoup de choses qui font appel à une histoire commune du cinéma, et qui, peut-être, explique l’écho ou la bonne réception qu’il reçoit à l’étranger. C’est une réflexion que je m’étais d’ailleurs faite par rapport à ce qui m’avait emballé, mais aussi ce qui m’a quand même irrité dans ce film. Si cette œuvre nous venait de Slovénie ou de Taiwan, j’aurais pu totalement adhérer à la proposition. Peut-être parce que le film prétend parler de quelque chose de local, et d’un mouvement réel, existant, je ressens un décalage frappant entre ce que le film nous montre et la réalité. Malgré l’intérêt que j’y ai pris, il y a des choses pour moi qui ne passaient pas. Parce que j’ai accompagné le mouvement et que beaucoup d’amis y ont été profondément impliqués. Ma lecture est évidemment différente que si j’étais un spectateur slovène ou taiwanais devant le même film.
MD : Effectivement.
SL : Il existe par contre, pour répondre un peu à la première question, un malaise, un mal-être que l’on partage avec beaucoup de sociétés occidentales.
HC : La question de l’action aujourd’hui est évidemment centrale et tout le monde qui s’engage se la pose. Je ne pense pas que le film pose cette question de façon qui est actuelle, voilà tout, et qui peut être utile pour la lutte aujourd’hui. À partir du moment où on est inscrit dans une démarche révolutionnaire, on veut changer les choses, on veut éveiller les consciences, bien, reprenant la vieille question de Lénine, « Que faire ? » Il y a deux gros modèles proposés dans le film : le modèle un peu ridicule de la ruelle verte, où on change le monde un «ilôt de chaleur à la fois », et l’autre, qui est celle de l’intervention radicale, terroriste, calqué je dirai sur le terrorisme politique du passé, plutôt que des formes actuelles de tactiques révolutionnaires. Car il existe d’autres modèles que ceux que vous proposez. Ça pose la question de l’action et le rôle de la violence au sein de l’action, qui est la question de Camus, de Fanon, d’Aquin, jusqu’à Negri, qui se sont posés cette question. Cette question demeure irrésolue dans le film : ce que le film montre c’est que la violence est une forme d’action, plutôt qu’une réponse, par exemple, à la violence policière ou sociale. Les mouvements anarchistes disent que leur violence est située et justifiée dans un contexte de confrontation avec les forces de l’ordre. La question des protagonistes de votre film, qui fut celle du FLQ ou des brigades rouges des années 70, c’est que la violence est un moyen d’éveiller les consciences, de secouer la torpeur. Est-ce que c’était important pour vous de poser le recours à la violence, dans un contexte où le mot terrorisme violent n’a pas nécessairement bonne presse ?
MD : Bien sûr, c’était important. Devant le malaise que nous éprouvons, quel remède apportons-nous ? Il y a plusieurs solutions. La question qu’on pose est la suivante : « qu’arrive-t-il si on persiste à couper la parole à ceux qui essaient de la prendre ? » En 2012, c’est ce qui est arrivé finalement. Une génération s’est levée, est sortie dans la rue, en refusant la version du monde qu’on leur proposait, tout en proposant une autre voie. Qu’est-ce qui s’est passé : on les a tournés en ridicule dans les médias, on les a traités de casseurs, on les a foutus en prison, on a mis en place des lois bidons pour les empêcher de prendre la parole et de s’exprimer dans l’espace public, on les a tabassés, etc. La question que nous posons est aussi celle-là : est-ce qu’on s’imagine qu’un jour certaines de ces personnes-là ne vont pas ressentir une frustration tellement grande qu’il va leur apparaître qu’il n’existe pas d’autre solution que la violence. C’est ça la question ultimement.

Ceux qui font les révolutions… (2016)
Propos recueillis le 3 février 2017 par André Habib et Renaud Desprès-Larose. Captation audio: Renaud Desprès-Larose. Retranscription: André Habib. Un grand merci aux cinéastes pour leur générosité et pour les images du film.
