AURA, DESTRUCTION ET REPRODUCTIBILITÉ NUMÉRIQUE
Dans le cadre de la très belle programmation de cinéma expérimental au FNC 2011 (FNC Lab), nous vous redonnons à lire cet article publié en 2008. Pendant le “FNC Lab”, auront lieu entre autres événements :
- Une performance de Jürgen Reble & Thomas Köner le 13 octobre à 20h30 au Quartier Général du FNC (Agora du cœur des sciences de l’Uqam).
- La présentation de films et vidéos de Jürgen Reble & Thomas Köner, le 15 octobre à 19h30, à l’espace cinéma du centre Segal.
- La présentation de trois films de Bill Morrison (pour plus de détails, cf. l’entretien avec Bill Morrison à notre sommaire)
——-
« La vieillerie poétique avait une bonne part dans mon alchimie du verbe. » (Arthur Rimbaud)
Paolo Cherchi Usai, dans un ouvrage aphoristique, écrit sur une période de plus de dix ans (1987-2001), The Death of Cinema 1 , propose (bien que ce ne soient pas ses termes) une véritable ontologie radicale de l’image cinématographique, dont l’axiome central est : « Cinema is the art of destroying moving images ». Sa thèse complexe, étrange, mais symptomatique de la période couverte par la rédaction de l’ouvrage, repose sur l’idée que le cinéma n’est pas un art de reproduction, mais de répétition : la projection d’un film peut être répétée, mais à chaque fois, il s’agit d’une expérience singulière. Si le cinéma était un art de la reproduction technique, cela supposerait que chaque copie est absolument identique alors que, dès qu’elle est tirée, chaque bobine commence déjà à subir un processus de destruction, résultant de la projection répétée du film, de ses conditions de stockage, et d’un ensemble d’autres facteurs. Cherchi Usai fait ainsi entièrement dépendre l’histoire du cinéma des contingences que le film peut subir et des aléas de la perception du film elle-même (notre perception, à chaque fois, ne capte qu’une partie seulement des images). Une image qui ne se dégrade pas, selon un autre de ses axiomes, ne peut avoir aucune histoire 2 . Dorénavant, Les références à cet ouvrage seront indiquées directement dans le corps du texte, par le chiffre de l’aphorisme (en caractères romains), suivi de la page. ]] : le film ne s’introduit dans l’histoire du cinéma qu’à partir du moment où il devient sujet à la dégradation physique (XVII, p. 39). Le cinéma serait, de ce point de vue, plus près de la performance musicale (XLIX) et de la littérature orale (XXVII, p. 59) que de la reproduction technique pure et simple 3 . Chaque projection est une occasion unique, non reproductible, mais réitérable, c’est-à-dire se répétant en produisant de la différence (comme le montre Deleuze, « la différence est entre deux répétitions 4 . »)
Cherchi Usai tente de susciter une réflexion sur l’histoire du cinéma qui prendrait acte des spécificités véritables du support filmique en soulignant le hic et nunc de chaque expérience de projection, rendant toute restauration d’une expérience originale impossible (« on ne peut entrer deux fois dans le même fleuve », dirait Héraclite). Cherchi Usai propose un éloge de la passivité, qui permettrait à chaque « moving image » de poursuivre son histoire : il faudrait adopter des mesures afin d’offrir :
« […] a respectful control of the processes of decay, serving as an invisible guide through the various ages of the moving image with a vigilant yet unobtrusive attitude towards the indicators of the process (patina, material and narrative gaps, colour fading, sound degradation). » (LI, « In praise of passivity », p. 107)

Lyrical Nitrate (Peter Delpeut, 1991)
Accepter la matérialité du film, sujette au pourrissement, et reconnaître l’unicité de chaque projection, revient à reconnaître l’historicité propre au cinéma, sa condition de possibilité. Le cinéma a été conçu pour préserver l’éphémère et conserver une trace de ce qui disparaît : le fait que les images de cinéma soient elles-mêmes sujettes à « l’impermanence » en serait la « contrepartie empirique », mais qui lui confère son statut en tant qu’artefact culturel, « objet de mémoire » (XXX). C’est précisément ce qui, selon lui, distingue le cinéma des technologies numériques qui produisent des images qui ne se dégradent pas et ne peuvent, de facto, s’inscrire dans un processus historique. Les choses n’atteignent leur plus haut degré d’historicité, comme pour le Benjamin du Trauerspiel 5 , qu’en se soumettant à la règle de corruption de la nature. Cherchi Usai, en condamnant le Digital Dark Age (sous-titre de son livre), reprend pour son compte, et sans doute sans le savoir, un long débat philosophique à propos de la Naturgeschichte 6 (nature-histoire). En faisant de la dégradation matérielle la condition de possibilité de l’historicité du cinéma, il relie l’histoire de notre « mémoire culturelle » à son inéluctable finitude, au cycle naturel de la décomposition des corps.
Dans le prolongement de la pensée de Cherchi Usai, il est intéressant de constater une réévaluation rétroactive de la notion d’aura, formulée par Benjamin. Il semble que l’une des choses qui frappe les observateurs de la chose cinéma (je pense à Dominique Païni notamment), c’est le fait que, à mesure que le temps passe, que la télévision, puis la vidéo, le numérique et la multiplication des supports de diffusion diversifient l’accès aux œuvres, la pellicule filmique se trouve bonifiée des traits de l’aura, que le cinéma, selon Benjamin, avec les autres arts de la « reproductibilité technique », était censé avoir liquidé 7 . Un lecteur contemporain de L’origine de l’œuvre d’art serait en effet frappé de constater à quel point certaines des propositions qui s’y trouvent sur « l’œuvre d’art authentique », le « travail de l’histoire », peuvent aujourd’hui s’accorder avec la réalité du cinéma et avec l’expérience cinématographique en salle en tant que telle. La copie est devenue, avec le temps, en raison de son existence matérielle et optico-chimique, un authentique original, doté « d’alterations matérielles », de « singularité », de « possesseurs successifs », etc.
L’extraordinaire proximité de l’image aujourd’hui, « peu importe sa distance » (on peut visionner un film à la maison, dans l’avion, sur son téléphone portable), et sa parfaite malléabilité font en sorte que la projection en salle d’une copie en 35mm d’un film rare soit dotée de tous les traits du hic et nunc de l’œuvre d’art authentique, comme une « apparition unique d’un lointain, aussi proche qu’il soit ». Si, selon Benjamin, « sentir l’aura d’une chose, c’est lui conférer le pouvoir de lever les yeux », on pourrait rappeler avec Godard, que « la différence entre cinéma et télévision [c’est que] quand on va au cinéma on lève la tête et les acteurs sont plus grands que nous. À la télévision, on baisse la tête et les acteurs sont plus petits 8 . » Imaginez un téléphone cellulaire ou une petite fenêtre sur Youtube…
C’est donc avec ces idées que je m’étais intéressé – notamment dans les pages d’Hors champ – aux œuvres de Peter Delpeut, Bill Morrison, Angela Ricci-Lucchi et Yervant Gianikian, qui tentent par leur propre moyen de nous montrer chaque fragment de pellicule comme unique, rescapé du temps et voué à disparaître.

Decasia (Bill Morrison, 2001)
Reble, Bourque, Lemieux
Delpeut, Morrison ou encore Éric Rondepierre ne font que « prélever » sans les modifier physiquement les fragments de films ou les photogrammes qu’ils remploient. En d’autres termes la « matière » visuelle demeure intouchée : la décomposition est « naturelle » et elle est le fruit du passage du temps (même si elle peut être accentuée par le ralenti, le recadrage ou l’arrêt sur image). D’autres cinéastes-artistes vont allier à la pratique du found footage des opérations physiques qui modifient la matière, la chimie et la nature même du film, accélérant sa destruction pour faire émerger des nouvelles créations et des nouvelles configurations sensibles. Disons que si les premiers sont des « archéologues-chiffonniers », ces derniers sont plutôt des « alchimistes » (et ils constituent d’ailleurs, pour filer la métaphore, une sorte de franc-maçonnerie « hermétique » à l’intérieur du cinéma expérimental) : ils transforment très souvent une materia prima, une matière brute, relativement vile ou banale (films de série B, western anonyme, film anonyme, film pornographique, film industriel, film de famille), en « étincelle d’or » (pour reprendre l’expression de Rimbaud 9 ). Dans cette constellation de films qui partagent des mêmes « affinités électives », je voudrais présenter très brièvement les œuvres de trois cinéastes, Jürgen Reble, Louise Bourque et Karl Lemieux 10 .
La métaphore alchimique, ou l’idée du cinéaste comme « alchimiste » n’est pas innocente ici, et d’ailleurs elle n’est pas de mon invention : Jürgen Reble, cinéaste allemand, né à Dusseldrorf mais vivant en Autriche s’est auto-attribué le titre. L’idée lui serait venue après avoir mis la main sur une version allemande en 16mm d’un film pour enfants adapté d’un conte des frères Grimm, « Rumpelstilzchen ». Dans ce conte, il est notamment question d’une vieillard qui file de la paille et la transforme en or, en la faisant passer au travers d’un rouet 11 http://pegasus.ouvaton.org/article.php3?id_article=90 ]][/url]. Cette image est devenue pour Reble une métaphore structurante pour définir son propre travail (le projecteur ici se substituant au rouet) : le film de Reble, Rumpelstizschen, composé en partie du film en question, et qu’il réalisera au cours d’une performance en modifiant la chimie du film, par teintures, délavement, égratignure, usage de filtres qui rendent l’image solarisée, opère sur le film un type de « transsubstantiation », ou une « projection » pour employer le terme qui était utilisé dans les pratiques alchimiques au Moyen Age pour parler de cette transformation – de la matière vile en matière « noble », rougeoyante, flamboyante et dorée.


Rumpelstilzchen (Jürgen Reble, 1989)
Bien entendu, les pratiques expérimentales qui opèrent un retour sur la matérialité du film (par égratignure, coloriage, réexposition, développement à la main) possèdent une longue histoire ; on pourrait les faire remonter aux travaux de Carolee Schneeman, de Stan Brakhage, de Ken Jacobs ou d’Ernie Gehr pour ne citer que les exemples les plus canoniques des années 50 et 60 (le cinéma lettriste de Maurice Lemaître et d’Isidore Isou, ou encore, bien avant, le cinéma dadaïste et Le retour à la raison (1923) de Man Ray seraient une autre ligne de filiation). Mais je crois que l’expérience spécifique de ces films – tels qu’ils sont conçus et investis aujourd’hui – ne peut pas être détachée du moment « médiatique » dont ils sont contemporains, soit l’incursion de la vidéo (et de l’art vidéo), et éventuellement du numérique (Reble réalise le gros de ces films de ce type dans les années 90). La vidéo et le numérique sont perçus comme une dématérialisation du médium filmique, un abandon d’une certaine indicialité, une indifférenciation du support, et une dés-auratisation du film : c’est à cette « catastrophe » culturelle pour certains, que ces différentes interventions tendent à « remédier » en opérant un recentrement sur le médium tout en signant sa disparition, ou en faisant des modalités de sa destruction plastique un axe de sa spécificité médiatique (c’est un point qui diffère, en effet, des pratiques structuralistes ou matérialistes précédentes, celle des années 50 et 60).
Il y a de plus un côté performatif (dans le double sens du terme) dans ces pratiques (certaines ont d’ailleurs été réalisées en performance). On peut le voir dans le film de 1984, Städten in Flamen, Ville en flamme, un des films que Reble réalise avec un collectif créé en 1978, Schmelzdahin). Le film d’origine, – selon certaines sources, il s’agirait d’une copie super-8 ou 16mm d’un film canadien avec Donald Pilon intitulé « Ville en flamme » ! – fut enterré dans un jardin, exposé à des microbes, des bactéries, avant d’être brûlé et malmené par divers produits chimiques, puis « refilmé » dans le cadre d’une performance, puis par refilmage à la tireuse optique. L’effet général en est néanmoins un de brûlure « live », en direct, où les flammes du titre deviennent celles qui brûlent performativement la pellicule. Le film se dissout et disparaît en apparaissant sous nos yeux : chaque photogramme est transformé en un petit tableau de couleur chaotique, qui apparaît dans sa disparition, et dont la destruction donne lieu à une création inattendue, absolument singulière et fuyante. Les modalités de la destruction et de la décomposition plastique deviennent ici une façon de révéler les propriétés médiatiques, matérielles du cinéma et de la création expérimentale.


Stadt in Flammen/Ville en flammes (Jürgen Reble, 1984)
Dans un ordre similaire d’idées et de démarche, une cinéaste québécoise d’origine acadienne Louise Bourque, a réalisé en 2002 un petit film de 2 minutes intitulé Self Portrait Post Mortem. Elle avait enterré, cinq ans auparavant quelques chutes de trois de ses films dans le jardin de sa maison familiale d’où elle devait déménager (cette maison et sa famille étaient d’ailleurs au cœur des films en question). En déterrant les bouts de pellicule cinq ans plus tard, elle découvrit que ce séjour six pieds sous terre, au contact de l’humidité de la terre, avait rongé et moisi la pellicule, et notamment un bout de pellicule où on voyait son visage, en gros plan, dans un cadre de porte. Elle allait en tirer un film au titre programmatique : self portrait post mortem, un autoportrait d’outre tombe ; où la pellicule, rognée sur les côtés, produit un véritable effet de cercueil, à travers lequel son visage, rendu fantomatique par la décomposition du film, perçait.

Self-Portrait Post-Mortem (Louise Bourque, 2002)
Le film, magnifique plastiquement (comme le sont ses autres films, notamment L’éclat du mal, 2005), est soutenu par une interrogation métaphysique sur la vie et la mort (des individus et du support filmique), sur la destruction et la création artistique, entre le geste du créateur et le hasard du processus naturel. L’investissement biographique est également signalé par l’endroit où fut enterré la pellicule (qui nous parle d’un enracinement dans le lieu de la naissance et de la filiation familiale), par le « retour » sur sa propre œuvre, cinq ans après, et sur sa propre image « enfouie » dans le passé. Il y a également, enfin, dans ce film, quelque chose du thème classique de la vanitas – qui fut souvent associé aux autoportraits et aux ruines, comme le rappelait Derrida dans son ouvrage Autoportrait et autres ruines – une réflexion sur la mort et la corruption des corps, et les velléités de la création humaine, parmi lesquels, l’autoportrait classique de Heemskerck en serait un exemple.
La troisième pratique dans cette brève constellation « alchimique », est celle d’un jeune cinéaste, Karl Lemieux, qui depuis quelques années réalise à Montréal et ailleurs 12 , des performances « live » sur pellicule, accompagnées de musiciens issus de l’avant-garde montréalaise (le groupe à géométrie variable dirigé par Radwan Moumneh, Jerusalem in My Heart, Jonathan Parant, Alexandre St-Onge, David Bryant, etc.) 13 .

Karl Lemieux (performance à la SAT, 22/03/07)
Dans une tradition initiée par Reble ou encore par Pierre Hébert (bien que sous un versant plus sombre et crépusculaire), Lemieux utilise plusieurs projecteurs 16mm et par surimpressions successives de boucles de films (trouvés ou réalisés par lui) et par manipulations de la pellicule, il engendre des expériences qui relèvent tout autant du hasard, de l’accident heureux que de l’intelligence et de la dextérité du manipulateur.
Il a réalisé en 2006, à partir de l’une de ces performances, un court-métrage de 10 minutes, intitulé de façon très appropriée Western Sunburn, en partant de plusieurs boucles (de plus ou moins 20 secondes) 16mm d’un Western des années 40-50 14 . Il s’agissait d’abord d’une performance « live », qui donna lieu à un tournage plus « contrôlé » et un montage numérique (assisté par Daïchi Saïto), sur lequel Radwan Moumneh interprète à la guitare une partition lancinante et envoûtante.
Peignant de traits d’encre sur la pellicule, la tailladant avec un ex-acto, superposant des couches d’image, jouant sur la vitesse et le défilement, Lemieux manipule et varie l’expérience du matériau. Souvent, comme dans Western Sunburn, il prend de vitesse le mouvement des personnages en faisant littéralement sortir la pellicule de ses gonds. La pellicule défile, hors de l’obturateur, pour se fixer sur un photogramme qui, à force d’être exposé, se met à brûler (d’où le sunburn) : la lumière devient ici l’agent alchimique actif de l’opération 15 . Tout l’art de Lemieux consiste alors, par essais et erreurs, à maximiser l’effet de brûlure et les bouillons dorés qui perforent le film (qu’il a préalablement tailladé et rayé, dont il a gratté l’émulsion), tout en évitant que la pellicule se brise tout à fait et que l’image disparaisse. C’est donc un pas de deux extrêmement puissant et délicat auquel on assiste, entre un défilement qui, s’il est trop rapide, ne nous laisse pas voir l’image ; et l’image qui, si elle nous est montrée trop longtemps, disparaîtra dans les flammes.


Western Sunburn (Karl Lemieux, 2007)
Les performances de Karl Lemieux, et le film qu’il a su en tirer, Western Sunburn, constituent à bien des égards une synthèse puissante et innovatrice d’un ensemble d’expérimentations cinématographiques des quarante dernières années : à l’intersection du travail « structuraliste » d’un Ken Jacobs (en particulier Tom, Tom the Piper’s Son [1968]), de la pratique mélancolique de cinéastes comme Peter Delpeut ou Bill Morrison réfléchissant sur l’impermanence de la pellicule, de l’art du recyclage et du remploi (de Bruce Conner à Matthias Müller) et des performances sur pellicule des années 80 à aujourd’hui. Les collaborations récentes de Karl Lemieux avec la metteur en scène et dramaturge Marie Brassard, ses échanges avec la scène musicale contemporaine, montrent bien la façon par laquelle ces expériences de « cinéma élargi » se situent nécessairement à la croisée des arts, tout en renouant puissamment avec les arts de la performance et du spectacle dont le cinéma est issu (spectacle de lanterne magique, théâtre animé d’Emile Raynault, spectacle de fantasmagorie) 16 .
S’il fallait tenter de dégager une synthèse provisoire à propos de ces pratiques, je dirai que ces œuvres ont ceci de commun – hormis les affinités visuelles évidentes – qu’elles entremêlent une image du passé, inscrite sur un support lui aussi relativement « passé », à un geste de réappropriation au « présent », dans le présent de l’acte de création-destruction que nous avons sous les yeux (la décomposition est dans chaque photogramme, elle se joue virtuellement à chaque seconde de la performance). La matérialité de la pellicule jaillit précisément du passé tout en disparaissant au présent, ici et maintenant, sous nos yeux (d’où ce caractère auratique, spectral, évanescent). D’un point de vue médiatique, ou intermédiatique, ces films et ces performances sont des symptômes probants de ce moment de transition ou de rupture entre l’analogique et le numérique, où la pellicule, pour une « dernière fois », pousse un cri, avant de disparaître…
Ce qui nous amène, pour terminer, à souligner un paradoxe. Si chacune de ces œuvres opère ou engendre un ressourcement auratique du film-pellicule et de son « apparition unique », les conditions d’accessibilité de ces films passent aujourd’hui presque invariablement par des opérations de report sur des supports stables (au mieux une pellicule 35mm), mais surtout et avant tout sur un support vidéo ou numérique. Western Sunburn a été après tout filmé et monté en numérique ; on peut visionner les films de Jürgen Reble sur Ubuweb ou Youtube et on peut acheter une copie DVD des films de Louise Bourque. Cette remédiation d’un support à l’autre, fait souvent partie des générations d’image inscrites dans l’image : de la pellicule au VHS au transfert numérique.
En d’autres termes, ces expressions de l’aura et de la spécificité du médium nous parviennent sur des supports et à travers des canaux qui, dans les faits, la contredisent, et confirmeraient ainsi la disparition effective de l’aura qu’avait perçue Benjamin, dans ce creuset de médias entremêlés qui constitue le propre du cinéma tel qu’il se laisse appréhender aujourd’hui. Plus précisément encore, je dirai que, vu en numérique, sur Internet ou dans une présentation PWP, ces œuvres ne restaurent pas « directement » une présence d’aura, mais sont des sortes de déictiques, qui pointent vers une origine auratique, à la fois retrouvée et perdue. Aussi faut-il les voir idéalement sur support pellicule et particulièrement en performance.
Pour reprendre l’idée de David Rodowick dans un ouvrage récent, The Virtual Life of Film, plutôt que de nous poser la question Qu’est-ce que le cinéma ?, nous sommes amenés à nous demander, devant ces films et devant un ensemble de pratiques et de phénomènes contemporains, Qu’est-ce qu’a été le cinéma ? Et Qu’est-ce que deviendra le cinéma ?, en dehors de tout ton chagrin et nostalgique. Ces questions doivent être posées, il me semble tout à la fois du point de vue des symptômes esthétiques qu’il génère, d’une nouvelle sociologie de la réception, d’une phénoménologie de la perception, de l’économie contemporaine de la distribution et de l’accès aux œuvres, et de la spécificité, aujourd’hui éclatée et pixélisée, du médium cinématographique.
C’est en tout cas le genre de questions larges, pressantes et stimulantes qui, il me semble, au-delà de ces exemples spécifiques qui ne sont encore une fois que des symptômes puissants et émouvants, devraient interpeller aujourd’hui les études cinématographiques, l’histoire comme la théorie.
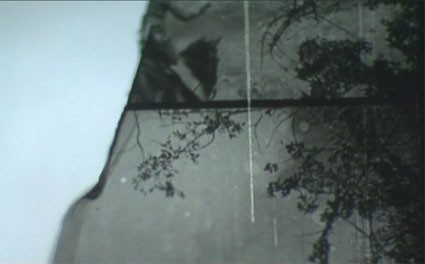
Western Sunburn (Karl Lemieux, 2007)
Notes
- Paolo Cherchi Usai, The Death of Cinema. History, Cultural Memory, and the Digital Dark Age, Londres, BFI Publishing, 2001. ↩
- Paolo Cherchi Usai, The Death of Cinema, p. 41 ↩
- « The assumption is that the spectator is indifferent to the fact that the moving image is derived from a matrix, and believes in the possibility of seeing it again under the same conditions as previously. From that standpoint, as much as in oral literature, cinema is not based on reproduction. It is an art of repetition » (XXVII, p. 59) et « preservation of the moving image ought to be treated as an equivalent to musical performance. As with the moving image, each aural experience is in fact a unique event. » (XLIX, p. 103) Confirmant la radicalité et la cohérence de ses positions et alliant la théorie à la pratique, le film de montage de films muets, Passio, que Cherchi Usai a réalisé en 2007, fut tiré en sept copies 35mm qui ont été par la suite teintées en sept couleur différentes, et déposées dans six archives nationales (il a gardé une copie). Tous les éléments négatifs ont été ensuite détruits, rendant tout nouveau tirage du film à peu près impossible. De plus, le film (qui n’est pas accompagné d’une piste sonore) n’est autorisé à jouer qu’accompagné par un orchestre symphonique, interprétant le Passio d’Arvo Pärt, et idéalement dans une église… ↩
- Gilles Deleuze, Différence et répétition, Paris, PUF, 1972, p. 104. ↩
- Walter Benjamin, Origine du drame baroque allemand, Paris, trad. Sybille Muller, Editions Flammarion, coll. « Champs », 1985 [1916-1925]. ↩
- Voir notamment sur ce point Theodor W. Adorno, « The idea of Natural History », Telos, n° 60, été 1984, p. 111-124. ↩
- Voir l’article fondateur de Walter Benjamin, « L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique », dans Œuvres III, Paris, Gallimard, 2000. ↩
- Ces deux citations, et leur rapprochement, apparaissent chez Dominique Païni, Le cinéma, un art moderne, Paris, Cahiers du cinéma, 1997, p. 159. ↩
- « Enfin, ô bonheur, ô raison, j’écartai du ciel l’azur, qui est du noir, et je vécus, étincelle d’or de la lumière nature » (Arthur Rimbaud, « L’alchimie du verbe », dans Une saison en enfer, dans Œuvres complètes, Paris, Gallimard, Pléiade, 1972, p. 110) ↩
- Le film de Michael Snow To Lavoisier who Died in the Reign of Terror (1991), d’ailleurs présenté dans le cadre de la Carte blanche à la Cinémathèque, aurait également pu prendre place dans cette constellation. Ce sera pour un prochain article… ↩
- Pour une traduction française du conte, voir [url=http://pegasus.ouvaton.org/article.php3?id_article=90] ↩
- Notamment plusieurs performances mémorables à la Sala Rossa, à la SAT, dans le cadre des Rendez-vous du cinéma québécois (2008) ; plus récemment, il a présenté une performance à Dresde et à New York. ↩
- Il est également l’auteur de films expérimentaux réalisés sur pellicule, notamment Mouvements de lumière (2005) et, plus récemment, Trash and no Stars! (2008) (co-réalisé avec Claire Blanchet), ainsi que d’un impressionnant court-métrage de fiction, Passage (2007), présenté au FNC en 2007. Il a également collaboré, avec Daïcho Saïto, au dernier spectacle de Marie Brassard, L’invisible, présenté dans le cadre de l’édition 2008 du Festival Trans-Amériques. ↩
- Il s’agit d’une copie achetée dans une brocante. Le film durait à peine 10 minutes, contenait des intertitres (et daterait à première vue de l’époque du muet), bien que tout laisse croire, par les images, qu’il s’agissait plutôt d’un film des années 40-50, remonté pour la distribution amateur en 16mm. ↩
- On retrouve ici la même dimension performative du titre que l’on trouvait dans le Stadt in Flammen/Ville en flammes de Reble. ↩
- Rappelons aussi que Bill Morrison collabore depuis 20 ans avec le Ridge Theater à New York (qui crée des spectacles multimédias) et que Decasia (2001), avant d’être un film, était un accompagnement visuel multi-écran d’une performance orchestrale « live » pour une symphonie de Michael Gordon. ↩
