DU FILM À LA VIDÉO (1943-1970)
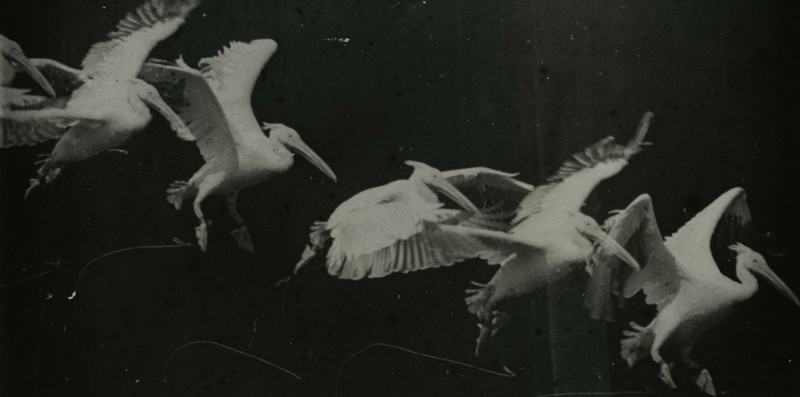
Un jour arrive, qu’on n’imagine jamais avant qu’il ne se produise, où de savantes personnes vous demandent de témoigner d’une époque qu’elles n’ont pas connue, pour mieux l’étudier… Et on s’étonne soi-même, tant le temps passe vite, d’en être rendu là ! C’est mon cas 1 .
La télévision, que je sache, est née dans les années 1952, un peu partout dans le monde… J’avais donc 16 ans à cette époque où je vis, pour la première fois, ce petit écran lumineux installé dans le salon bourgeois d’une petite ville française, Coulommiers.
J’étais tellement fasciné, qu’une fois après avoir pris congé de ces gens qu’un ami commun m’avait fait rencontrer, je suis resté longtemps dans la rue, jusqu’à la tombée du jour, à observer la fenêtre de ce salon qui s’éclairait d’une lumière bleue et sautillante, jaloux de la chance que les enfants de cette famille avaient de pouvoir jouir d’un tel miracle… et chez eux !
Le poète Paul Eluard a dit: « Il n’y a pas de hasard, il n’y a que des rendez-vous… »
Les rédacteurs d’Hors champ ont cru bon de m’y donner rendez-vous pour témoigner de mon aventure télévisuelle.
Une telle invitation vous oblige tout à coup à essayer de trouver une cohérence à cette aventure, où a-t-elle pris sa source, comment a-t-elle cheminée ? Et on est un peu comme un archéologue, avec sa petite brosse, dégageant soigneusement de la poussière du temps, des souvenirs qu’on croyait enfouis à jamais, des souvenirs d’images, puisque c’est de cela qu’il s’agit… Hasard ou rendez-vous ?
1943 : LE PREMIER FILM QUE JE VOIS… (j’ai sept ans)
Mes premières images sont celles d’un film Le baron fantôme, du réalisateur Serge de Poligny, sorti en 1943, que mes parents m’avaient emmené voir dans le cinéma de ma ville natale, Commercy, le pays où furent inventées les madeleines de Proust (hasard ou rendez-vous ? à la recherche du temps perdu). C’était pendant l’occupation allemande, en 1943, et j’avais donc dans les sept ans…


J’ai entendu longtemps, à me donner chaque nuit des cauchemars terrifiants, une voix sinistre répéter : « … Et les statues disparaissaient en silence… », tandis qu’à l’image, le Baron Fantôme, avec une jambe de bois, parcourait les couloirs sombres et infinis de son immense château, la nuit venue, emportant avec lui des bustes de marbre pour une destination inconnue.

Le baron fantôme (Serge De Poligny, 1943)
LE MONDE RÉEL DANS UNE PETITE BOÎTE
Pour conjurer ces cauchemars d’enfant, et sans qu’elle s’en doute, ce n’est peut-être pas totalement par hasard non plus si, à cette même époque, une « nounou » qui m’aimait beaucoup, m’offrit une petite boîte noire, sortie des anciens jouets de sa fille. Je peux dire à présent que cette boîte noire, aussi humble soit-elle, fut déterminante pour tout le reste de ma vie professionnelle. Cette boîte s’ouvrait sur le côté par une petite porte.
On pouvait y installer dans le haut, la bobine d’un ruban en celluloïd, sur lequel étaient représentées des images, genre images d’Épinal, et qu’on descendrait sur la bobine du bas, en faisant passer ces images, les unes après les autres, devant une petite fenêtre en verre dépoli qui, orientée vers la lumière, rendait ces images lumineuses. Face à cette fenêtre, de l’autre côté de la boîte, il y avait un œilleton, comme une petite loupe, qui permettait de voir, quand on y collait son œil, cette succession d’images agrandies qui racontaient une histoire.
J’avais fini par connaître l’histoire du « Pont de Nantes » par cœur, avec toujours ses mêmes images. Mais un jour, par un autre hasard, je m’aperçus que, la bande de celluloïd enlevée, et l’œilleton tourné à l’opposé où je collais mon œil, toute la réalité qui se trouvait, là devant moi et ma petite boîte, et par l’effet de la loupe œilleton, apparaissait sur le verre dépoli, mais à l’envers… À l’envers ou pas, c’était comme du cinéma !
Alors je me mis, ma petite boîte en avant de moi, à parcourir ma maison, la visitant et la redécouvrant dans tous ses recoins, sur l’écran de verre dépoli, ne sachant pas qu’un jour, j’appellerais ça des travellings et des plans séquences… Et je « filmais » ainsi, caché dans les rideaux de la fenêtre donnant sur la rue principale de la ville, les soldats allemands défilant au pas cadencé, mais à l’envers !


23 juin 1940. Les allemands défilent…
Je donnerais beaucoup pour retrouver cet humble objet, perdu à jamais au cours des multiples déménagements de la vie…
1951 : MA PREMIÈRE VRAIE CAMÉRA
La fascination pour une image en mouvement, enfermée dans un petit cadre, date certainement de cette lointaine époque, et ne m’a jamais quitté. Alors on peut imaginer que mon plus beau cadeau fut, un jour, une petite ciné caméra super-8mm Paillard, que j’ai conservée comme une relique, témoin de ces époques de rêves et d’espérance.

J’avais quinze ans, et c’était en 1951. Les premières victimes en furent mes parents qui m’achetaient les films super-8, en se désespérant que je les brûle en si peu de temps :
Par exemple, j’aimais tourner le rôtissage en plein air d’un gigot d’agneau, avec toute l’anecdote qui était autour : la préparation de la braise, l’ail enfoncé dans la chair, la broche la traversant, le regard allumé des futurs convives patientant avec un apéro, et la découpe sur la table. Tout cela, selon moi, en disant tellement plus sur l’époque et les rituels dont j’étais témoin, que de fastidieux panoramiques sur des monuments ou des paysages.
Je n’avais pas d’outils de montage. Alors le montage se faisait dans ma tête, au fur et à mesure du temps qui s’écoulait, et des changements d’angle qui s’imposaient pour varier le spectacle, ce spectacle qui reviendrait des laboratoires Kodak à Sevran-sur- Seine, quelques semaines plus tard, devant toute une parenté ébahie..
C’était, avant la lettre, du « live-editing » et j’étais le réalisateur de ce spectacle. Une bobine, ou plus, pouvaient bien y passer, au grand désespoir de mes parents, payeurs de bobines, mes premiers producteurs, qui se désolaient que le budget film de deux semaines de vacances fût englouti dans la seule cuisson d’un gigot !
Mais ce qu’on voyait, c’était de la vie.
1956 : L’INSTITUT DES HAUTES ÉTUDES CINÉMATOGRAPHIQUES (l’IDHEC)
Pour les convaincre davantage que leur « sacrifice » n’était pas dû à un caprice de ma part, je m’engageai, tête baissée, moi, petit provincial timide et solitaire, à me rendre à Paris-la-grande-ville, pour y subir les multiples épreuves des multiples sessions, d’une année à l’autre, sur trois ans, des concours d’entrée à l’Institut des Hautes Études Cinématographiques, l’IDHEC !
LE PLAN-SÉQUENCE
J’y appris, et comme Mr Jourdain pour la prose, que pour filmer le rôtissage du gigot d’agneau, et en dehors de la syntaxe habituelle du montage, j’avais utilisé, en plus du « live-editing » la technique du « plan-séquence », chaque arrêt de caméra correspondant à un arrêt dans le temps, et que pour rendre compte du temps qui passe, il fallait filmer le plus possible en continu, quitte à montrer, à chaque arrêt nécessaire, un événement qui se déroulerait parallèlement à ce qu’on voyait… et c’était donc un arrêt dans l’espace.
À cette époque, 1955/56, sortait le film de Max Ophüls Lola Montes. Et encore une fois, « Il n’y a pas de hasard, il n’y a que des rendez-vous… », ce film m’avait donné rendez-vous avec les innombrables plans-séquences, propre au style de ce grand réalisateur. Parmi ceux-ci, et tant d’autres, ce plan de plus de 3 minutes, avec cette erreur dans son texte du comédien Roi de Bavière, intimidé par la beauté de Martine Carole, volontairement conservée, et cette étrange corde qui se balance dans le cadre, comme un simple oubli.



Lola Montes (Max Ophuls, 1955)
J’étais fasciné. Mais pourquoi cette fascination pour ce style ?
Je ne le saurais que vingt cinq ans plus tard, à Montréal, à la télévision de Radio Canada. Pour l’heure, à l’IDHEC, on nous enseignait essentiellement l’art du découpage et donc du montage.
En première année, et à partir seulement de la continuité dialoguée, sur papier, d’une séquence d’un film de répertoire, chaque élève devait tourner en studio et en 16mm, avec de jeunes comédiens, issus eux aussi d’une école, cette même séquence, mais avec le découpage technique que cette continuité sur papier, nous aurait inspiré, et comparer ensuite, une fois montée, notre séquence et notre découpage, avec la séquence d’origine… En deuxième année, chacun devait imaginer une séquence originale, image et son, qu’il fallait tourner en 35mm cette fois, avec seulement 300 mètres de pellicule, soit une séquence de cinq à dix minutes Ces limites à la créativité n’effrayaient cependant pas quelques téméraires, et l’œuvre d’un de nos camarades, qui se voulait librement inspirée d’André Malraux, s’intitula modestement « La condition humaine ».
TROIS AMITIÉS PROFONDES
À Paris, j’avais appris à redouter l’arrogance de certains jeunes parisiens, et comme il n’y avait pas de provinciaux français dans ma promotion, je me rapprochai tout naturellement de compagnons d’étude venus de l’étranger : le premier fut un américain.
Il était là, seul, devant l’entrée des locaux de l’IDHEC, le jour de l’inauguration des cours, avenue des Champs-Elysées… Et comme j’étais seul, moi aussi, je m’approchai de lui en lui tendant la main et en lui disant : « bonjour, je m’appelle James ». Et il me répondit, avec un fort accent : « Bonjour, je m’appelle James, moi aussi… » Il s’appelait James Blue… « like the color » comme il disait.
Nous avions été voir ensemble La fureur de vivre de Nicholas Ray, qui sortait sur les Champs-Élysées, et il n’avait pu s’empêcher, à ma grande gêne, de sangloter à haute voix au drame que vivait James Dean, un autre James, par rapport à ses parents, et qui devait être aussi un peu son propre drame de jeune américain…
Comme film de promotion, James Blue réalisera, inspiré d’une nouvelle de Salinger : « Une tragédie en trois mauvaises actions », petit bijou satyrique de la société américaine… Deux ans après sa sortie de l’IDHEC, James Blue réalisera, dans les rues d’Alger encore couvertes des barricades d’une guerre sur le point de se terminer, Les oliviers de la justice, Prix de la société des écrivains de cinéma et de télévision au Festival de Cannes 1962.
Le deuxième compagnon, qui deviendra un des plus prolifiques documentaristes de Hollande, Johan Van Der Keuken, osa affronter sur notre plateau de tournage, notre professeur de prises de vues et d’éclairage, Jean Bachelet, qui avait éclairé en 1928 La petite marchande d’allumettes de Jean Renoir.
Johan tenait à un cadrage particulier qui aurait retranché d’un tiers de l’image, le visage en C.U. de sa comédienne. C’était le cadrage qu’il voulait…
« Non monsieur, avait lancé Bachelet, on ne coupe pas dans les chairs ! »
Johan s’obstina un bon moment, mais la mort dans l’âme, il dû renoncer à ce qui aurait certainement été l’image du siècle, sous la menace que Bachelet pouvait ordonner à ses électriciens et à tout moment, de plonger dans le noir notre plateau de tournage. Au moins avait-il osé affronter ce monument de l’Histoire du cinéma.
Et le troisième compagnon, ce fut Costa Gavras qui venait le soir, dans ma chambre de la Cité Universitaire, recopier mes cours, et apprendre du même coup quelques mots de français, car pour se faire un peu d’argent, le reste du jour, il lavait des voitures dans un garage. Pour son film de promotion, Costa tourna carrément le dos aux décors traditionnels des chambres à coucher, cuisines et salons qu’on nous imposait, et avec l’envers de ces décors, la jute des toiles peintes, les montants de bois qui servaient à les maintenir debout, il reconstitua un asile pour SDF (sans domicile fixe) très convaincant ! On connaît la suite de sa carrière…
Nous avions deux professeurs d’Histoire du cinéma : Georges Sadoul, qui ne jurait que par le cinéma soviétique. Par lui, j’appris les immenses possibilités expressives d’images, combinées les unes aux autres par un montage très serré, telles qu’elles apparaissent dans la scène des Escaliers d’Odessa du « Cuirassé Potemkine »








Le cuirassé Potemkine (Sergei Eisenstein, 1925)
L’autre professeur était Jean Mitry, dont j’appréciais qu’il ait été, non seulement un historien universitaire, mais aussi et surtout, un réalisateur confronté à la matière et à la création… Son film, Pacific 231 (1949) construit sur la musique d’Honegger, aux antipodes du plan-séquence, rejoignait mes rêves de fusion images-musique, sans que je sache bien sûr, où et comment, dans ma vie, ce rêve se concrétiserait…
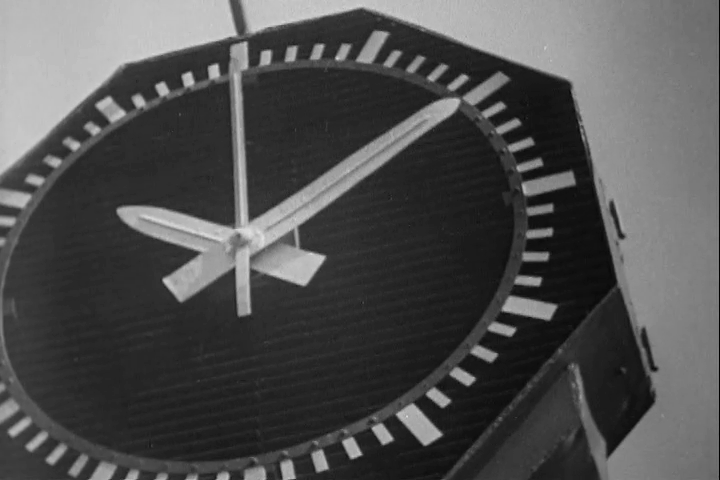





Pacific 231 (Jean Mitry, 1949)
La mort de James Blue et de Johan Van Der Keuken nous a séparés… Mais le « vieux Costa », comme je continue à l’appeler (quatre vingts ans cette année) heureusement est toujours là. Nous nous sommes revus l’été passé, et il était en train de scénariser son prochain film…
1963 :PREMIERS PAS DANS LE MÉTIER DE CINÉASTE
À la sortie de l’IDHEC, suite à un service militaire obligatoire de 28 mois, et toujours pour fuir Paris, mon premier contrat, c’est le Ministère de la Coopération qui me l’offre, créé par De Gaulle pour garder des liens entre la France et ses anciennes colonies. Je dois couvrir, pour les « Actualités Françaises », les territoires de l’ouest africain. On met à ma disposition une splendide caméra 35mm, et je dois envoyer à Paris, chaque semaine, ma pellicule non-développée et mes « topos » qui seront tirés et montés là-bas selon mes indications, et reviendront une semaine plus tard, pour être projetés dans les salles du Sénégal, du Mali, du Niger et de la Côte d’Ivoire…
GEORGES DUFAUX et JEAN ROUCH (deux rencontres déterminantes)
Ma base étant Abidjan, en Côte d’Ivoire, hasard ou rendez-vous, c’est là que je rencontre en 1962, le cinéaste ethnologue Jean Rouch et surtout, Georges Dufaux, de l’ONF.
Dans une entrevue enregistrée en 1979 par Pierre Jutras de la Cinémathèque québécoise, Georges Dufaux déclare : « Rouch était une espèce de prophète — l’homme nouveau du cinéma que Claude Jutra avait ramené d’un séminaire Flaherty… c’était l’été 1962 et nous sommes allés rencontrer Maître Rouch à Abidjan. »
Je fus témoin, au Niger, de la façon dont Rouch tournait dans de longs plans séquences, son film La chasse au lion à l’arc, sa caméra à l’épaule, déclenchant à distance son magnétophone Nagra, assez fier de l’effet « sorcellerie de blancs » que cette tele-commande produisait sur ses innombrables assistants nigériens, médusés par ce prodige…



La chasse au lion à l’arc (Jean Rouch, 1965)
Rouch s’en amusait beaucoup, avec un certain orgueil paternaliste. Dans La chasse au lion à l’arc, et devant le danger qui le menace, Rouch doit cependant interrompre son plan séquence à l’épaule… car le lion blessé s’est jeté sur un chasseur.
Rouch a alors, au montage, une idée de génie : aux images qui manquent, il substitue une série de plans fixes montrant la peau de la bête, tandis que la Nagra continue d’enregistrer le drame dans sa durée réelle. L’effet dramatique est d’autant plus puissant que c’est le spectateur qui imagine les images.
1965 : LE QUÉBEC
J’étais, depuis Flaherty et Norman MacLaren, fasciné par l’ONF, cette maison de production canadienne entièrement dédiée aux courts métrages, et cette année-là, 1962, au cours de nos conversations à Abidjan, Georges Dufaux me laisse espérer que je serai peut-être engagé comme diplômé de l’IDHEC dans cette prestigieuse maison de production, et qu’il m’aiderait de son mieux à m’y faire entrer.
Quand j’arrive au Québec en 1965, j’ai 29 ans, je ne jure que par le film, je rêve d’entrer à l’ONF, et mes deux pôles de créations, comme deux pôles opposés, s’imposent à moi :
-D’une part, le montage image-musique, issu de l’enseignement de Jean Mitry, et de son Pacific 231, basé sur une rythmique de plans très courts, suggérant et rendant visible la musique…
-D’autre part, le plan séquence, issu d’abord de l’observation quand j’avais sept ans, de ce défilé de soldats allemands sur le verre dépoli d’une petite boîte noire, issu un peu plus tard des humbles tournages en super-8, du rôtissage d’un gigot d’agneau, et issu enfin d’une joyeuse rencontre avec la caméra « Eclair-Coutant » du nom de son inventeur, que Jean Rouch porte allègrement à l’épaule, dans ces années 60, sous le soleil d’Afrique…
Comme quoi tout se tient…
RETOUR SUR LE PLAN-SÉQUENCE
Le cinéaste et photographe Raymond Depardon, dans un [entretien à la Cinémathèque de Chaillot->https://www.youtube.com/watch?v=vXI1g5WizoE], parlera avec admiration à Jean Rouch, peu de temps avant la mort de ce dernier en 2004, (et je le cite) parlera de « cette esthétique morale qu’est le plan séquence, qui est de ne pas tricher, de laisser le réel venir à soi, et de l’attendre avec beaucoup de patience… Il peut se passer quelque chose, comme il peut ne rien se passer… Pour que le réel vienne, il ne faut pas seulement l’attendre, il faut être “participant” ».
Une esthétique dont je vérifierai plus tard la pertinence et la nécessité comme réalisateur-télé à Radio Canada. Comme si des chemins s’ouvraient à notre insu, et qu’ils nous traçaient la voie de ce que nous devrions devenir… ce que d’aucuns appellent le DESTIN.
Cependant en 65/66, malgré mes premiers films réalisés en Afrique et dans des studios de films publicitaires en Espagne, malgré aussi quelques prix internationaux, et malgré des diplômes que personne jamais, contrairement à la vieille Europe, ne me réclamera au Canada, en 65/66, l’ONF n’engage pas… Et mes films sous le bras, durant les deux mois où Robert Daudelin, qui avait rencontré mon copain James Blue, m’héberge charitablement, durant ces deux mois, je fais du porte à porte, sans qu’aucune d’elles ne s’ouvre, si ce n’est, contre tout attente, celles d’une compagnie d’électricité : l’Hydro Québec !
LE MONTAGE IMAGES-MUSIQUE
Ils ont un département cinéma, et on m’offre de réaliser un documentaire de 30 minutes sur le barrage Manic 2, à partir des films tournés durant les quatre années de construction de ce barrage. Une somme considérable d’images à « orchestrer ».
Leurs salles de montage étant toutes occupées, ils sous-traitent avec une petite salle privée appartenant à Mme Lise Caron. Elle est la conjointe, et cela aura son importance, du chef de service des Émissions Jeunesse de Radio Canada, Claude Caron. Ce Claude Caron, je le saurai plus tard, c’est le créateur, entre autre, de « Pepino et Capucine » et surtout de « Bobino » que les jeunes québécois de ces années là connaissent bien.
Donc je monte mon film pour l’Hydro Québec dans ce petit studio, installé dans leur sous-sol, mais sur une magnifique « Steinbeck » qui permet de voir se dérouler à l’horizontal, la bande image et plusieurs bandes-son… C’est pour moi un enchantement, et pour décrocher le plus rapidement possible un autre contrat, je travaille tard le soir, jusqu’à l’heure du dernier autobus. Claude Caron, sympathique à mon ardeur au travail, m’apporte, selon l’horaire de sa petite famille, tantôt un apéro, tantôt une soupe, tantôt un dessert, mais surtout, il s’intéresse, par dessus mon épaule, aux séquences que je monte… en particulier celles où je déploie ma fascination pour le montage images-musique issue de Jean Mitry et de son Pacific 231…
Et un soir il me dit : « Dès qu’un poste de réalisateur se libère dans mon service à Radio Canada, et si ça t’intéresse de passer du film à la télévision, je t’engage… Les pressions économiques subies par un jeune émigrant, arrivé avec sa petite famille, ne me font pas hésiter très longtemps… Et j’accepte de faire le saut ! Un saut que je n’ai jamais regretté…
1968 : RÉALISATEUR TÉLÉ à RADIO CANADA
Passés les premiers stress d’être confronté à l’immédiateté de la création d’images regroupées en séquences, à l’apprentissage d’un nouveau vocabulaire, le gros plan devenant close-up, le plan américain medium-shot, les travellings, dolly-back ou dolly-in, la grue, crane-up ou crane- down, etc… me voici face à mes nouveaux outils de création.
Ils n’ont pas l’air si différents du film… Après tout, ils servent à raconter des choses en images qu’un public regarde. Mais je ressens confusément qu’il y a une différence… et je ne sais pas encore comment la définir.
Le Service des Émissions Jeunesse dans lequel Claude Caron me fait entrer, produit aussi bien des Émissions pour enfants, que de grandes séries sur film comme D’Iberville.





D’Iberville (Pierre Gauvreau et al., 1968-69)
Mais si D’Iberville est sur film, ce n’est pas par choix esthétique, mais parce que les caméras vidéo, très lourdes à cette époque, ne peuvent pas sortir des studios. Film ou vidéo, à Radio Canada, ce seront d’abord, et pour longtemps, des contraintes économiques, et non esthétiques, qui décideront de leur choix…
LA VIDÉO : NOUVEAU LANGAGE ESTHÉTIQUE… MAIS SUPPORT ÉPHÉMÈRE
Mais je commence à découvrir les possibilités de la vidéo quand on me donne à réaliser, année de l’Expo 67, une série hebdomadaire dont Chantal Renaud, l’actuelle conjointe de M. Bernard Landry, est la jeune animatrice : « JEUNESSE OBLIGE EXPO ». Même si on est encore en noir et blanc, un directeur technique très généreux de ses conseils, M. Denis Gamache, m’indique la possibilité de faire tout de même des incrustations « au noir », comme plus tard avec la couleur elles seront au bleu ou au vert, permettant de placer Chantal Renaud dans un rétroviseur ou au cœur d’une fleur…
On abuse beaucoup, à cette époque, de ces petits miracles de l’électronique, et j’engage un jeune musicien, parce qu’entendu quotidiennement dans l’émission radio de Lise Payette, Place aux femmes, François Cousineau, pour qui ce seront ses débuts à la télévision… Malheureusement, c’est le temps qui nous manque, et non les idées… Nous enregistrons dans un grand sous-sol de la Palestre Nationale transformé en studio, le camion de l’unité mobile, stationné sur le trottoir servant de régie, rue Cherrier…
Le soir, parfois tard, les contraintes syndicales étant moins sévères à cette époque, nous filons avec nos lourds rubans 2 pouces, dans la voiture de l’un ou de l’autre, vers la Maison de Radio Canada, angle Guy et Boulevard Dorchester, dans l’ancien Hôtel Ford, où nous complétons jusque tard dans la nuit, le montage, de machine à machine, d’une émission d’une demi-heure qui sera diffusée le lendemain même… et effacée l’heure suivante pour récupérer le ruban.
Autant dire qu’il ne reste rien de ces belles aventures…
L’instantanéité de la création sur vidéo qui me fascine, par rapport au film, j’en paierai aussi le prix par l’instantanéité de son effacement, sa fragilité et la brièveté de sa survie à l’écran. Mais il faut savoir jongler d’une caméra à l’autre, avec les zoom in et zoom out, les chromakyer, les slo-mo, les accélérés, bref, toute une panoplie d’effets nouveaux avec lesquels je ne suis pas vraiment familier. On hurle autant contre mon incompétence, que par jalousie que je sois entré si facilement par la grande porte, et Claude Caron me laisse une ultime chance avec Grujot et Délicat.
PREMIÈRE FICTION-VIDÉO : « GRUJOT & DÉLICAT »
C’est une série pour enfants qui passe à trois heures de l’après-midi. Une dizaine de personnages dans un studio minuscule, et deux caméras.

Grujot et Délicat (James Dormeyer, 1974)

En studio, je ne disposais que de deux heures d’enregistrement magnétoscopique pour livrer une émission de 27mn 50 qui sera diffusée dès le lendemain ! Mais ça marche.
Ce sont des comédiens très expérimentés que les Lise Lassalle, Giselle Mauricette, Benoît Girard, François Tassé, Monique Joly, déguisés en chiens ou en chats, et bien sûr Jean Besré et Clémence Desrochers qui écrivent tour à tour les textes. Ils aiment ma précision, et s’en amusent parfois. On parvient à réussir des petits bijoux de fantaisie, presque des comédies musicales… sur la musique d’Herbert Ruff. C’est du théâtre, mais que les arrêts d’enregistrement, et le live-editing, permettent d’enrichir infiniment par toutes sortes de trucages. Un théâtre que la vidéo transmet comme si on était sur la scène, nous faisant accepter ses conventions, toiles peintes et maquillages, comme on l’accepte lorsqu’on est assis dans une salle de théâtre, mais enrichie de procédés de substitution que n’aurait pas renié Méliès. Place de l’Opéra, lorsque par un arrêt « obligé » de sa caméra, il se rend compte que si le monumental décor de cette place n’a pas changé de place, et sa caméra non plus, un corbillard qui passait par là, le temps d’un changement de bobine, s’est changé en omnibus !
La vidéo donc, outil de transmission d’une réalité indubitable qui se déroule devant les caméras, même si les murs sont faux, les personnages sont faux, et les situations complètement irréalistes. Voilà qui nous ouvre les portes de toute une fantaisie poétique possible… d’autant plus que je VOIS très bien que c’est Lise Lassalle qui est maquillée en personnage de Grujot, et que j’assiste à sa performance… alors que sur film, même si je SAIS que c’est Jean Marais qui joue Fantômas, je crois tout d’abord à Fantômas, et j’oublie Jean Marais…
Et je ne voudrais surtout pas qu’il joue dans des décors de carton-pâte, mais plutôt, dans de vrais châteaux. Ce sera d’ailleurs pour moi le début de toute une réflexion sur la problématique de créer une fiction sur vidéo plutôt que sur film. Et je ne cessais de me poser ces questions : D’où vient cette différence entre film et vidéo ? Qu’est-ce que la vidéo peut faire, que le film ne ferait pas ? Encore, quand il s’agit d’une fiction d’ordre théâtrale, mais qu’en sera-t-il d’une fiction réaliste, tournée en décors qui veulent faire croire qu’ils sont vrais, où mieux encore, en extérieurs réels ?… Une interrogation lancinante qui ne cessera de me poursuivre, jusqu’à ce que, peu à peu, à force de rencontres, ou de hasards, comme disait Eluard, quelques embryons de réponses finiront par apparaître.
Lire la deuxième partie
Notes
- Une première version de ce texte a été présentée dans le cadre du colloque « Une télévision allumée: les arts dans le noir et blanc du tube cathodique », organisé par André Gaudreault et Viva Paci à la Cinémathèque québécoise et qui s’est déroulé du 25 au 28 mars 2015. L’auteur l’a bien gentiment remanié pour les besoins de sa publication sur le site d’Hors champ, tout en maintenant pour l’essentiel son oralité première. ↩
