Surgissements : poétiques de l’image vidéo
Nour Ouayda en conversation avec Farah Atoui

one sea, 10 seas (2019, Liban, 42 min, V.O. Arabe), un métrage moyen de Nour Ouayda, a été présenté en Novembre 2019 à Montréal dans le cadre des Rencontres internationales du Documentaire de Montréal (RIDM). Le film est construit autour d’images de la mer à Beyrouth — filmées sur une période de quatre ans — et d’un récit à trois voix, celles de N., C. et T. C’est suite à la projection du film à la Cinémathèque québécoise que cet échange entre Nour et moi s’est engagé. Le dialogue nous a accompagnés jusqu’à Beyrouth en février 2020, pour ensuite se poursuivre par courriel au cours des mois suivants. Le film a été un point de départ pour parler de la relation de la réalisatrice à l’image, au son et au texte ; de Beyrouth et de la mer ; et de l’intersection du cinéma et de la politique.
Farah Atoui : Ton film one sea, 10 seas n’est pas un documentaire conventionnel. C’est un essai visuel, textuel et sonore, un film méditatif, qui oscille entre les catégories du documentaire, de la fiction, de l’expérimental et du film d’art. Il me fait penser à ce que la cinéaste et théoricienne Trinh T. Minh-ha a récemment exprimé à propos de sa pratique artistique. Elle a déclaré : « Je ne pense pas à mes films en termes de catégories… mais plutôt comme des mouvements fluides et interactifs. Le premier est de laisser le monde venir à nous par un mouvement qui va de l’extérieur vers l’intérieur — c’est ce que certains appellent documentaire. L’autre est de toucher le monde de l’intérieur, ce que certains appellent fiction 1 . Penses-tu à ta pratique cinématographique en termes similaires ? Comment conçois-tu la relation entre le documentaire, la fiction, et la réalité dans ta pratique ?
Nour Ouayda : Je crois qu’il s’agit pour moi de toujours penser à la porosité entre la fiction et la réalité. Ce sont deux niveaux de narration qui se surmontent et se télescopent constamment quand je fais un film. Dans ce film, le sentiment de fluidité y est déjà à travers la présence de la mer et des vagues. Je dirais aussi que la circulation se fait par le biais du regard et de l’ouïe qui sont poussés à explorer ce même motif durant 40 minutes. La parole, ici écrite, guide ce mouvement des sens. Elle nous propose des personnages qui nous suggèrent des manières de voir et d’écouter. La parole révèle parfois un détail à l’image ou au son, et d’autres fois, elle le dissimule en se construisant en couches par-dessus. Ce sont des mouvements de transparence et d’opacité, d’alternance entre les moments où la spectatrice est invitée à se laisser aller aux mouvements sonores et visuels des vagues et d’autres où elle est incitée à voir et à écouter des détails précis qui tissent une (ou trois) histoire(s). C’est une sorte de va-et-vient entre une attention diffuse, qui circule sur la surface des plans et une autre plus précise qui perce l’image, en profondeur. À mon avis, ce rapport au détail nous fait basculer dans la fiction.
Je trouve que l’idée clé exprimée dans la citation de Trinh T. Minh-ha est celle de « permettre au monde de nous traverser ». Cela implique une certaine réceptivité de la part de la réalisatrice : comment est-ce que tu te places dans une situation et dans un lieu ? Quel dispositif mets-tu en place pour te permettre d’être réceptive ? Mon médium, c’est la caméra qui me permettait non seulement de capter la réalité, mais de la recevoir et de la transformer. Le réalisme et la fidélité ne m’intéressent pas. Ce qui m’intéresse, c’est la manière dont la réalité est transformée à travers l’appareil que je place entre mon corps et l’objet que je filme. Je manipule la machine, je la pousse dans ses retranchements en cherchant ce moment où ce que je regarde à travers l’œillet va se transformer, prendre une nouvelle forme. La magie surgit alors en temps réel et mon regard est le premier à en être ébloui. Il s’agit pour moi ensuite de transmettre cet éblouissement aux autres. Ce n’est pas une question de documenter la réalité, mais plutôt de capter une façon de voir, ou d’écouter.
F.A. : Durant un échange qui a suivi la projection de ton film à la Cinémathèque québécoise dans le cadre des RIDM, tu as mentionné que ton intention première était de faire un film sans son ni texte. Or, ton film intègre ces deux éléments, et le fait même d’une manière qui brise la primauté de l’image visuelle sur les éléments sonores ou textuels. Le film tisse ensemble image, son et texte, parfois de manière synchrone, parfois en disjonction, mais toujours de manière à produire des formes d’expression et de représentation alternatives et expérimentales. Peux-tu parler des possibilités que les interactions entre l’image, le son et le texte ont offertes au film ? Je me demande aussi pourquoi tu as décidé d’ouvrir tes images à des collaborations, et comment les processus du travail collaboratif avec Carine Doumit, Tatiana El Dhadah and Shakeeb Abu Hamdan se manifestent dans le film.
N.O. : Ce film était pour moi une façon de me confronter à des choses que je ne croyais pas avoir envie de faire. Étant quand même pas mal cinéphile, j’ai une idée des films qui me touchent et auxquels j’ai envie que mes propres films ressemblent. J’ai aussi des réticences par rapport à certains procédés, dispositif ou genres de film desquels je veux m’éloigner. Je me suis construite autour de ces idées fixes, chose que je trouve paralysante. Je finis par essayer de reproduire des dispositifs sans tout le processus de recherche et d’expérimentation qui le précède. Je me rappelle par exemple la première fois que j’avais vu Anticipation of the Night de Stan Brakhage. J’étais si touchée par l’expérience silencieuse et muette de ce film que c’est devenu une obsession pour moi d’arriver à fabriquer un film sans son et sans parole. Et comme j’accumulais des images de mer avec ma caméra MiniDV, je voulais explorer la manière dont les images de mer pouvaient exister sans le son des vagues. Je percevais l’utilisation du texte ou du son sur ces images de mer comme un échec de ma part, une incapacité à faire parler les images seules. Ce dont je n’étais pas très consciente à ce moment-là est que je suis quelqu’un qui a un rapport très fort aux mots et à la parole. J’ai passé deux ans à essayer de monter les images accumulées en m’imposant la règle d’or de ne pas vouloir ni du son, ni une voix off, ni du texte. Inutile de dire que ça ne fonctionnait pas parce que j’allais à l’encontre de mes désirs pour suivre une idée que je m’étais fixée.

La déconstruction de ces idées fixes était un travail très difficile, que je n’ai pu commencer à faire qu’à travers une collaboration au montage avec Carine Doumit. L’écriture du texte était organique. Il était, en fait, une manière de communiquer entre Carine et moi. L’incorporation du texte dans le film était très fluide puisque le texte a été le résultat de notre rencontre autour des cassettes que j’avais filmées. Et soudain, je ne sais plus comment ça s’est fait, mais l’image ne pouvait plus exister sans le texte. Le gros du travail était de trouver une manière d’emmener le texte et la parole d’une façon qui nous stimulait.
C’était de même pour le son. Je crois que j’avais quand même moins de réticence par rapport à la présence du son. Mais je me suis rapidement rendu compte qu’il y a quelque chose dans la multiplicité de la mer qui devait passer par le sonore. Avec un ami saxophoniste qui habite Paris, on avait exploré l’idée d’utiliser de la musique pour le film. L’idée était de créer des respirations circulaires pour accompagner certaines séquences du film. Mais il y avait tellement de sons et de textures dans la banque de sons que l’ingénieure son Tatiana el Dahdah nous avait offerte, que le saxophone nous semblait de trop. Shakeeb Abu Hamdan, qui a réalisé la conception et le mixage sonore du film, a fait un superbe travail avec les enregistrements de Tatiana, il a révélé ce qui rendait chaque enregistrement, et donc chaque lieu au bord de la mer, unique. La bande son du film, en rassemblant des enregistrements faits partout dans le monde, a été le contre champ d’une image qui épuise un seul lieu, la mer vue/filmée de la corniche de Beyrouth. Il y a eu aussi tout un travail sur les différentes qualités sonores des enregistrements : ceux faits par Tatiana, plus définis et enregistrés souvent avec plusieurs micros, et ceux de la caméra, qui logent en eux les interférences de la cassette MiniDV. Ces derniers sont plus « sales », plus granulés, comme l’image. Il s’agissait donc de choisir quand la texture du son correspondait à celle de l’image et quand le son ouvrait sur un paysage sonore plus clair et défini.
Les moments de silence dans le film permettent d’explorer comment l’oreille réagissait au manque de son en essayant de combler le silence par des sons de vagues imaginés. Ici aussi, le travail sonore fut déterminant, puisqu’il s’agissait de créer une multiplicité de sensations de silence avec de « vrais » silences — où il y a coupure de la bande sonore — et de « faux » silences — où l’oreille est trompée — pour croire qu’il n’y a presque plus de son, alors qu’il y en avait, mais à un niveau si bas qu’on est poussé à se poser la question : est-ce que je viens d’entendre une vague ou je m’imagine ce son ?
F.A. : Durant ce même échange à la Cinémathèque québécoise, tu as expliqué que pendant quatre ans, tu avais accumulé des images de la mer. Selon toi, one sea, 10 seas, tente de capter la multiplicité de la mer, de ses états et de ses manifestations, ainsi que les multiples façons dont nous la ressentons, la voyons et l’entendons. Ces images accumulées, comme le révèle le film, sont étroitement liées à tes propres émotions. Elles les reflètent et les réfractent, mais aussi les recueillent, les contiennent, et les préservent. Chaque image est une trace, portant en elle les résidus d’un moment, d’un sentiment, d’une expérience. On peut dire que ce sont des images hantées par ta présence. Tu as créé une sorte d’archive audiovisuelle de tes sentiments pendant le tournage. Il me semble que ce film est une invitation à dialoguer intimement avec toi. Sa signification émerge à travers le potentiel de ce dialogue. Je veux en savoir plus sur la façon dont cette pratique d’archivage affectif a commencé, ce qu’elle signifie pour toi, et ce qu’elle provoque en toi ? Est-ce que tu filmes toujours la mer ?
N.O. : J’avais reçu une bourse de Ashkal Alwan pour terminer le film. J’avais toute la matière, mais je bloquais. Ashkal Alwan a suggéré que je travaille avec quelqu’un au montage. J’ai donc contacté Carine, qui est une amie monteuse avec laquelle j’avais parlé de ce projet. La première chose qu’on a faite, c’est le visionnement des différentes cassettes. Carine s’est mise à me poser des questions sur ce que je ressentais quand je filmais chacune des images, ce dont je me souvenais… Elle a pris note de ce que je lui racontais. Ces notes ont été la base pour le texte du film. Au début, elles étaient une manière de structurer le montage, mais elles se sont rapidement transformées en une matière essentielle au film.
Ce premier texte de Carine a révélé — mais aussi cristallisé — la relation intrinsèque entre les images et ce qu’elles provoquaient en moi comme émotions. Je n’en étais pas très consciente au début du montage, mais c’était un film qui essayait de rendre compte d’un ressenti lors du tournage. Je crois que Carine voyait cela très clairement. Ça m’a personnellement pris plus de temps pour le voir. Et puis c’était devenu évident, je ne voyais plus comment amener ces images hors du contexte du ressenti qu’elles ont provoqué en moi. C’est pour cela que le film apparaît telle une archive d’émotions ou de sentiments, comme tu le décris. Ce n’est pas un film sur la mer, mais un film sur comment on peut regarder et écouter la mer. Ma ligne directrice, c’est le potentiel qu’ont les images en mouvement de nous soulever, et cela, à travers l’émotion et l’écoute. C’est le fil conducteur qui me semblait le plus honnête.

Puis, cette archive affective est aussi liée à l’idée de surgissement, à comment l’acte de filmer peut provoquer des émotions très fortes. Je suis convaincue que la caméra et le microphone sont capables de capter la magie qui traverse les choses, les personnes, les éléments. Les images et les sons contiennent les traces de cette magie et je cherche donc à les révéler, les indiquer et les souligner. En fin de compte, je ne voulais pas faire un film sur moi, mais un film à travers moi, et à travers Carine, Tatiana et Shakeeb. Il y a tellement de Carine dans ce film. J’aimerais croire qu’on y retrouve beaucoup de Tatiana, aussi. Je voulais me pencher dans la direction de Tatiana pour comprendre ce qui se passait dans sa tête et son corps quand elle a enregistré les sons. J’ai donc écouté ses histoires qui sont devenues celles de T. Il y a aussi l’oreille de Shakeeb, et la sensibilité de Ziad Chakaroun, qui a traduit le texte.
Aujourd’hui, je ne filme plus beaucoup la mer. Je sens que je me répète. Ce qui n’est pas grave en soi, mais je sens vraiment qu’avec ce film et avec l’aide de Carine, Tatiana, Shakeeb et Ziad, je suis allée au bout d’une obsession qui, maintenant, cherche à se manifester autrement.
F. A. : Dans Ways of seeing, John Berger écrit : « […] cette vision qui précède les mots, et qui ne peut jamais être tout à fait couverte par eux, n’est pas une question de réaction mécanique à un stimulus. Nous ne voyons que ce que nous regardons. Regarder est un acte de choix. Par cet acte, ce que nous voyons est mis à notre portée […] Toucher quelque chose, c’est se situer par rapport à lui. Nous ne regardons jamais qu’une seule chose, nous regardons toujours dans un rapport entre les choses et nous-mêmes. Notre vision est en mouvement continu, elle tient continuellement les choses en forme de cercle autour d’elle, constituant ce qui est présent pour nous tel que nous sommes » 2 . Peux-tu me parler de l’idée de voir, de regarder et d’enregistrer par rapport à ta pratique ? De quelle manière la vision t’aide-t-elle à te situer ?
N.O. : À l’origine du film, il y a donc un désir de voir à travers l’image en mouvement, ou avec l’image en mouvement (j’interagis avec elle). Il y a quelque chose qui est de l’ordre de regarder longuement, de fixer l’objet filmé. Quand tu regardes longuement une chose, tu te rends disponible à elle, à recevoir ce qu’elle peut t’offrir. Le film est construit autour de ce geste-là : celui de fixer la mer, de s’en rapprocher, de s’en éloigner, de la balayer du regard, de l’écouter. Toujours revenir vers elle. C’est une manière aussi de toucher la mer du regard. J’aime bien cette idée, celle de toucher avec le regard. Et je sentais que la caméra n’était pas indifférente à la mer. Elle arrivait à rendre compte des cadeaux de lumière et de mouvement que la mer nous donnait à voir et à entendre. Je vis les choses comme cela, à travers des brefs surgissements. Les petits détails sont très émouvants pour moi. Quand je remarque les détails, je me sens en complicité avec quelque chose de plus grand.
F. A. : Je suis curieuse de savoir dans quelle langue Carine et vous avez écrit le texte, et pourquoi ?
N.O. : En français, parce que c’est la langue de communication entre Carine et moi. C’est notre langue d’écriture. Carine a écrit les premières notes autour des rushs en français, et on a continué dans cette langue. C’est aussi le cas des textes de T. La notion du surgissement est elle aussi née en français. Il y a un côté soudain dans le mot surgissement qui me plaît. Le mot anglais (apparition) ou arabe (tajalliyat) suggère un mouvement plus lent. En arabe, le mot possède une connotation mystique/religieuse, il implique en quelques sortes une montée vers le haut, un mouvement de décollage. J’aime comment ce mot se dédouble, et se multiplie avec chaque langue qui lui apporte une nouvelle couche.
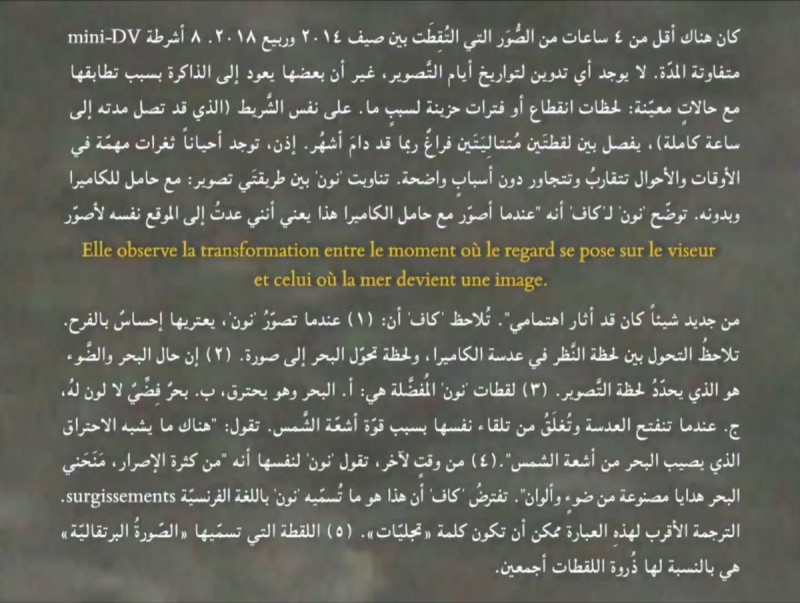
J’ai traduit le texte du film vers l’anglais avec l’aide de Shakeeb. Pour la version arabe, c’est Ziad Chakaroun qui l’a traduit à partir des versions anglaises et françaises. C’est ma deuxième collaboration avec Ziad, et je trouve que nous avons un niveau de complicité qui fait que sa traduction capte exactement la manière dont j’aimerais écrire en arabe un jour. C’est comme s’il a traduit en arabe le texte que j’aurais aimé moi-même écrire. Donc, Carine et moi, il a fallu qu’on fasse le deuil de la version française de laquelle on était toutes les deux très proches. Ensuite, la question des sous-titres s’est posée. Comme il est difficile de sous-titrer ce film à cause de la mise en page du texte, nous avons décidé de faire des versions multiples du film, une en arabe-anglais et une autre en arabe-français. Et en fin de compte, on retrouve le texte français d’origine dans la version française du film.
F. A. : À plusieurs reprises dans le film, tu effectues un zoom sur la mer, et à mesure que tu le fais, l’image se transforme en une mer de pixels. Les limites techniques de la caméra DV permettent à l’image de se détacher lentement de sa fonction de représentation, de communication et de médiation. On prend soudain conscience de la qualité esthétique de l’image elle-même, de la poétique de sa matérialité. L’image apparaît en tant que forme vivante et autonome. Et au fur et à mesure que l’attention se déplace vers la forme, des effets/significations/désirs involontaires, ce que tu appelles des surgissements ou des accidents, apparaissent. Peux-tu développer cette notion de surgissement ? Dirais-tu que toutes les images sont, en quelque sorte, des apparitions du passé ?
N.O. : Un des surgissements les plus clairs dans le film est celui de la mer orange. C’est le résultat d’une mauvaise manipulation de la caméra — intentionnelle, bien entendu. À plusieurs reprises dans le film, on essaye de relever les surgissements, leur forme varie et leur manière d’apparaître aussi. Un surgissement est une mer sombre nommée « mer de pétrole », mais aussi le scintillement orange sur une image de mer qui nous donne l’impression que la mer brûle ou encore, quand notre oreille continue d’entendre le son des vagues même après la coupure brusque de la bande sonore. La mer n’est pas orange ni noire, et le bruit de la vague a disparu. C’est la combinaison texte-image, ou texte-son, ou image-son (comme la vague-voiture à la fin du film) qui suscite un cas de spontanéité magique. J’aime bien utiliser cette expression que j’ai volée à Henri Michaux.


La traduction en anglais, apparition, suggère une présence fantomatique. En général, je trouve qu’il y a toujours fantôme dans l’image (qu’elle soit fixe ou en mouvement) de par sa nature d’être l’enregistrement d’un instant toujours déjà passé. Le surgissement ne conjure pas les fantômes du passé, mais les traces d’une transformation. La mer devient orange, la vague devient pixel, le silence devient son. C’est en ces termes que je pense la magie.
Pour revenir à Berger, le pixel permet à l’image de toucher l’objet qu’elle filme, c’est le biais par lequel le regard touche l’objet. Le manque de clarté d’une image pixélisée et les bords moins lisses des formes et plus « muddy » que permet la caméra DV fait qu’on arrive à arracher l’image de la mer de toute la symbolique de sa représentation : la mer n’est plus symbole, elle est matière.
F.A. : La narration, qui alterne entre le genre de la description, de la rêverie et du commentaire et qui suit trois personnages — N., C. et T. — est écrite à la troisième personne. On suppose que ces initiales font référence à toi (Nour) et à tes collaboratrices (Carine et Tatiana), mais on ne peut en être certain, et cette ambiguïté donne au film une dimension à la fois fictionnelle et ludique. Qu’est-ce qui a motivé le choix de cette forme de narration ? Et pourquoi la narration passe-t-elle à la première personne dans une des séquences finales du film ?
N.O. : Quand il y a passage de Nour à N., une distance se crée. C’est une manière de s’écrire soi-même à la troisième personne, de se pousser vers la fiction. C’est une façon de prendre la parole sans pour autant parler de soi-même (je l’espère au moins !). L’espace des trois personnages est celui dans lequel le réel et la fiction se côtoient le plus dans ce film. Et c’était très amusant d’osciller librement entre les deux.

La narration passe à la première personne au moment où il n’est plus question de la mer de Beyrouth, mais d’autres mers. Je me rappelle que nous avions pensé qu’il y a là besoin d’une rupture qui ressemble à celle du changement de lieu. C’est un moment qui marque une sortie géographique. Il y avait aussi quelque chose dans la manière dont ces passages descriptifs des mers « autres » ont été écrits qui passait de manière plus fluide et plus honnête avec le « je ». Et de la même manière que je voulais à tout prix éviter le texte et qu’en fin de compte, il est devenu un élément essentiel au film, la première personne s’est imposée elle aussi. C’est en quelque sorte la réponse à la question : je ne veux pas écrire le texte à la première personne parce que je n’aime pas le côté trop personnel que ça peut créer, mais si je devais le faire, comment est-ce que je le ferais pour que ça me plaise ?
F.A. : Je pense à la place particulière que la mer, et plus précisément la corniche, occupe dans la vie des beyrouthin-e-s. Je pense aussi à comment la présence de la mer façonne notre rapport au lieu, notre attachement à la terre, notre affinité à certains paysages ou environnements, et ancrent notre sentiment d’appartenance. À Beyrouth, nous sentons la mer, nous la respirons, nous l’entendons, nous l’apercevons. Notre quotidien est souvent ponctué par le rituel d’une marche le long de la corniche. La mer a également une forte dimension affective pour ceux d’entre nous qui vivent ailleurs, car tout autre lieu est incomplet s’il n’est pas au bord de la Méditerranée. Nous ne voyons pas Beyrouth dans ton film, et pourtant, je vois ce film comme une rencontre avec la ville, comme une tentative de dialogue avec elle. Le film est une réflexion sur le lieu et sur ce qu’il offre, sur ce qu’il rend possible et, surtout, sur ce qu’il rend impossible. C’est un très long prélude pour t’interroger sur ton rapport personnel à la corniche, à la mer, à Beyrouth. Comment les habites-tu et comment t’habitent-ils ? Tu m’as dit une fois que tu fais confiance aux villes qui sont au bord de la mer. Peux-tu m’en dire plus sur ce que cette confiance implique ?
N.O. : Je sens que les villes sur la mer, justement parce qu’elles sont confrontées à la complexité de cette mer qui est géante, plus grande que soi, développent une relation d’humilité par rapport à elle. C’est une relation qui donne beaucoup, et enlève beaucoup aussi. La mer te donne l’illusion que tu peux partir, elle donne l’illusion d’un horizon infini, mais elle a aussi tellement d’autres connotations : la mer comme quatrième mur à Gaza, ou la mer comme présage de l’invasion israélienne à Beyrouth. Mais elle peut aussi provoquer un sentiment de calme et de stabilité. Toute personne qui vit dans une ville sur la mer a ces contradictions en elle d’une manière ou d’une autre. Une certaine sagesse et une certaine usure. Je trouve cela soulageant. J’ai confiance dans le fait de côtoyer une multiplicité, une complexité. Cela m’apaise, parce que ça me permet d’être multiple aussi.

Dans une ville côtière, la mer agit comme une boussole. On circule toujours par rapport à elle. Quand on arrive dans une telle ville, on ne manque jamais d’aller vers la mer. Et puis, pour regarder la mer, il faut tourner le dos à la ville et vice-versa. Ce n’est pas le cas des fleuves et des rivières — qui ont deux rives. Le son de la ville, même s’il est hors champ, a un effet d’ancrage, il nous indique qu’il y a là, juste au bord du cadre, une ville qu’on ne voit pas. Beyrouth est à la fois le contre champ et le hors champ de la mer. C’est ce que j’ai essayé de capter dans la dernière séquence avec le mouvement panoramique.
Mais aussi, ce que je décris est une relation un peu trop romantique à la mer. La réalité est différente parce que la mer à Beyrouth est de moins en moins accessible. Elle est polluée et privatisée. Elle n’est plus vraiment un espace public. La relation que nous avons à la mer de Beyrouth devient de plus en plus cinématographique. Elle est image, on ne peut plus la toucher, on ne peut plus y nager. Je me demande alors quelles sont les formes de dialogue possibles aujourd’hui avec une mer qu’on ne peut plus que regarder et entendre ?
F.A. : Durant l’échange avec le public suite à la projection de ton film, tu as parlé de la révolution du 17 octobre 2019 comme un moment qui a marqué une coupure entre un temps d’avant et un temps d’après. Tu as également dit que, bien que one sea, 10 seas ait été fait avant, il constitue ce que ta collaboratrice Carine Doumit a appelé « une archive du sommeil avant l’éveil ». Comment situes-tu ton film par rapport à cet avant/après ? Quelle est la signification de ce moment historique que vit le Liban pour toi et pour ta pratique artistique ? Dans le texte de présentation de la projection de ton film au FID Marseille, un des programmateurs du festival fait allusion au fait que tu tournes le dos à ton pays et à son histoire dans ce film, est-ce que tu penses que tu veux/peux maintenir cette position aujourd’hui ?
N.O. : Je trouve qu’il est très difficile de répondre à ces questions de manière claire. Je n’ai que des fragments de réponses, des ressentis que je ne sais pas comment synthétiser. Ce que je propose donc est de te répondre sous forme de liste d’idées qui constituent une constellation de pensées/émotions qui me traversent depuis octobre dernier :
*La révolution a été un grand bouleversement qui nous a plongés dans une urgence où tout ce qui n’est pas en relation directe aux revendications sociales et politiques semble s’effacer.
**Pour la première fois dans ma vie, je me suis sentie interpellée non pas à travers mon rapport au cinéma, mais à travers mon rapport à un lieu.
***Qu’est-ce qu’une cinéaste engagée ? Et engagée dans/pour quoi ? Il est très dur pour moi de voir mes films comme des arguments pour ou contre une certaine cause.
****Je pense à Jocelyne Saab au moins une fois par jour, je me demande ce qu’elle aurait filmé, ce qui aurait capté son regard.
*****Une amie libanaise à Montréal me dit qu’il faut tout capter pour tout documenter. Je trouve qu’elle a raison, mais je n’arrive pas vraiment à filmer (quelques courtes vidéos de temps en temps, mais pas plus). Mon geste n’est pas innocent et je ne sais pas du tout où me placer. Je n’arrive pas à regarder les événements droit dans les yeux.
******Ce que j’arrive à faire par contre, c’est d’accumuler des sons enregistrés sur mon téléphone. L’enregistrement du son accompagne le mouvement de mon corps lors des marches (téléphone dans la poche) alors que la caméra impose une position du corps très inconfortable (téléphone dans les mains à hauteur du buste).
*******Je ne sais pas si je tournais le dos à mon pays et à son histoire dans ce film. Je crois que je regardais les choses de profil alors qu’aujourd’hui, je me sens forcée de les regarder en face.
********Je ne sais pas regarder les choses en face.
*********Il y a clairement un point de rupture qui a marqué un temps d’avant.
**********L’après… je ne sais pas à quoi ça va ressembler. Aujourd’hui, je sens qu’on est encore dans un entre-deux.
Farah Atoui prépare un doctorat en communication à l’université McGill de Montréal. Sa recherche porte sur la culture visuelle autour de la crise des réfugiés syriens. Elle est membre de Regards palestiniens et de Regards syriens, deux collectifs dédiés à l’organisation de programmes annuels de cinémas palestiniens et syriens contemporains.
Notes
- Citation traduite par F. Atoui de l’anglais : “I don’t think of my films in terms of categories … but rather as fluid, interacting movements. The first is to let the world come to us through an outside-in movement—this is what some call “documentary”. The other is to reach out to the world from the inside out, which is what some call ‘fiction’.” Dans [url=https://frieze.com/article/there-no-such-thing-documentary-interview-trinh-t-minh-ha]https://frieze.com/article/there-no-such-thing-documentary-interview-trinh-t-minh-ha[/url] ». ↩
- Citation traduite par F. Atoui de l’anglais : « … this seeing which comes before words, and can never be quite covered by them, is not a question of mechanically reacting to a stimuli. We only see what we look at. To look is an act of choice. As a result of this act, what we see is brought within our reach… To touch something is to situate oneself in relation to it. We never look at just one thing; we are always looking at the relation between things and ourselves. Our vision is continually moving, continually holding things in a circle around itself, constituting what is present to us as we are. » Dans Ways of seeing, London, Penguin Group, 2008 : 1972, p. 8. ↩
