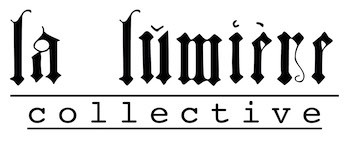Scintillement d’une mémoire
Ce texte est présenté dans la cadre de la série ÉMERGENCE, organisée et présentée par [la lumière collective->www.lalumierecollective.org], en collaboration avec la revue Hors champ[[ De nuit, la lumière collective est un microcinéma qui projette des films, des vidéos et du cinéma élargi produits par des artistes locaux et internationaux. De jour, la lumière collective est un studio d’artistes et un espace de résidence avec plusieurs ressources permettant de travailler et expérimenter sur divers supports d’images en mouvement. Le collectif est dirigé par des artistes et conservateurs locaux qui croient en la création d’œuvres et d’espaces cinématographiques sur une échelle humaine. Nous facilitons des évènements afin de rassembler les gens. Nous créons des liens pour répandre et revitaliser le cinéma.
La lumière collective est ancrée dans le local, le physique, l’ici et maintenant.
En ce moment de connexions virtuelles et distanciation physique, nous avons transformé notre espace de projection en un espace virtuel, tout en conservant la connexion locale.
ÉMERGENCE est la version en ligne adaptée des activités concrètes prévues par la lumière collective. L’amour en ligne à l’époque de COVID.
Au lieu de tout simplement décharger les films et vidéos proposés en ligne, la lumière collective a sélectionné une œuvre par artiste et a demandé à ce qu’un écrivain local s’implique avec cette œuvre.
ÉMERGENCE est une nouvelle combinaison, une connexion locale, un engagement pour contrer la séparation.
Nous sommes impatients de vous voir de l’autre côté.
EMERGENCE est présenté avec le support du Conseil des arts du Canada. ]].

“cliquez sur moi”
L’image peine à se fixer, dans un sursaut elle éblouit, le temps d’un frame à peine, nous laissant le sentiment d’avoir entrevu quelque chose. Ces tremblements parcourent Not Moldova, 1937 comme les traces d’un aveuglement parfois volontaire, parfois subi. En début de plan, au milieu, pour le conclure, ces scintillements nous font douter et nous demander si nous avons réellement vu cette image. Les camps, la Moldavie, résidus d’une mémoire : celle de Madi Piller, de l’Europe, du monde occidental, la mienne, la nôtre. Elle chancelle, n’existe peut-être pas, insaisissable et ineffaçable. La déportation presque collée au terme de mémoire, comme si l’un n’allait pas sans l’autre, et avec eux l’oubli, peut-être était-ce lui aperçu le temps d’un photogramme. L’image est trop fugace et abolit toute certitude, et dans cet état incertain, le premier élan, comme une résistance au sens, est de ramener le scintillement à ce qu’il est techniquement, un éclat de lumière à travers l’objectif d’une caméra.
Il y a d’abord l’obturateur qui renvoie au nombre d’images par secondes dont découle un temps d’exposition (dans le cas des emblématiques 24 images du cinéma, il sera de 1/48e de seconde en raison de l’intervalle d’obturation entre chaque photogramme). Vient ensuite le diaphragme, iris mécanique au diamètre variable et, enfin, les filtres qui peuvent être placés avant ou après l’objectif. Toutes ces données — ici présentées rapidement et avec bien trop peu de détails pour véritablement souligner les subtilités mécaniques de l’appareil de cinéma — sont autant d’idées complexes qui peuvent être résumées de manière simple. L’image cinématographique est le résultat d’une exposition du film à une lumière à l’intensité variable dont le spectre s’étend d’une image sans lumière, le noir, à une image totalement lumineuse, le blanc (un intervalle réversible du négatif au positif). Dès lors, on pourrait penser que l’enjeu d’une image est de trouver son juste équilibre au sein de ce spectre, celui qui permettra de produire le résultat le plus clair, jouant entre les deux revers de la disparition : la surexposition et la sous-exposition. Mais cette clarté de l’image semble fragile, elle disqualifierait l’altération comme signifiant. Comment par exemple rendre compte de l’éblouissement provoqué par un reflet solaire sur l’eau si la caméra est réglée pour aller contre l’aveuglement? Comment aussi montrer la lente adaptation de l’œil à l’obscurité si ce n’est en imitant une ouverture progressive du diaphragme? Ces divagations techniques et ces exemples hasardeux ne semblent que peu éclairer les images de Madi Piller. Pourtant, dans ce vocabulaire savant, de l’iris mécanique à l’iris organique, le temps laissé à la lumière pour s’imprimer sur la pellicule semble se confondre avec celui que prend le souvenir pour se fixer à la mémoire. Un écho se dégage, laissant entrevoir si ce n’est un sens, une analogie téméraire entre la lumière photographique est celle de l’histoire de Not Moldova, 1937.
Contrairement à la lumière, la mémoire ne semble pas avoir d’état fixe qui pourrait s’apparenter au blanc et au noir, elle n’est que spectre sans binarité. On serait tenté d’associer l’état 0 à l’oubli, mais ce dernier est toujours partiel, zone de pénombre plus que de noir comme ces paroles qui traversent le film, toujours fragmentées, découpées, incomplètes. The all community was under water, nous dit la première voix du film, puis d’ajouter and… avant d’être interrompue par une toux qui met fin à la prise de parole. Le discours est atteint d’une forme d’amnésie, laquelle? Il y a certainement l’amnésie traumatique qui efface pour protéger, il y a aussi l’amnésie collective forcée d’une histoire encore prise dans les jeux de pouvoir politique comme ceux qui dissimulèrent des années durant le rôle de l’URSS dans les premières déportations. Mais l’amnésie est toujours imparfaite, ne saurait se défaire des traces indélébiles laissées par ceux qui ne sont plus.
Quant à l’état 1 de la mémoire, elle s’incarne par le souvenir, le devoir de ne pas laisser disparaître, mais celui-ci n’est jamais exact, il est un montage saccadé, celui d’un vieil homme assis sur une chaise, qui se lève puis se rassied, peut-être n’a-t-il jamais bougé. C’est au sein de cet espace entre trop plein et pas assez que se glisse Madi Piller, là où les images de la Shoah sont omniprésentes, socle du monde d’aujourd’hui, incarnation évidente, presque caricaturale de la barbarie, si bien que l’on se demande si montrées sans cesse, ces images n’avaient pas perdu leur valeur première, n’étaient pas devenues un souvenir détaché de sa réalité. Tout comme le film, la mémoire souffre de la surexposition, mais aussi de la sous-exposition, car il semble évident qu’autant que la répétition acharnée de cette mémoire, son absence serait l’effacement progressif de ces milliers d’individus qui ne peuplent plus les paysages déserts de la Moldavie. Cette tension, je crois, prend forme dans les scintillements, point de rencontre entre la technique de l’image et son rapport viscéral à la mémoire.
Je me demande ce qui se cache dans ces plis, décide de les ralentir, de retrouver numériquement chacun des photogrammes qui les composent, d’essayer tant bien que mal de les comprendre, d’en offrir une typologie pour, à mon tour, à travers la mémoire et le regard de Madi Piller, discuter le mien. Ce dernier reçoit ces images qu’il croit déjà avoir vues, elles s’estompent encore et toujours, mais ne s’effacent jamais.

“cliquez sur moi”
Il y a d’abord le scintillement du paysage en début de plan, il apparaît soudainement dans un flash blanc le temps que la pupille se rétracte et que se superposent la beauté de cette nature sauvage et la laideur de la sauvagerie qui y a fait disparaître toute vie. Parfois, l’éclat intervient au milieu du plan, il anime soudainement le calme, fait vibrer quelques nuages comme un éclair troublant la tranquillité, rendant la contemplation impossible, sans cesse assaillie par un ailleurs, un avant résiduel.
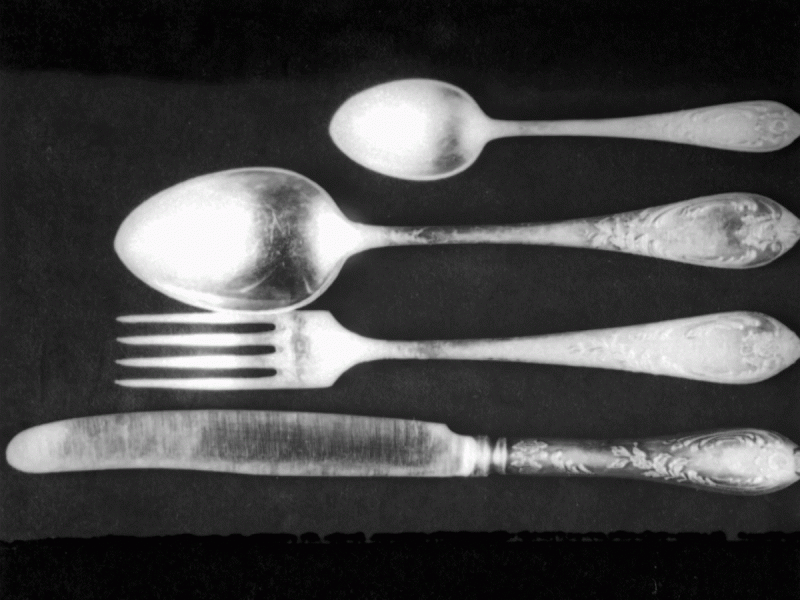
“cliquez sur moi”
Cet avant, on le distingue un peu dans les objets, l’argenterie qui nécessairement évoque un usage passé. L’argenterie qui, comme la colline et la rivière, a traversé le temps, mais a été forgée par une main qui n’existe plus.
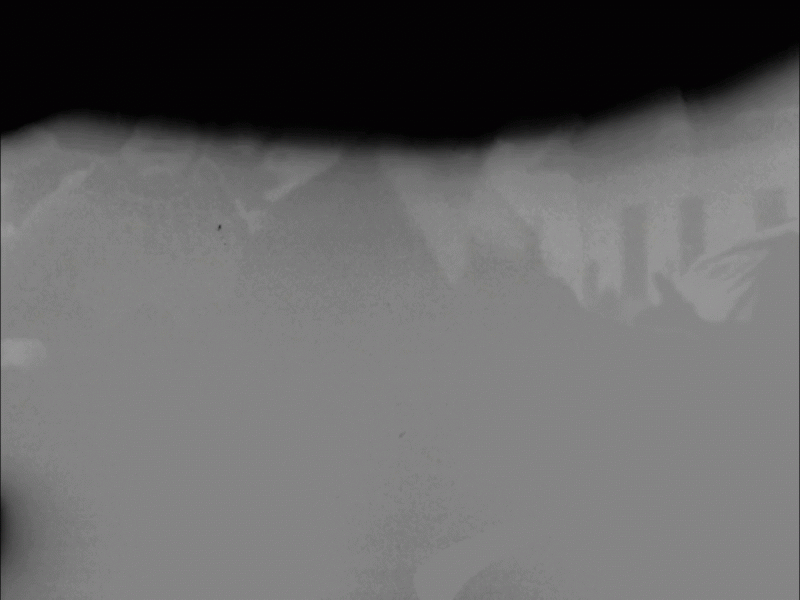
“cliquez sur moi”
Et puis ces figures sombres qui marchent entre les dunes, des corps sans visages, dont la puissance évocatrice nous pousse parfois à oublier l’humanité de ces individus. Le scintillement alors nous refuse la banalité, nous force à maintenir l’attention, à distinguer des hommes, des femmes, des enfants, et non une foule homogène de déportés.

“cliquez sur moi”
C’est ce même scintillement qui un instant éclaire les visages dans les pendentifs, visages parfois conservés, souvent détériorés par le temps, marqués de la même cicatrice que celle de la mémoire.

“cliquez sur moi”
Mais ces visages ont l’allure décrépie de ruines qui nous parlent sans que l’on parvienne exactement à saisir leurs paroles. Ce scintillement, c’est le souvenir de ce qui a disparu, autant les portraits que les tombes dont la pierre s’effrite. Des monolithes mortuaires qu’on ne sait plus regarder, que l’on voudrait oublier, dont on doit se souvenir. Alors la caméra elle aussi divague, ne sait plus comment s’y exposer.

“cliquez sur moi”
Soudainement, le film s’emballe, le scintillement devient clignotement, agression brutale, chaos du métal sous soleil de plomb, les rails défilent et le verrou du wagon tressaute, rappelle que dans le ciel du village s’est écrite une histoire de la mort.

“cliquez sur moi”
La mort habite encore les nuages, si bien que l’on ne sait plus si le scintillement est celui de la caméra ou celui d’un orage qui plane encore. Une flamme ardente, celle de la brûlure, mais aussi celle qui refuse de s’éteindre au creux d’un foyer fragile que l’on alimente de paroles, d’images, d’une mémoire ici et maintenant pour que le passé appartienne encore au présent.

“cliquez sur moi”
Parce qu’il englobe tout entier les deux mouvements, le noir et le blanc, le souvenir et l’oubli, il est essentiellement ce mouvement soudain, qui balaie le spectre de l’apparition à la disparition, laissant le sentiment d’avoir aperçu plus que vu. Déjoué par mes stratagèmes de montage, ces scintillements finissent par me révéler une image qui n’existait pas jusqu’alors, qui était là sans que l’on ne puisse la saisir. Entre deux photogrammes d’un cheval seul dans la plaine, une figure apparaît. Elle porte ce qui ressemble à une caméra autour du cou. Inévitablement, je me rappelle du vieil homme, j’aurais aimé qu’il s’agisse de lui pour avoir la certitude qu’il se soit bien levé pour continuer les tâches journalières de ce qui semble être une ferme. Mais dans cette fugace apparition, l’homme incarne un autre scintillement, celui d’une mémoire non plus technique ou organique, mais une mémoire humaine transmise à qui tente encore de la voir : une présence, un reflet imprimé sur le film et ayant à travers les corps — celui du vieux et celui de l’homme — traversé la Moldavie. Celle du village vrombissant en 1920, la Moldavie de 1937 et la marche funeste vers le train, la Moldavie de Madi Piller sur les traces de ses ancêtres qu’elle observe à travers l’objectif, la Moldavie d’un photogramme manipulé sur une table de montage (qui conclut Not Moldova faisant signe encore vers cette analogie cinéma/mémoire) et la Moldavie qui n’en est plus une, ou peut-être un ultime scintillement qui résiste à l’effacement pour s’offrir au regard.