Réflexions sur le cinéma de Marian Dora

«On peut admettre que, dans aucune littérature d’aucun temps, il n’y a eu un ouvrage aussi scandaleux, que nul n’a blessé plus profondément les sentiments et les pensées des hommes. Qui aujourd’hui oserait rivaliser de licence avec Sade? Oui, on peut le prétendre : nous tenons là l’œuvre la plus scandaleuse qui fut jamais écrite. N’est-ce pas un motif de nous en préoccuper?»
- Maurice Blanchot, au sujet de la Nouvelle Justine dans Lautréamont et Sade, Paris, Éditions de Minuit, 1963, p. 17
«It’s for everyone. For people like me.»
- Pier Paolo Pasolini, au sujet de l’audience cible de Salo ou les 120 jours de Sodome
C’est à l’âge 15 ans que j’ai découvert l’œuvre monolithique du Marquis de Sade. La lecture des 120 Jours de Sodome (au grand désarroi de ma prof de français) avait provoqué chez moi autant l’horreur qu’un émerveillement trouble face à l’idée qu’un être humain ait pu écrire quelque chose d’aussi monstrueux et impardonnable. Et pourtant, il fallait me rendre à l’évidence, elle existait, cette œuvre: cette succession apparemment sans fin de blasphèmes, tortures, sévices, mutilations, meurtres et massacres, quelqu’un avait pris le soin de la coucher sur le papier, en ayant qui plus est la courtoisie de posséder un certain génie.
Longtemps, j’ai pensé au film 1 qui aurait le pouvoir de porter l’horreur de façon aussi systématique et irréfutable. Que signifierait pareil film? Faudrait-il s’en préoccuper?
INITIATION


Caribbean Sunrise (Marian Dora, 2010)
C’est en remontant la (très longue) piste du cinéma d’horreur et d’exploitation que j’ai découvert le cinéma de Marian Dora. C’est un nom qu’on entend d’abord comme une rumeur, voire comme une menace. En bon élève, on avait regardé sans broncher l’interminable succession des Saw, avant de braver A Serbian Film, s’infliger Nekromantik, grincer des dents devant The Bunny Game et même oser la série Guinea Pig (en version japonaise et américaine), non sans une pointe d’inquiétude sur ce que ces visionnements successifs indiquaient sur notre propre compulsion masochiste à chercher le pire. Sur internet, les gorehounds et autres edgelords autoproclamés rivalisent de bravade (et de machisme) et poursuivent la recherche à bien des égards sisyphéennes de ce qui constituerait le endgame nauséeux de leur odyssée dans l’enfer du plus trash, du plus gore, du plus révoltant. Quelque part entre Fred Vogel, Andrey Iskanov et Tamakichi Anaru, ce nouveau nom, donc : Marian Dora 2 .
Le moins qu’on puisse dire, c’est que le personnage sait comment entretenir son mythe: un cinéaste allemand (les rumeurs font état d’un emploi « de jour » comme médecin), soi-disant végétarien, caché derrière un pseudonyme 3 , ayant fait ses dents sur les plateaux du truculent Ulli Lommel et maintenant un mystère opaque sur sa vie privée, tel un véritable Terrence Malick du cinéma extrême… À son actif, une poignée de longs-métrages : Cannibal (2006), Melancholie der Engel (2009), Voyage to Agatis (2010), Debris Documentar (sorti en 2012, mais tourné en 2003), Carcinoma (2014). Des titres pour la plupart assez difficiles à obtenir (encore plus avec des sous-titres de qualité, ou des sous-titres tout court), précédés par la rumeur de scènes repoussant les limites du tolérable (coprophilie, bestialité, violence sous toute ses formes, séquences de cruauté animale soi-disant authentique, etc.) et de tournages cauchemardesques.
Retournons un peu en arrière. Avant ces films qui lui ont conféré sa notoriété underground, il y a Carribean Sunrise, un des premiers courts-métrages de Dora, datant de 2002. Très court (à peine 3 minutes), le film s’ouvre sur une série de plans idylliques, tournés en vidéo (format de prédilection du cinéaste), d’un coucher de soleil quelque part dans les Caraïbes (on aura compris) — un petit coin de paradis croit-on, jusqu’à ce que la caméra glisse de la mer à un cadavre à demi nu abandonné face contre terre au milieu de la jungle. Sans perdre de sa placidité langoureuse (une placidité désormais suspecte, complice), la caméra recadre l’abjection de ce corps blafard en une vanité suggérant une nature aussi majestueuse qu’indifférente, marécage prêt à engloutir le promeneur solitaire. Il n’y a là rien de bien compliqué : mais à travers cette courte méditation, aussi crépusculaire que voyeuriste, je me trouvai en quelque sorte initié à un secret — un secret aussi sale que poisseux.
Cette initiation terminée, j’allais regarder tous les films de Dora sur lesquels je pouvais mettre la main. Ces visionnements m’ont fait voir nombre d’images dont je n’ai encore pu me défaire (en cela, les ambitions de Marian Dora ne diffèrent guère de celles de n’importe quel cinéaste). Et pourtant, c’est ce cadavre anonyme, les cuisses barbouillées de sang, la tête recouverte d’un tissu blanc, ce cadavre qu’on imagine bientôt décomposé, cerné de mouches, qui paraît destiné à me hanter le plus longtemps, horizon livide et déchiré d’un paradis perdu.
PLAIE

Reise nach Agatis (Marian Dora, 2010)
Au risque de statuer l’évidence, nous sommes ici en présence de films violents. Au menu, la castration, le meurtre, le dépeçage et la cannibalisation d’un homme s’étant volontairement offert en victime à un anthropophage (Cannibal), la partie de débauche meurtrière d’un groupe de libertins isolés dans une maison de campagne (Melancholie der Engel), les jeux sadiques d’un couple de psychopathes (Voyage to Agatis), la double-vie perverse d’un assistant de plateau (Debris Documentar), la lente et sordide déliquescence physique et mentale d’un homme atteint d’un cancer du côlon et refusant tout traitement (Carcinoma). Mais la violence de Dora n’est pas tant celle du coup de couteau, de l’exécution ou de la torture (bien qu’on trouve ces éléments en abondance dans ses films) que celle de la plaie, ouverte dans tous les sens du terme ; plaie agrandie, triturée, léchée, pénétrée, plaie menaçant à tout moment de déborder, de se répandre sur le monde.
Certainement, comme le diraient ses détracteurs, la violence chez Dora est gratuite, vile, nihiliste, sadique, cruelle, etc. Mais surtout, et c’est peut-être pourquoi même les critiques de cinéma d’horreur les plus aguerris l’ont condamnée de façon aussi implacable, cette violence ne renvoie qu’à elle-même, sans chercher le couvert ou la rationalisation de la satire, de l’allégorie ou d’un quelconque effet horrifique.
Souvent (particulièrement dans Melancholie der Engel), l’acte de violence paraît échapper à toute logique : on laisse telle victime échapper à la mort que pour mieux la torturer ensuite; le cadavre mutilé reprend soudainement vie et est immédiatement tué de nouveau; la lame du criminel se retourne subitement vers son complice; la victime devient spectatrice puis participante à l’horreur, etc. Parlant des victimes, elles apparaissent bercées d’une inconscience à toute épreuve face à leur situation, comme hypnotisées, quand elles ne vont pas se jeter volontairement dans la gueule du loup (dans Cannibal, c’est la « victime » qui sermonne sèchement le cannibale quand celui-ci est incapable d’aller jusqu’au bout). On voit bien que Dora n’est pas tant intéressé par les final girls, tueurs masqués et autres jeux sadomasochistes propres aux slashers. Voyage to Agatis, à bien des égards une tentative plus ou moins réussie de « normalisation » de son cinéma (via une tentative plutôt ratée de psychologie à la Knife in the Water), singe le genre, mais ne ramène invariablement (en ouverture et en conclusion) qu’à la profondeur insondable de la plaie, après les détours superficiels de la psychologie et du suspense: c’est dans les rayons aveuglant du soleil, le fracas incessants des vagues et cette bouche déchirée par la lame d’un couteau qu’on trouvera le cœur du film, plus que dans ses dialogues ampoulés et ses personnages convenus. Pour le subséquent Carcinoma, Dora est parvenu à faire l’économie des encombrantes conventions du genre en rassemblant agresseur et victime à l’intérieur d’un seul et même corps, transformé en une gigantesque plaie suppurante tour à tour torturée et torturante.
PEUR

Cannibal (Marian Dora 2006)
Aussi surprenant que cela puisse paraître, les films de Dora ne sont pas très effrayants (si ce n’est que dans l’anticipation de leur visionnement, peut-être) : peu de suspense, aucun sursaut, chat qui hurle ou portes grinçantes, pas d’attachement à l’un ou l’autre des personnages qui susciterait quelque forme d’effroi empathique, très peu enfin de tous ces mécanismes soigneux du cinéma d’horreur 4 . Encore une fois, l’intérêt de Dora se trouve ailleurs.
Plutôt que de la peur, je regardai Melancholie der Engel (puis, dans l’ordre, Cannibal, Voyage to Agatis, Debris Documentar et Carcinoma) habité par la révulsion, certes, mais aussi par une fascination sans cesse grandissante devant un étalage aussi abstrus des obsessions les plus sombres de l’âme humaine : obsessions qui, graduellement, allaient devenir les miennes. Il n’y a pas là de frayeur, mais peut-être l’appréhension d’un grand danger, le danger de cette image qui irait trop loin, qui traverserait l’écran pour s’imprimer sur ma rétine, et ne plus jamais me quitter : « Jamais plus je ne pourrai me débarrasser de ces sentiments », observe avec une langueur rêveuse Katze, héros-meurtrier de Melancholie der Engel.
CARSTEN FRANK ET LE RIRE

Melancholie der Engel (Marian Dora, 2009)
Il est impossible de parler du cinéma de Marian Dora sans aborder la figure de Carsten Frank, qui est apparu successivement dans Debris Documentar (jouant une version plus ou moins fictive de lui-même), Cannibal (dans le rôle d’un cannibale basé sur Armin Meiwes) et Melancholie der Engel, pour lequel il agit à titre d’acteur (dans le rôle de Katze), mais aussi de scénariste, sous le nom de Frank Olivier — cette collaboration marquant la fin de son lien artistique avec Dora.
Personnage résolument clownesque (l’horrible barbiche y est pour quelque chose), Carsten Frank incarne en son corps poupin et blafard l’intersection d’une innocence enfantine et d’une perversité apparemment sans limites (mais on me dira que l’un ne va pas sans l’autre). Debris Documentar illustre (non sans une certaine tendresse au moins aussi perverse que son protagoniste) la vie écartelée de Frank, entre son travail de jour sur les plateaux d’Ulli Lommel et ses escapades hédonistes qui mélangent en vrac pornographie hardcore, masturbation compulsive, fisting, coprophilie, sadisme et, finalement, meurtre et nécrophilie. Là où d’autres acteurs nous inspireraient effroi ou dégoût, Frank entretient une comédie mélancolique même dans ses excès les plus crasses, qui détonne avec la rigueur austère que Dora impose au reste de son œuvre.
Si Carsten Frank semble à bien des égards un personnage sorti d’un roman de Sade (« petit, court, fort épais… la peau très blanche… potelé… une voix douce et agréable… fort honnête en société quoi que sa tête soit pour le moins aussi dépravée que celle de ses confrères » 5 ), il pourrait tout aussi bien être Harpo Marx, c’est-à-dire qu’il est porteur d’un rire à la frontière du sanglot (ou du hurlement), d’une comédie pouvant à tout moment devenir tragédie.
NOURRITURE ET EXCRÉMENTS

Debris documentar (Marian Dora, 2012)
On mange étonnamment souvent dans les films de Marian Dora, et toujours avec voracité, ce qui n’est pas sans ironie pour un auteur ayant fait sa réputation sur sa capacité à couper l’appétit de son spectateur (moi compris). Melons d’eau et escargots dans Melancholie, poulet frit Kentucky dans Debris Documentar et même un concombre de mer (cru) dans Voyage to Agatis. Cannibal, évidemment, est construit autour de l’idée du cannibalisme, qui après 1 h 30 d’efforts (de la sélection de la « Chair » à son abattage, dépeçage et cuisson), est concrétisée par un somptueux festin. Mais l’acte de consommation n’est pas toujours aussi gastronomique (dans Debris Documentar, Carsten Frank, outre le poulet frit, mange aussi la peau morte entre ses orteils et ses crottes de nez) ni nécessairement lié à la bouche à proprement parler (consommation régulière de drogues de tout acabit).
La consommation n’est jamais loin de l’excrétion : chaque acte d’absorption trouve son écho sous la forme de vomissement, défécation, miction ou simplement crachat, avec une régularité systématique. À l’instar de Sade, l’érotisme paraît ici indissociable de la saleté et du déchet, ne transparaît à l’écran que comme suintant, visqueux, humide. Le sperme se mélange à l’urine, le vomi au sang, les larmes aux excréments, et ainsi de suite, tout cela de façon cyclique, présage d’éternels recommencements 6 . Le déchet ultime, le cadavre, est omniprésent : nous sommes dans un univers de charogne, d’os et de carcasses grouillantes d’insectes, invariablement pétris, caressés, embrassés, découpés et léchés par les personnages.
Dans Carcinoma, l’excrémentiel devient très littéral et, comme la violence, est recentré en un personnage : Dorian (on fera le rapprochement de nom assez vite), travailleur dans une usine de compostage, affligé par un cancer colorectal qu’il refuse de traiter, voit son corps se désagréger sous l’effet vicieux de la maladie, devenant littéralement un déchet (plusieurs relèvent l’odeur de pourriture qui l’accompagne), avant son inévitable mort et subséquente décomposition 7 .
BEAUTÉ

Melancholie der Engel (Marian Dora, 2009)
Il n’y a pas de coquetterie dans les films de Dora, nulle tentative, nul désir de transformer le violent ou l’impie en un spectacle esthétiquement plaisant 8 . Pourtant, son cinéma n’est pas entièrement étranger à une certaine idée de la beauté, entre ses extérieurs pittoresques (bords de mer, montagnes, collines, prairies, forêts luxuriantes), ses ambitions épiques (on notera la bande-son à la Riz Ortolani dans Melancholie), ses compositions soignées et un sens certain de la mise en scène lyrique à la Sokurov. Mais chez Dora, tout ce qui est beau passe pour travesti, dénaturé, décomposé, jauni : éclairages crépusculaires, lentilles poussiéreuses, couleurs délavées, vermines grouillantes en amorce du cadre, intérieurs délabrés, comédiens hallucinés, etc.
Le gore ressort comme noirci, entremêlé avec l’excrément — on n’y trouvera ni le plaisir coupable du grand-guignol de Herschell Gordon Lewis et de ses successeurs ni la beauté perverse de Hideshi Hino. S’il y a bien une certaine sensualité qui émerge dans ce barrage de corps dépecés, déchirés et décomposés, elle se heurte toujours au caractère implacable de la plaie. Et s’il y a plaisir (ou tout simplement un sens) à trouver dans une démonstration aussi crue, c’est par et pour cette violence, et non pour quelque version purifiée ou artistiquement filtrée de celle-ci, et voilà peut-être la proposition la plus horrifiante du cinéma de Dora.
En vérité, on trouve chez Marian Dora quelque chose de très archaïque, qui nous renvoie à la folie primordiale des mystères dionysiaques et de leurs corps tordus de jouissance et de douleur: le pressentiment du danger dans la jouissance, de l’abysse dans l’érotisme, de la décomposition dans une beauté qui ne peut exister sans payer le tribut de l’horreur. C’est un cinéma de mystère et d’incantations, sur lequel plane l’ombre de la convulsion, du sparagmos hystérique. Un cinéma que n’aurait sans doute pas renié Artaud, qui appelait de ses vœux à un art cinématographique du renversement, « plus excitant que le phosphore, plus captivant que l’amour » 9 .
ANGOISSE ET ABJECTION

Debris documentar (Marian Dora, 2012)
S’ils s’inscrivent dans la suite logique de Sade, les personnages de Dora, quoi que toujours dépourvus de remord, n’ont pas la confiance absolue des libertins des 120 Jours, dépourvus de tout doute, appréhension ou angoisse sur leur situation et leur devenir, convaincus de leur droit naturel à l’exaction et à la domination des plus faibles. À leur sujet, Blanchot écrivait : « Pour l’homme intégral, qui est le tout de l’homme, il n’y a pas de mal possible! S’il fait du mal aux autres, quelle volupté! Si les autres lui font mal, quelle jouissance! » 10 . Les personnages de Dora, s’ils adhèrent à cette profession de foi nihiliste pour les apparences (dans Melancholie, l’argument est réitéré ad nauseam au gré de nombreuses ruminations existentielles), ne peuvent bien souvent pas chasser l’angoisse qui est le prix de cette liberté absolue : angoisse convulsive, mélancolie agitée de frissons. Autant le plaisir de la douleur est savouré, autant il n’est que la distraction d’une finalité décomposée, à laquelle même le plus endurci des libertins ne peut échapper (on notera que nombre des personnages de Dora sont malades ou mourants, ou, du moins, paraissent manifester une quelconque forme d’affliction physique).
Dans Pouvoirs de l’horreur, Julia Kristeva écrivait : « S’il est vrai que l’abject sollicite et pulvérise tout à la fois le sujet, on comprend qu’il s’éprouve dans sa force maximale lorsque, las de ses vaines tentatives de se reconnaître hors de soi, le sujet trouve l’impossible en lui-même : lorsqu’il trouve que l’impossible, c’est son être même, découvrant qu’il n’est autre qu’abject » 11 . Ainsi en va-t-il du Katze de Melancholie der Engel, mourant d’une maladie nébuleuse et tentant désespérément (et pour la dernière fois) sa chance au jeu de la perversion et du vice pour n’être renvoyé que vers sa mort annoncée, son propre état de décomposition et de déchéance, d’abject.
MÉLANCOLIE
On trouvera certes beaucoup à objecter à l’œuvre de Dora — même les apôtres les plus convaincus de la liberté absolue du créateur auront de quoi rester dubitatif face à telle transgression, telle provocation.
Tout comme Sade, Dora demeure un auteur, à bien des égards, imparfait : ses métaphores sont souvent lourdes, son trait grossier, ses excès plus nombreux que ses subtilités. S’il est aussi jusqu’au-boutiste que Sade, il n’a pas son esprit de système, sa rhétorique acérée, sa capacité à pousser jusqu’à l’absurde une organisation méthodique du récit; ses scénarios sont des créatures difformes, tantôt minces et fragiles, tantôt lourdes et ampoulées. Malgré tout, on ne peut pas le balayer au rang des provocateurs juvéniles, des pornographes scabreux ou des voyeurs excentriques 12 — l’homme a de l’ambition, et une détermination obsessive sous-tend sa démarche obstinément libre et radicale, étrangère à tout compromis ou concession.
Il va sans dire que cette « expérience Dora » dans laquelle je me suis embarqué ne fut pas de tout repos : à cet égard, la publicité était tout sauf trompeuse. Mais une fois dissipé le choc viscéral de ce cinéma de la répulsion, subsiste sa mélancolie, comme la douleur d’un membre fantôme — ce soleil n’en finissant plus d’apparaître (ou de disparaître), ce corps blême et renversé sur le sable, cette mer brûlante comme une étoile, cette araignée prête à engloutir le monde. Un hurlement qui traverse la nuit : doucement, sans m’en rendre compte, je m’étais laissé prendre au piège de Marian Dora et de son monde crépusculaire, les doigts enfoncés dans la plaie.
Il serait hasardeux de s’aventurer sur le sens définitif à donner au cinéma de Marian Dora (qui, du reste, n’a pas l’air prêt d’interrompre sa carrière, avec de nouveaux films faisant régulièrement surface sur le circuit underground). Ce serait sans doute prendre cette curieuse et terrible œuvre à l’envers que de chercher à la vivre autrement qu’instinctivement, voire sensuellement; autrement qu’en s’ouvrant à son horreur aussi insupportable qu’inévitable, à son excavation de la chair et de la passion. On pourrait débattre très longtemps de la moralité ou de l’immoralité de pareille entreprise (si tant est que la moralité puisse encore être invoquée à une telle profondeur). Convenons toutefois, au risque de commettre une bien banale lapalissade, que les films de Dora existent, et que leurs images sont destinées à peupler encore longtemps les rêves de ceux qui s’y aventurent, côtoyant, peut-être même jusqu’à s’y confondre, les cauchemars éveillés de notre nouvelle (a)normalité. En dernier recours, on pourrait alors être tenté de se rassurer avec ce cliché débonnaire, autrefois rassurant, aujourd’hui mélancolique, bientôt insuffisant : « Ce n’est que du cinéma ».




Debris documentar (Marian Dora, 2012)
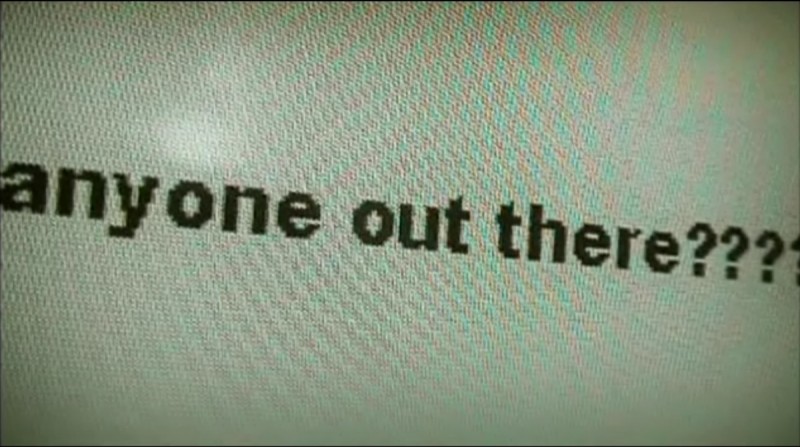







Cannibal (Marian Dora 2006)

Reise nach Agatis (Marian Dora, 2010)



Melancholie der Engel (Marian Dora, 2009)
Notes
- Pour les besoins de l’exercice, je définis ce film hypothétique comme une œuvre de l’imagination (au sens large), tout comme le sont les écrits de Sade; une représentation plutôt qu’une documentation. J’exclus donc les vidéos d’exécution, les snuff films et autres fragments du réel qui constituent une horreur bien à part. Les chevauchements sont inévitables, j’en conviens : Boris Vian (que j’ai lu pour la première fois à la même époque que Sade, incidemment) écrivait, dans l’avant-propos de L’Écume des Jours : « L’histoire est entièrement vraie, puisque je l’ai imaginée d’un bout à l’autre ». ↩
- Marian Dora apparaît sur plusieurs listes compilant le « meilleur » du cinéma « dépravé, malade, nihiliste » destiné à un public qu’on présuppose tout aussi « dépravé, malade, nihiliste » (par exemple : [->https://whatculture.com/film/20-depraved-movies-only-truly-sick-individuals-could-enjoypage=20]). On ne saurait toutefois le couronner trop vite: même s’il se situe aux dernières extrémités du cinéma d’horreur et d’exploitation, on peut aisément trouver d’autres cinéastes ayant poussé encore plus loin le bouchon du gore ultra-réaliste, de la violence gratuite et du sadisme exacerbé. Pourquoi s’intéresser à lui, alors? Tout simplement parce que chez Dora se dessinent les contours flous, mais immanquables d’une œuvre, avec ses obsessions, ses symboles et ses clés de lecture. Là où nombre de ses collègues se content d’épuiser le filon du gore, menant à des productions certes saisissantes au premier regard, mais au final interchangeables (voire lassantes, dans le pire des cas) dans leur accumulation aujourd’hui banale de torture et d’hémoglobine, Dora présente des films immédiatement reconnaissables par leur mise en scène et leur écriture, et témoignant d’une vision, osons le dire, unique. C’est à la singularité (et l’extrémité) de cette vision que je me suis intéressé, davantage qu’à une hiérarchisation basée purement sur la quantité de sang ou de tripes exposées à l’écran. ↩
- Des pseudonymes en fait : Marian Dora, Art Doran, M.D Botulino, et autres combinaisons aux sonorités similaires ont été employées au fil des années. ↩
- À cet égard, les films de Dora ne diffèrent guère des autres films du cinéma extrême (Guinea Pig, Tumbling Dolls of Flesh, etc.), qui, bien que souvent qualifiés de films d’horreur par convention, fonctionnent moins sur les effets de suspense que sur la révulsion qu’ils cherchent à provoquer. ↩
- Marquis de Sade. Les 120 Jours de Sodome, p. 33. ↩
- Nombre des films de Dora sont bâtis sur une structure cyclique : Debris Documentar, Voyage to Agatis et Cannibal se concluent sur l’anticipation d’une répétition imminente des crimes des protagonistes, tandis que Melancholie, s’il paraît s’achever sur la finalité de la mort de son protagoniste, conclut que « peu importe si cette personne est morte ou vivante, rien ne change dans l’univers et rien ne se perd ». ↩
- Détail tragi-comique, le film se conclut sur sa mère sénile posant une photo encadrée de Dorian sur un mur dédié aux membres disparus de la famille : mais plutôt que l’usuelle photo de Dorian « lors de jours meilleurs » qu’on aurait attendue dans de telles circonstances, il s’agit d’une photo le montrant sur son lit de mort, les traits tirés par la douleur, figé dans les derniers instants d’une douleur extatique (la photographie évoque d’ailleurs de façon assez frappante les photos de martyrs — dont le fameux cliché du lingchi — exhibées par Catherine Bégin dans Martyrs de Pascal Laugier). ↩
- C’est par exemple le cas dans un film comme Guinea Pig 2: Flowers of Flesh and Blood, où une sorte d’esthétique du gore est proposée : le sang comme peinture, la chair comme argile, le couteau comme un pinceau. ↩
- Antonin Artaud. Oeuvres complètes, vol. 3, Paris, Éditions Gallimard, 1961, p. 73. ↩
- Ibid, p. 30. ↩
- Ibid, p. 12. ↩
- À vrai dire, il est très difficile de situer Dora, trop extrême pour être catégorisé comme art cinema (aux côtés de provocateurs aujourd’hui « socialement acceptés » comme Lars von Trier, Zulawski ou Cronenberg) et trop intellectuel pour être relégué au rang de l’exploitation trash (on pensera à Lucifer Valentine, dont l’approche jusqu’au-boutiste (ici dans le créneau de ce qu’il appelle le « vomit gore ») le rapproche de Dora, mais qui ne s’encombre guère des ruminations existentialistes de son collègue). Cette position d’entre-deux explique sans doute son manque de popularité, tant auprès des fans du genre que des critiques « sérieux ». ↩
