Positions

Les textes aux points de vue divers que nous publions sur l’affaire of the North ne reflètent pas la position de tous les membres du comité éditorial de Hors champ. Les lecteurs sont aussi invités à lire le texte de Simon Galiero, ancien rédacteur d’Hors champ 1 , paru en mars 2016, qui offre une lecture critique de ce texte.
Il me semble n’avoir rien lu, à ce jour, — malgré la masse de textes écrits sur le film — sur les premiers plans d’of the North de Dominic Gagnon. Commençons par là. Deux hommes d’un certain âge, de dos, des Inuits semble-t-il, contemplent en jasant un ours polaire nageant dans un vaste aquarium qui emplit la surface de l’écran de sa masse bleutée et trouble. Soudain, après un certain temps, quelque chose — un gros caillou tombé dieu seul sait d’où — fracasse la vitre de l’aquarium et tout le monde y compris le caméraman, s’enfuient de la scène en courant.



Ce plan est suivi par d’autres, un homme sur un ski-doo, dans un paysage enneigé saturé de soleil qu’un groupe porte en triomphe, des images de deux Inuits exhibant fièrement des fusils de chasse, un plan de ciel montrant des parachutes largués du ciel, un homme blanc pilotant un avion planant au dessus de l’arctique, une image, superbe, prise du haut d’un mat, montrant le devant d’un bateau perçant les glaces, une jeune femme, filmée en gros plan, portant des lunettes solaires, scande dans le froid ce qui pourrait être un rap 2 , un tableau de bord illuminé, un paysage glacial et anonyme montrant une immense machine industrielle, des tracteurs fumant qui entrent et sortent du plan, une femme entrouvre une porte gelée libérant une bourrasque puissante qui envahit toute la pièce d’un nuage de neige dans un sifflement strident.



Il me semble que le montage de ces quelques vidéos, repiquées sur YouTube, permettent de nommer, assez simplement, le projet du film de Dominic Gagnon, l’image du territoire qu’il entend arpenter, les positions multiples qu’il désire faire coexister, et le sens premier du geste qu’il met en œuvre. Elles ont aussi le loisir, d’entrée de jeu, de nous montrer une autre image que la petite poignée de plans sur lesquelles bon nombre de critiques — parfois intelligents, parfois fort raisonnables — ont décidé de s’acharner avec une certaine obstination— et dont on parlera — pour disqualifier d’office le film et son cinéaste, sans appel possible, et en préjugeant du pire, qu’il s’agisse des intentions du cinéaste comme de son public-type qui en devenait par association le complice 3 . Que se passe-t-il si la vitre de l’aquarium — qui assigne une position claire, des rôles fixes, qui indique un seuil — venait à se rompre, se fracturer ? Quel renversement de regard se produirait ? Si on venait à ouvrir la porte pour ne fut-ce qu’entrevoir, un bref moment, cette nature déchaînée sur laquelle on n’a pas prise ? À quelle bourrasque, à quel trouble, à quelle beauté déroutante aussi, s’expose-t-on ? Ces quelques plans nous indiquent ainsi, et sans pour autant en faire un objet de fascination exotique ou de jouissance perverse, une certaine extranéité du Nord. Il présente aussi un ensemble de positions paradoxales — qui ont trait aux types d’images repiquées, à leur simple existence publique sur Internet, mais aussi aux échelles de plans, aux structures de regards qu’ils impliquent, aux qualités très diverses d’images, aux rythmes qui les habitent — et qui seront la matière du film. Ces quelques plans nous disent aussi que la violence et la peur peut coexister avec la beauté et l’émerveillement, la résistance et la lutte, la solidarité et la dignité, une lutte contre les diktats des éléments et de l’industrie, contre l’exploitation et la lourde chape d’une histoire écrite par ceux qui les ont de tout temps pris de haut. Ces quelques plans allégorisent aussi, il me semble, la guerre inattendue que le film a déchainée, la cassure que le film a révélée, le trou noir d’incompréhension qu’il a creusé, mais aussi l’horizon de beauté et d’invention qu’il ouvre, à qui veut bien le voir.



——
J’ai visionné of the North, dernier opus de Dominic Gagnon, une première fois, il y a quelques mois, à peu près dans la même position qu’il l’a « réalisé » : assis sur une chaise en bois (il parle pour sa part d’un fauteuil confortable 4 ), devant mon ordinateur. Comme lui, je n’ai jamais visité le grand Nord. Ma connaissance en toute sincérité des peuples qui habitent ces régions — je le dis sans fierté — se limite à une poignée de films illustres signés par des grands cinéastes, des symboles, quelques images, des textes, noms, des sons, les nouvelles qui nous viennent du Nord (presque toujours affligeantes). J’ai visionné le film, disais-je, quelques jours après son passage tumultueux aux RIDM, au mois de novembre, seul, le soir, devant mon écran d’ordinateur, précisément là où toutes ces images ont été braconnées ou rescapées, selon la position que l’on décide d’adopter. Je dis ceci à regret, car j’ai toujours estimé que la force politique et polémique, la force de décalage et de dissensus du cinéma de Gagnon, jusque dans l’embarras, le malaise, le questionnement et le trouble qu’il suscite chez moi et chez d’autres, s’éprouve au mieux devant un public, dans une salle, là où précisément ces images balancées sur le Web ne se retrouvent jamais, ne devraient jamais se retrouver d’aucuns diront, dans ce lieu en tout cas auquel elles n’étaient pas destinées[[ Gagnon le dit quelque part dans une très belle entrevue, « mon médium c’est la salle de cinéma. » (voir « Un entretien avec Dominic Gagnon », Imaginations, mai 2016, en ligne.). Je n’étais pas là les deux soirs où il a été présenté aux RIDM devant un public férocement et farouchement clivé (devant l’attitude désinvolte et désarçonnée de son auteur dépassé par la violence que le film suscitait, devant les bafouillages des organisateurs, qui n’ont sans doute pas aidé a dissiper les tensions). C’était avant que le tumulte se lève, se répande, se déverse et que, quelques heures après l’avoir vu en lien privé sur Viméo, son auteur m’écrive pour me dire : « tu auras été le dernier à voir le film en entier ». Depuis, le film circule au Québec auprès d’un happy few, sous le manteau, dans une version amendée.
C’était au mois de novembre dernier. On le sait, les réseaux sociaux se sont enflammés, quelques médias (radio, télé, presse écrite) se sont emparés de la chose, des prises de positions franches se sont campées (de part et d’autres), puis la chose est retombée, la braise commençait à tiédir. Puis, après de longs pourparlers, des tentatives de médiations, des mains tendues, des appels à la discussions qui se sont sans doute transformés assez vite en dialogue de sourds, des braquages et des échauffourées de coulisses et des menaces sérieuses, les Rendez-vous du cinéma québécois, qui avaient pourtant annoncé que le film ferait partie de leur programmation, ont décidé, la veille de la conférence de presse, de retirer le film et de proposer une projection-débat à un moment ultérieur, lorsque de meilleures « conditions » seraient réunies (la projection du film et même la conférence de presse, avec les diverses menaces qui planaient, risquaient d’être compromises, entraînant un tourbillon insoluble qui aurait porté ombrage aux autres « festivités »). Entre temps, le film a été montré à New York, Rotterdam et continue sa tournée avec son cinéaste, qui aura une rétrospective à Nyon, en avril (le film y avait d’ailleurs remporté un prix l’an dernier).
Pour résumer, et pour mémoire, on pourrait dire que le débat a rapidement été polarisé en deux camps bien découpés, et ce, une fois que la question épineuse des droits d’auteurs, responsable en faible partie de la polémique qui s’est embrasée — à savoir l’appropriation non-autorisée de la musique de Tanya Tagaq — ait été écartée, Gagnon ayant accepté de retirer sa musique de son film (bien entendu, pour certains détracteurs, cette indélicatesse ou cette violence qui consiste à s’emparer d’une musique d’une culture qu’on méconnait, analogue à une rapt néocolonial, participait d’un problème plus large qui lui demeurait, à savoir le fait que les filmeurs pas plus que les filmés n’ont, pour l’essentiel, pas donné leur autorisation pour le remploi de leurs images, malgré qu’il existe une nébuleuse juridique autour du statut légal de ces vidéos sur YouTube et que les titres des clips apparaissent au générique). Il y a donc d’une part ceux — et ils sont nombreux, de plusieurs horizons, anglophones, francophones, cinéastes, intellectuels, issus ou non des communautés autochtones, parmi lesquels certains ont vu, d’autres n’ont pas vu le film — qui considèrent que le film transpire ni plus moins et sans ambages d’un racisme crasse, ou au mieux qu’il trahit une ignorance totale et complète d’une réalité complexe, difficile, douloureuse, que le cinéaste s’approprie de façon indue et inappropriée, une réalité, celle du Nord, qui ne l’intéresse au final que pour ses aspects les plus sensationnels, pathétiques et scabreux : en toute innocence peut-être ou de façon volontairement malveillante, il réactive tous les stéréotypes les plus délétères sur le Nord et ses populations contre lesquels nombre d’artistes, d’intellectuels et de politiciens des communautés autochtones luttent avec acharnement depuis des années. Gagnon n’a jamais rencontré un seul Inuit de sa vie, à peu près le seul film sur le Nord qu’il a vu est Nanook of the North, et il a touché 32,000$ du Conseil des arts et lettres du Canada pour développer son projet. Il n’a pas consulté des représentants de la communauté pour savoir ce qu’ils en pensaient et ne s’est pas demandé s’il y avait un risque que le film soit mal perçu. En cela, il n’a pas suffisamment pris conscience de son « white privilege » 5 , et si on l’a accusé de « suprematisme blanc » (un terme qui, employé dans les milieux anglosaxons, je l’ai appris à mes dépends, ne veut pas nécessairement dire qu’on est membre du KKK ou qu’on est convaincu de la supériorité de la « race » blanche) c’est qu’il n’a tout simplement pas été en mesure de réfléchir de façon critique à sa position de « blanc » (qui plus est, de White Male Artist) devant ces images. Bref, s’il s’intéresse, s’il « trippe » devant ces images de diverses façons (et suppose que d’autres pourraient « tripper » avec lui), c’est qu’il les regarde, même s’il s’en défend et est évidemment offusqué à l’idée qu’on puisse l’en accuser, en adoptant le même regard colonial ou néocolonial, fut-il refoulé et inconscient, qui faisait que, à une autre époque, on « trippait » à aller voir les « nègres » dans des zoos humains. C’est une position.
Dans l’autre camp — et ils sont là encore nombreux, cinéastes, intellectuels, francophones (presque tous, disons-le), anglophones, certains qui ont vu, d’autres qui n’ont pas vu le film, là aussi —, il y a ceux qui le défendent en faisant valoir la démarche du cinéaste (déclinaison auteuriste : « voici un cinéaste qui fait des films depuis 20 ans, qui depuis dix ans pioche le Web pour monter ses films, tout ce travail s’inscrit dans une vision cohérente qui pose un regard lucide sur la société et toutes ses contradictions : ses films dérangent, il ne met pas des pincettes, tant mieux, Gagnon a toujours fait œuvre de provocation ») ; d’autres, parfois les mêmes, parlent de la nécessité de montrer une réalité troublante (déclinaison réaliste : « toute réalité, y compris celle des autochtones, et surtout si le tableau est peu flatteur, est bonne à montrer, même si on ne veut pas la voir, et c’est ce que fait Gagnon : oui le film est troublant, mais il est nécessaire ») ; il y a ceux, parfois les mêmes, qui le défendent au nom de la liberté d’expression et contre la rectitude politique (déclinaison polémique, qui découle de la précédente : « ceux qui s’opposent au film sont des vierges effarouchées qui tiltent dès qu’on touche à l’image qu’on voudrait pure des peuples autochtones : revenez-en, ce n’est qu’un film et l’auteur a droit à son point de vue »). Je pourrais continuer longtemps ainsi, et je force le trait un peu évidemment. Mais c’est pour montrer que, bien souvent, dans les deux positions qui s’affrontent ici, il y a un film qui tend à s’évaporer 6
Tantôt dépeint comme « certes difficile, mais génial et nécessaire », tantôt comme « odieux, innommable et raciste », oscillant entre un « il faut enterrer cette chose et ne jamais plus en parler » et un « il faut le montrer à tout prix pour s’opposer au chantage et à l’intimidation », on a considérablement fait monter les enchères du visible autour d’une œuvre qui, si elle n’en méritait au final pas tant (ou du moins, si elle méritait autant notre intérêt et notre attention que ses autres films qui attiraient lors de leurs projections qu’une poignée, rarement plus, de spectateurs), méritait au moins que l’on puisse la voir pour en parler, s’en faire un image. Car je crois qu’il est nécessaire d’être lucide et précis sur ce que le film fait et montre, comment il le montre, l’ironie (terrible, amère grinçante) et la puissance de décalage dont il est capable, tout en cherchant à affronter le plus directement possible les zones troubles et problématiques dans lesquelles il s’enfonce, ses angles morts, chercher à penser cette œuvre dans la globalité de sa proposition, sans pour autant se draper dans le drapeau de la liberté ou du droit de l’artiste — au nom de sa sacro-sainte démarche qui excuserait tout — à dire n’importe quoi n’importe comment, et tenter, finalement, de la replacer dans un contexte plus large qui, possiblement, viendrait non pas la dédramatiser, le disculper, mais orienter sa lecture et expliciter son intention (du moins celle qui semble, à mes yeux, surgir du film lui-même).
Peut-être est-il nécessaire de rappeler, avant tout, que la vraie violence — s’il faut parler de violence coloniale — n’est pas dans ce film et son geste, elle est dans l’exploitation sexuelle des femmes Inuits (à laquelle le film fait directement allusion), elle est dans l’exploitation industrielle, irresponsable et insensée du territoire, elle est dans l’indifférence complice, constante et concertée des gouvernements et d’une proportion terrifiante des citoyens envers cette réalité, depuis des décennies, alors que les problèmes sont connus, criants ; elle est dans la brutalité des conditions de vie de ces populations tenues en situation d’apartheid économique, juridique et politique. Le vrai crime est là, bien sûr et on peut se demander quel est le poids de ceci en proportion à ce crime, et qui méritait qu’on s’acharne avec autant de violence de la sorte sur lui. Un film qui tente, peut-être maladroitement, de traiter du Nord —c’est le problème pour certains — sans endosser une position claire et précise, une voix qui estomperait toute ambiguïté sur ses intentions et ses visées —, d’oser parler de diverses manières de cette violence, des effets toxiques qu’elle engendre sur les individus, mais aussi de montrer certaines facettes de la solidarité, des liens communautaires, des formes de résistance qui s’organisent, une certaine poésie du quotidien que l’on capte et que l’on partage, la banalité de l’intimité, le chant qui s’élève, le bruit et la fureur qui souffle sur ces territoires, en refusant dans sa forme et son esprit de nous laisser tranquille (à contempler des poissons), en ne proposant pas une vision hypocritement réconciliatrice qui ne cherche qu’à nous donner bonne conscience, pour ne pas avoir à en parler réellement de cette réalité, un tel film mérite qu’on s’intéresse à lui, qu’on lui permette d’exister, qu’on nous permette de regarder, de quoi et comment il est fait.
Je me permets d’ouvrir une autre parenthèse essentielle (il y en aura quelques-unes au fil de ce texte sûrement trop long). Il ne fait aucun doute qu’une bonne partie de la colère des détracteurs — qui a rendu encore plus intolérable et toxique le film, au point de vouloir empêcher que d’autres le voient et s’en fassent une idée — s’est trouvée décuplée par certaines déclarations de Gagnon 7 —, à l’effet que son film était une « provocation », du « free jazz », de la même manière que les Inuits intoxiqués étaient des gens qui avaient le droit de triper, des rebelles, voire qu’ils constituaient une « avant-garde artistique » vivant hors-norme, qu’il s’agit de gens qui boivent comme lui, que ces images ne le dérangeaient nullement, etc. Ces propos viendraient confirmer hors de tout doute la méconnaissance du cinéaste envers les réalités de ces communautés, ils exprimaient bien cet « entitlement » (comme disent les anglais) qui lui permettrait de tout dire sur tout, lui enlevant toute crédibilité pour aborder ces questions et ces réalités. Car le « problème » de l’alcoolisme et de la toxicomanie, on s’en doute, pour ceux qui ont cotoyé de près ces personnes qui en souffrent, est à mille lieux d’une quelconque vision dionysiaque de chasses, de fêtes orgiaques et de beuveries extatiques. On s’entend.
Mais je dirais pour ma part, et sans vouloir le défendre encore une fois, mais pour essayer de replacer l’esprit et la lettre du film, que les mêmes propos peuvent être « lus » sous un autre angle : oui, le film opère sur le mode de la provocation, par son style, son rythme, il vise à secouer ou à travailler de l’intérieur et dans tous les sens cette image du Nord (à fêler la vitre de l’aquarium). Il y a là une volonté de provocation, mais à ce compte, toute l’avant-garde artistique depuis Dada se conçoit de la sorte, pas la peine de lui en faire un procès ; il s’est aussi donné la « liberté » (on peut le lui reprocher, il me semble inconvenable de le lui refuser) de traiter son matériau comme un musicien, un peintre, de composer son poème abrasif en fonction de lignes, de couleurs, de rythmes internes aux plans qu’il a sous les yeux, de pleins et de vides, bref, d’envisager ce matériau comme une matière cinématographique 8 . Sur le dernier point (celui de la « célébration » de l’intoxication), on pourrait simplement dire ceci : lorsqu’on interroge (parfois agressivement) Gagnon à propos de ces images qui visiblement dérangent, son premier réflexe (défensif) est de dire que, lui, elles ne le dérangent pas, qu’elles ne le troublent pas. Eh! oui c’est à peu près certain que, à cet instant précis, Gagnon se sent plus proche, plus solidaire des types ivres en train de vomir, que du type qui l’interviewe et qui parle en leur nom et, en quelque sorte, à leur place. Devant une certaine vision —vécue, autorisée, protectrice et bienveillante — du Nord qui ne peut pas admettre (surtout venant d’un blanc qui n’a jamais mis les pieds dans le Nord) que l’on présente cette réalité autrement que comme un problème, un mal social, une plaie (ce qu’elle est, personne ne pourrait le nier), Gagnon (ou du moins son film), nous montre, aussi, une image, des images désarçonnées, titubantes, une situation, un fait, des individus concrets pris dans des filets de brume qui les abattent, inconscients, vulnérables ; il nous montre aussi ces gens filmés par des acolytes, des copains, des complices, qui les épaulent tant bien que mal, peut-être aussi un peu pour se moquer d’eux —par empathie, pour être aussi passé par là — braquent un téléphone ou une petite caméra sur leur détresse et la partage sur Internet où elle n’a été vue par personne, jusqu’à ce que Gagnon l’épingle et la balance dans son film. Non que cette image ne pointe pas vers un problème réel et complexe, mais je me demande si le scandale de ces images n’est pas dans le fait qu’elles nous montrent des situations à la fois singulières et quelconques qui permettent de situer le problème à un autre niveau, sur un autre plan, qu’elles lui donnent une autre forme, qu’elles ont le mérite de ne pas le réduire à un problème (dont on parle, qu’on déplore, auquel on greffe des statistiques qui donnent le vertige, etc.). Que lui, Gagnon, n’y voit pas de « problème », qu’il n’est pas heurté par ces pauvres images, ne veut pas dire, par raccourci, qu’il est indifférent ou inconscient du poids social que ces réalités font peser sur les communautés. C’est simplement qu’il se donne le droit d’y voir aussi autre chose.
Enfin, l’autre dimension de la question vient non pas de l’image en tant que tel et à la réalité à laquelle elle renvoie, mais du fait que ces clips se retrouvent là où Gagnon les as trouvées, où il les a très certainement volontairement cherchées (on peut bien sûr trouver douteux, comme le fait Aletheia Arnaquq-Baril 9 , son geste qui consiste à piocher le Web pour trouver des images de « drunk inuits »). Des images de gars saouls pullulent comme la peste sur le Web (c’est un sous-genre infini qui possède ses codes, ses compilations). Si elles existent dans of the North, c’est qu’elles font, qu’on le veuille ou pas, partie d’une certaine « idée du Nord », d’une image — et bien sûr, c’est un cliché, un stéréotype, un violent préjugé ancré dans la culture et l’histoire —que Gagnon n’a pas cherché à esquiver ou éviter : au contraire, il cherche à le prendre à bras-le-corps, à le placer à l’intérieur d’une vaste mosaïque d’images fracturée, l’inscrire dans un portrait choral, dans cette multitude de fragments qui participent à son chant dissonant. Car le domaine de son film, on le voit bien, on l’a souvent rappelé, n’est pas le territoire en tant que tel, mais la représentation, les images de ce territoire telles qu’elles existent sur le Web (captées par des individus qui habitent ce territoire, pour l’essentiel). Il m’apparaît que c’est à la faveur de ce léger décrochage que l’on gagne à voir le film.
Ce texte, j’ai commencé à l’écrire au mois de novembre, agacé par tout ce que j’avais pu lire de part et d’autres (d’un côté plus que de l’autre, c’est vrai), agacé par ce que je percevais comme une crispation puritaine des politiques identitaires, une volonté de contrôle de la représentation publique et un retour « classique » de l’accusation toujours un peu expéditive de racisme congénital dont on affuble les québécois francophones ; tout comme je pouvais être agacé par une sanctification, a priori et tout aussi aveugle sur le principe, de la libre expression, jusque dans la réception « esthétique », cool et joyeusement immersive de ce film trouble. À force d’échanger, de discuter avec les uns et les autres, dans une spirale infinie et insoluble de vues irréconciliables, de « oui, mais » et de « oui, mais », le texte était resté en plan, à l’image de de toute ces conversations qui finissaient par « c’est compliqué tout ça finalement ». Je me retrouve, comme nombre d’entre vous sans doute, des mois plus tard, à reprendre le fil des discussions, à échanger des courriels, à débattre avec des gens de tout horizons, à tenter de trouver du temps (que personne n’a) pour départager les avis, lire tous les articles, mieux appréhender les enjeux que ce film soulève, et de saisir — c’est mon cas en tout cas — l’occasion particulière que cette polémique occasionne pour interroger et mieux comprendre comment un même film peut être reçu de manière absolument diamétralement opposée par des gens dont on doit estimer l’intelligence. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais peut-être est-ce un des effets bénéfiques de ce film et du débat qu’il a suscité – Gagnon l’avait-il anticipé, était-ce même peut-être son souhait, personnellement, peu m’en chaut ? — c’est que je me suis trouvé, comme d’autres, poussé dans mes retranchements, à déboulonner des certitudes, et à tenter de défendre une expérience que j’avais vécue au contact de ce film qui m’avait totalement bouleversé et où je n’avais à aucun, mais absolument à aucun moment senti le moindre soupçon de racisme (si ce n’est celui que le cinéaste dénonce en la montrant dans son film), la moindre parcelle de préjugés négatifs (si ce n’est ceux que certains pouvaient posséder en eux et qui pouvaient être, au contraire, mis en accusation par le film), bref qui n’avait laissé en moi aucune impression ambigüe sur l’intention et l’effet provoqué (sachant que le film est plein de choses ambigües, difficiles et paradoxales). Je reconnaissais l’esthétique indocile et anarchique du cinéaste de Data et Du moteur à explosion, je voyais le monteur habile de RIP et Hoax_Canular, je voyais, surtout, dans les éclats de feu et de glace, une certaine humanité, une humanité en lambeaux, une humanité ordinaire, une humanité tenace, une humanité qui s’exprime à travers cette suspension poétique qui est la plus belle des formes de résistance : un petit enfant qui marche, filmé de dos, sur la banquise gelée, des adolescents qui font des culbutes sur des matelas, qui dansent comme des fous, qui réinventent Meliès dans leur cuisine, la chair rose d’une baleine dépécée, un narval tournoyant autour d’un plongeur, un time-lapse sur des falaises en train de s’ébrécher, le tremblement de peur dans la voix et la main du filmeur, parqué dans sa voiture, à l’approche d’un ours polaire, le souffle du vent qui emporte des planches de plywood comme s’il s’agissait d’un château de cartes, un jeune qui rappe haut et fort « In the land of ice and show / Don’t call me Eskimo ».





Mais la virulence du débat et la polarisation des positions nous a révélé à quel point sur ces questions, à l’évidence, nous voguons en eaux troubles, que les blessures sont profondes et les crispations inévitables, que certains des enjeux fondamentaux aussi banals que de se poser la question qui parle, à qui on s’adresse, comment cela est reçu, à qui ce filme peut-il être destiné ? (et qui a la permission de dire quoi) ouvrent un gouffre sans fond, un « trou noir ». Ce film est devenu une toile tendue sur laquelle il est possible de projeter et de délirer à peu près n’importe quoi, d’y voir une résistance au colonialisme et en même temps un étalage imbécile des stéréotypes racistes. Ceci étant dit, il me semble que le dissensus — qui est peut-être, je dis bien peut-être, la tension de laquelle peut naître un véritable questionnement politique sur cette question — est apparu au grand jour, dans toute sa brutalité, grâce à ce film, et qu’il n’est pas près de se dissoudre. Je vois, je sais, je reconnais pertinemment, en même temps, que c’est contre cette hypocrisie, ces préjugés, ces stéréotypes, cette violence, cet écart brutal de perception, que la majorité des détracteurs du film ont consacré une partie de leur vie, de leur carrière, de leur lutte. Mais je me demande, je leur demande : un film, ce film, peut-il réellement, tel qu’il a été présenté et auprès du public — pris au sens large —, auquel il est éventuellement destiné, peut-il réellement confirmer ou participer à aiguiser ces préjugés ? Ne replace-t-il pas, au contraire, brutalement, ces stéréotypes et ces clichés dans un environnement, une écologie d’images complexes et différenciées, à partir duquel, soudain, on parvient à en déchiffrer la violence ? Je pose la question. Je n’ose dire que je possède la réponse. C’est peut-être pour ça que ce texte, infini, est en train de s’écrire…
Car si j’ai désiré reprendre ce texte aujourd’hui, c’est dans ce nouveau climat, délicat et turbulent, suite bien sûr à l’annonce du retrait du film des RVCQ, d’une projection clandestine 10 , de d’autres qui s’annoncent à la publication d’un dossier de la revue 24 images sur les nouvelles pratiques documentaires (contenant un long texte sur le film de Gagnon), de la publication d’un texte d’André Dudemaine dans les pages d’Hors champ, de d’autres textes qui viendront sans doute. Ce texte, je l’écris, non pas pour me permettre de me camper dans une position (ou d’aider d’autres à choisir leur camp), non pas pour nourrir la polémique, ni pour diagnostiquer (psychanalyser ?) les raisons profondes, inscrites dans les sillons de notre (mais laquelle ?) histoire collective (faite de refoulements et de zones d’ombres, de violences et d’injustices, de racisme institutionnalisé et de désir d’émancipation des préjugés), qui ont mené à un tel clivage, mais en cherchant — sans trop savoir si j’y parviens — à nommer la brèche que le film ouvre, à saisir son geste propre, depuis son dispositif (qui se confond avec le geste cinématographique de son auteur), à tenter de saisir le kaleïdoscope vertigineux qu’il met en mouvement et l’engrenage, à la fois pervers, difficile et redoutable dans lequel il nous entraîne, et pour donner, enfin, une forme écrite aux innombrables heures que j’ai passées, depuis novembre, à parler de ce film avec quantité de gens, et dont j’ai tenté de faire entendre les multiples voix au fil du texte 11
Disons-le d’emblée, Dominic Gagnon fait partie des trois ou quatre cinéastes québécois qui me fascinent et que j’aime suivre, de film en film, parce qu’il tente, et quoi qu’on en dise, douloureusement, férocement, de se syntoniser, de capter et de travailler les puissances de vie — parfois les plus sombres, pugnaces, obstinées, solitaires — du monde contemporain dont il me donne, sans que j’ai à en faire, moi, le « reportage », la cueillette, l’enquête, des nouvelles (qu’on ne veut pas toujours voir ni entendre). Cette contemporanéité du monde et les puissances qui le traversent peuvent être saisies, pour lui, dans les recoins sombres du Web, où il passe forcément un temps fou : c’est le « terrain » de ce drôle d’archéologue (plus qu’ethnologue) sédentaire qui creuse la toile, comme on gratte la terre, pour essayer de capturer des réalités qui nous échappent et que, à bien des égards, on marginalise et écarte des discours officiels (les libertariens américains, les adolescents millénaristes, le « Nord », comme réalité, comme idée, comme « image »). Ses quelques films m’indiquent, en en faisant remonter des morceaux choisis, de loin en loin, ce bourdonnement infini et tremblant de millions d’heures de choses banales, sublimes et effroyables qui sont devenus le sous-sol de notre culture commune, un mode d’existence anarchique de notre être-ensemble virtuel et commun. Du coup, depuis des années, il réalise des films en ne tournant aucune image et en allant les pêcher sur YouTube, pour l’essentiel 12 . Il fait ses films avec une farouche liberté, en dehors de bien des diktats en place, en toute insouciance aussi, en toute innocence peut-être, avec finalement très peu de subventions, avec à peu près aucun enjeu commercial associé à ces œuvres et s’il a atteint une reconnaissance ces dernières années, ce n’est pas grâce au sombre succès de scandale d’of the North qu’il l’a obtenu. Son corpus d’œuvres, depuis Beluga Crash Blues et jusqu’à sa tétralogie du Web (RIP in Pieces America, Pieces and Love All to Hell, Big Kiss Goodnight, Hoax_Canular), en passant par des curiosités comme Du moteur à explosion, Data, Blockbuster History, ISO 2000, Le spectacle de la société, témoignent d’une attention singulière au monde actuel et qui a trouvé son prolongement sur le Web et les réseaux dits sociaux. C’est le chantier, l’objet infini de Dominic Gagnon, cette improprement nommée « archive » colossale et terrifiante d’images prises par des gens ordinaires, mais aussi des corporations, des cartels, des industries d’exploitation, etc. C’est son problème et sa question. Son beau souci. À ce souci s’ajoute celui, omniprésent dans le travail de Gagnon, il me semble depuis le début, de disparaître. Quand il filme les estivants insouciants de La ronde (Beluga Crash Blues) ou les voyageurs anxieux des terminaux des aéroports du monde entier (Du moteur à explosion), il ne leur demande pas leur avis, et surtout, il ne veut pas être vu : disparaître de la vue de ceux qu’il filme, de capter à leur insu, une espèce d’inquiétude hallucinée sur l’état du monde. Data est aussi un film sur la puissance de résistance de l’anonymat, une résistance désubjectivée et arrachée aux sujétions métaphysiques ou institutionnelles classiques : c’est une force qui bruit et contamine en douce l’ordre des choses. Et quand il récupère et remonte des images réalisées pour le Web, dans son anonyme navigation, il ne cherche pas autre chose (le boulot n’est qu’en apparence plus facile). C’est en cela le « filmeur » le plus discret qui soit 13 .
La réalisation d’of the North a été initiée il y a quelques années après les annonces concernant cet infâme Plan Nord et la pluie de discours de circonstances concernant les retombées jovialement positives pour les populations de l’arctique qui se trouvaient, en réalité, et à bien des égards, instrumentalisées et en même temps spoliées au nom du développement minier. On trouvait, encore une fois, une poignée d’individus à cravate qui parlaient de façon toujours aussi bienveillante à propos et au nom d’un peuple qui lui était tenu coi, au fond de l’image et qui finirait, d’une manière ou d’une autre, se disait-on, par être victimes de ces tractations (sans nier que des organisations locales se battent pour faire reconnaître les droits de ces peuples, qu’une résistance existe, que ce n’est pas passivement que ces choses se font). Mais bien souvent, une image folklorique, désertique et pacifiée du Nord se superpose à un projet d’exploitation économique aux conséquences dramatiques, l’une comme l’autre gommant des tragiques réalités dont on ne daigne réellement parler (toxicomanie, alcoolisme, suicide, exploitation sexuelle, violence, enlèvements). Et c’est donc comme quantité de gens écoutant quelque peu révolté et cynique cette mascarade que Gagnon s’est mis à glaner le Web —après tout, c’est ce qu’il fait — pour voir s’il pouvait syntoniser quelque chose comme une image ou une parole différente qui émanerait non des politiciens, ni mêmes des représentants officiels de ces peuples (artistes, intellectuels, représentants des premières nations), mais du « monde ordinaire », les sans-voix, les sans-part, les « locuteurs non autorisés » comme Rancière les appelle, pour voir ce qu’ils avaient à « dire » et ce qu’ils montraient : quelles images ils projetaient d’eux-mêmes (tout en sachant que le filmé n’est souvent pas le filmeur et que quantité des images qui se trouvent dans ce film sont tournés par des blancs et à des fins très diverses). Pour comprendre ? Non, j’imagine, simplement pour voir (c’est la fiction que je m’invente). Pour questionner sa propre méconnaissance — peut-être, je spécule, je n’étais pas dans sa tête — et aussi pour prendre frontalement l’épineuse question de la représentation des Inuits, les stéréotypes qui lui sont chevillés et la lancer — comme un défi, une provocation, un malaise — à la face d’un public éventuel, oui, sûrement, il faut bien le dire, et il le sait, composé essentiellement de blancs qui se trouvent, plus souvent qu’autrement, dans la même position que lui, et aucunement confortable dans cette position.
Je n’arrive pas à répondre, pour ma part, à la question, bien qu’elle soit déterminante, qui m’a été souvent posée, une question peut-être insoluble, à savoir comment, dans l’esprit de Gagnon, ce film pouvait, aurait pu ou aurait dû être reçu par les communautés Inuits représentées dans son film ? S’est-il même posé la question ? Aurait-il dû se la poser et comme n’importe quel documentariste exposant des réalités sensibles, éprouver l’obligation morale de montrer ce qu’il a filmé aux gens qu’il a filmés (c’est le feedback des filmés institutionnalisé entre autres par Jean Rouch) ? Le fait est, bien sûr, qu’il n’a pas filmé ces images. Ces images se sont retrouvées, en accès libre, sur YouTube. Il ne fait que proposer une sorte de mash-up, subjectif et assumé. Est-ce donc à tous les gens filmés et à tous les filmeurs qu’il aurait dû demander ce qu’ils pensaient de son film ? Peut-être, mais on voit bien le vertige sans fin. Aurait-il pu bénéficier des conseils de certains membres de la communauté ou de personnes ayant vécu ou filmé dans le Nord, qui lui auraient tout de suite indiqué les zones périlleuses dans lesquelles il s’aventurait, pointé des raccords qui choqueraient, blesseraient, des images peu reluisantes qu’il aurait gagné à retirer (des pratiques de chasses non respectueuses des traditions, une accumulation de plans jackass qui peuvent donner une image négative, le montage perçu comme scandaleux entre une découpe traditionnelle de baleine et un type qui vomit, etc.) ? Peut-être, sûrement. Aurait-il concédé à faire ces coupes pour ajuster son film à la sensibilité, à la connaissance et l’intelligence de certains ? Je ne sais pas, je pense que non. Est-ce que ça aurait été le même film ? Assurément pas. Est-ce que son projet était de réaliser un film correct et acceptable par tous sur le Nord ? Je ne pense pas. Voulait-il par contre dénigrer, blesser, se moquer ? Je ne crois pas. Est-ce que ces quelques plans « problématiques » devraient invalider et obscurcir le réel geste politique du film ? Pensait-il, espérait-il que le spectateur éventuel de son film, qu’il soit autochtone ou non autochtone, serait en mesure de faire la part des choses, de saisir le déploiement critique et ironique qui est au cœur de son projet, de prendre la mesure du travail qu’il a opéré sur cette masse d’image ? Je crois. S’est-il trompé ? Probablement, oui. Car on sait, on voit le résultat. Bref, il y a un gouffre là et il mérite qu’on s’y plonge, en se posant toutes ces questions, ne fut-ce qu’à nous-mêmes, car cela permet de mettre en scène les problèmes féconds que pose le film.
On le sait, pour ceux qui ont vu le film, en piochant le Web, Gagnon a trouvé quantité de choses. 500 heures collectées dans cette mine d’or sombre : des images de chasses, des plans sur des bébés qui rient en se faisant prendre en photo, des ados qui dansent ou qui font des culbutes, des tours de magie, des fêtes, souvent excessives, des types qui vomissent, se trainent, sont frappés d’une stupeur ethylique, des images d’incendies, des courses à ski-doo, des performances musicales, des animaux marins, des paysages splendides, une image souvent léchée de développement industriel, de machinerie lourde, des serveurs informatiques, des avions qui décollent ou atterrissent, des gros russes se trempant dans une eau glaciale, des plateformes de forage anonymes, des chiens qui aboient, l’ordinaire, tantôt apocalyptique, tantôt sublime, d’une vie visiblement mutilée, soumise aux rudesses du climat, aux brutalités de l’exclusion, tout un monde qui se donne à voir à travers des fragments forcément ambigus, arrachés à leur contexte, épinglés au fil du temps, comme un enchaînement disparates de questions (pourquoi avoir filmé cela ?), de petites fenêtres entrouvertes sur une réalité dont l’essentiel, bien entendu, demeure hors de notre vue, de notre compréhension, de notre réalité.





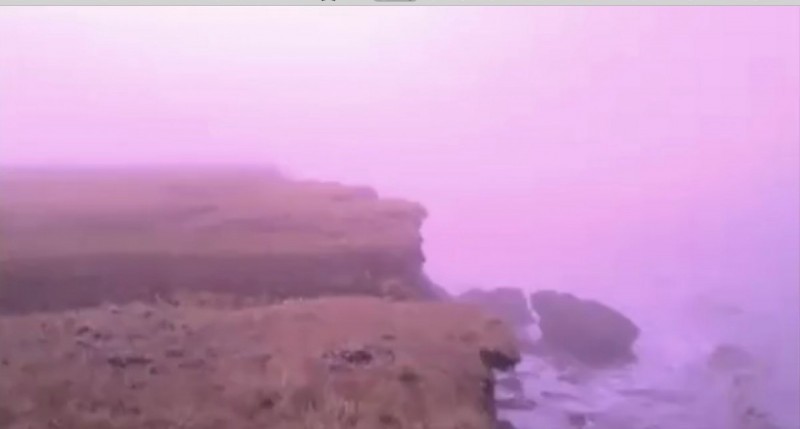

Une manière de penser ce film — on l’a entendu — serait de l’inscrire dans la veine des cinéastes qui ont cherché à déléguer les outils de la représentation : ce geste traverse l’histoire du cinéma documentaire ou militant (chez Marker dans les usines Renault, Godard avec les enfants ou au Mozambique, Rouch au Niger, et tant d’autres). L’idée est de simplement voir ce que l’Autre qu’on a marginalisé, dépossédé, réduit au silence, raconte sur lui même, sa vie, sa condition historique, si on lui donne simplement du temps, un peu d’écoute ou des moyens techniques (et des moyens de s’approprier la technique, donc de s’élever un peu au dessus de ses fonctions idéologiques). Cette saisie des outils de la représentation à travers les médias sociaux est devenu, aujourd’hui, la chose la plus simple du monde, que l’on soit à Auckland, à Damas ou Kuuijuaq. Le problème diront certaines critiques, c’est que cette « parole » du locuteur qu’on veut taire — si présente dans les autres films Web de Gagnon, n’est pas réellement entendue dans le film (ce n’est en tout cas pas la matériel qu’il a retenu. Il n’y a, en effet, pas de véritable discours tenu sur soi (de désir d’auto-représentation avoué), on ne voit qu’un simple enchainement d’images hétérogènes, muettes sur elles-mêmes pour ainsi dire. Mais il n’y a pas, pour autant, une absence de présence, de souffle, de voix. Car ce serait oublier le rôle des chants de gorge, dont le souffle puissant bat le rythme d’une bonne part du film (jusqu’à ce que certains de ces derniers aient été retirés) ; il y a aussi cette chanson, « Don’t call me Eskimo » 14 ), que l’on entend sur des plans de fête, avec des types accoutrés de tenues pneumatiques s’appropriant des clichés culturels pour mieux les renverser, et où l’on trouve, résumé, un certain esprit du film, la perfaite expression de ce « fuck you » que Gagnon a perçu au fil de ces images et auquel il a voulu associer son film. Entende qui voudra.
Il y a bien entendu une longue tradition de cinéastes autochtones qui ont généré une image complexe et différenciée de la réalité de leur peuple, y compris en prônant des formes d’auto-ethnographie (et peut-être que l’attention que nous portons au travail de Dominic Gagnon qui est né de cette polémique devrait attirer davantage notre attention sur cette production marginale, ce serait faire œuvre utile). Il y a également des cinéastes « blancs » qui ont côtoyé ces peuples de près, se sont frottés à cette réalité, et ont tenté de l’exposer délicatement et respectueusement (on pense bien sûr à des pionniers comme Arthur Lamothe, ou même Pierre Perrault, même si l’accueil de ses films a été bien plus mitigé). Bien entendu, Gagnon se défendra en disant : « bien sûr, ce travail existe, mais ce n’est pas ce que je fais. Moi je fais des films sur des gens qui se filment eux-mêmes, je travaille, je fais du cinéma à partir des images qu’ils ont décidé de capter et de partager. » C’est une autre forme d’écriture qu’il pratique, plus paresseuse, cynique, détachée, inconsciente ou pantouflarde pour certains ; fascinante, originale, révélatrice et riche pour d’autres, en nous donnant des accès privilégiés à un monde que nous entrevoyons comme à travers l’entrebâillure d’une porte : elle nous permet de fixer un abîme, un vertige. S’il n’a certes jamais respiré l’air du grand Nord, il a récupéré 500 heures de vidéos tournées sur plusieurs années, a travaillé pendant deux ans à son montage, a développé une étonnante familiarité avec ces images et les gens qui les ont téléversées. Il sait tracer des liens de famille entre toutes ces vidéos et les gens qui les ont prises, il reconnaît leurs voix, leur façon de cadrer, a suivi l’évolution d’une même pratique de capture d’image de divers filmeurs, sur près de dix ans, qui passe d’une génération à une autre (on croit reconnaître, d’un film à l’autre, et sans jamais le voir, la voix d’un même filmeur). Il a fini par bien connaître tous ces gens-là, à force, sans jamais les rencontrer, par leur pseudos sur Youtube, leurs goûts musicaux, leurs films préférés. Et même si on peut être persuadé du contraire selon la position dans laquelle on se campe, je crois pour ma part qu’il a développé une empathie, un sentiment de solidarité, une admiration pour ces gens — tout en comprenant —comment en serait-il autrement ! —,le gouffre qui sépare sa réalité de la leur, la différence fondamentale qui peut exister entre ses virées et les leurs, etc. Ce qu’il a voulu je crois transmettre, c’est aussi la force de résistance de certaines de ces images, non pas parce que c’est leur fonction, l’esprit dans lequel elles ont été tournées, mais c’est l’effet qu’elle génère. On y lit la démerde, l’autosuffisance, un certain « foutez nous la paix on sait ce qu’on fait ». Ces images semblent lancer un défi aux yeux de ceux qui pensent encore qu’il est possible de les déposséder silencieusement de tout. Là-dedans, sur cette multitude, il a fait des choix, il a bazardé 99% de ce qu’il a vu (des choses plus terribles et abjectes sûrement). Il a taillé, recomposé, assemblé, créé des rimes, des jeux de couleurs, des agencements rythmiques, a tenté, je le crois, de faire les choses respectueusement. Au fil des agencements et des assonances 15 , il a constitué des séries, qui, une fois montées à distance, créent des effets de sens, qu’on peut, qui ont fini par dériver dans tous les sens. Il y aurait la série industrie-exploitation, travail, fête/intoxication, enfants, partie de chasse, animaux, intimité/foyer, une série d’images « jackass », une série « avions », et ainsi de suite. Et le film est structuré à partir d’une alternance entre tous ces plans qui se répondent, s’appellent, se font écho, parfois s’ignorent.




De cette masse d’images il a amassées 50 vidéos trouvées sur Web (extraites, émondées à partir de ce roc de 500 heures). Il les a projetées dans une salle de cinéma. Ça donne un film brillant et mal foutu, tout croche, un film volontairement trash et ambigu, comme les images qu’il repique, qui fait grincer des dents, qui donne mal au cœur, qui prend au ventre, qui nous confronte peu importe la position où l’on se trouve, peu importe les images et la connaissance du territoire que nous possédons en nous. Un film qui est en même temps tressé de choses étonnantes et belles, hallucinées et vertigineuses (je pense à ce plan-séquence fou sur un groupe d’hommes, clairement intoxiqués et vacillant en déséquilibre sur leurs fauteuils, accompagné par le bourdonnement assourdissant des hélices d’un avion comme si ces hommes étaient en train de tournoyer dans un vortex). Tout cela, d’une certaine façon, vise à résister, à résister aux simplifications, résister aux préjugés, résister aux visions unilatérales, résister à une certaine représentation crispée, autorisée, officielle. Montrer des gens qui résistent par leur simple existence, malgré tous les assauts, et qui refusent de disparaître.



Je suis évidemment sensible – comment en serait-il autrement – à l’opinion de ces hommes et ces femmes Inuits ou issus d’autres communautés autochtones ou métis qui ont été profondément troublés par le film. Je crois avoir lu tous les textes, certains éclairants sur leur perception du film, leur point de vue et la réalité qu’ils vivent, leur combat quotidien contre les préjugés et les stéréotypes (je signale en particulier cette longue entrevue, déjà mentionnée avec [Alethea Arnaquq-Baril-> [url=http://artthreat.net/2015/12/alethea-arnaquq-baril/ ]]http://artthreat.net/2015/12/alethea-arnaquq-baril/][/url], d’une grande dignité malgré que, à mes yeux, elle ne parle pas du film ou refuse de voir autre chose que ce qui l’a hérissé). Qu’ils aient une relation particulière et privilégiée à ces images et à la réalité qu’elles dépeignent est évident et incontestable. Qu’ils aient été blessés en voyant des individus qu’ils connaissent dans des situations d’extrêmes vulnérabilité, dans une salle de cinéma où, pour toute sorte de raisons, certains pouvaient glousser de rire (un rire jaune sûrement, mais un rire quand même), est évidemment intolérable. Dans la foulée des commentaires qui ont été écrits pour défendre le film, il y a bien sûr tous ceux qui dressent en la critiquant l’image d’une réaction purement viscérale, irrationnelle et typiquement « féminine » au film, une position totalement paternaliste et indéfendable à bien des égards 16 http://hyenesenjupons.com/2016/01/28/of-the-south-une-critique-de-la-reception-quebecoise-de-of-the-north/][/url]. ]]. Bon nombre des oppositions au film venaient de personnes dont la crédibilité intellectuelle et le mérite artistique n’est pas questionnable et qui ont été tout à fait capable de « voir » le film jusqu’au bout et parler en connaissance de cause. Je ne peux toutefois me résoudre à reconnaître, dans les propos qu’ils ont tenus, le film que je suis certain d’avoir vu, pas plus que je ne peux accepter de porter le chapeau du colonisateur jouissant du spectacle exotisé de l’Autre que l’on veut me faire porter. Et bien que je puisse tout à fait comprendre qu’on puisse finir par ne voir et ne retenir que ces images les plus difficiles, tant ces images précises peuvent choquer, se cristalliser dans notre mémoire, je n’arrive toujours pas à me résoudre à accepter une description du film voulant qu’il ne s’agisse que d’un simple défilé écervelé et irresponsable d’Inuits saouls et d’images pornographiques de femmes exhibées. Le film est fait de tant d’autres choses qui ont été systématiquement tues, chacune de ces images s’inscrit dans un tissu de relations complexes, enchassées dans un projet général dont il faut tenir compte et qu’il faut, à mon avis, être en mesure de déceler.
Mais on voit bien — et tous les lecteurs qui ont tenté de discuter du film savent peut-être quelque chose du tourbillon qui s’ensuit — que les problèmes ne font que débuter. Si on parle avec quelqu’un qui s’oppose au film et qui nous parle de ces plans « difficiles », on se prend — comme l’auteur, poussé dans un coin — à devoir compter : oui, c’est vrai qu’on voit des gars ivres, oui, on voit des images issues de sites pornos, mais tu sais, il n’y a, en réalité, moins que dix vidéos où l’on voit des personnes totalement saoules, et que deux vidéos « pornographiques ». On nous dira : oui, mais à quoi bon ? On répondra : ok, prenons les vidéos issues de site porno, la première vidéo nous montre un redneck d’Anaheim tenant sur ses genoux ce qu’il nous présente comme une « real live honest to god Eskimo » qui, à la question dégradante du type (faut lui voir la tête), « What does it feel like growing up in Alaska ? » répond bonnement et angéliquement : « It feels just like for any other race ».


En regardant cette vidéo, plantée dans ce film, on peut évidemment décider — c’est ce qu’on a entendu — que Gagnon n’est au fond pas mieux que le redneck (ou le redneck qu’on soupçonne qui le filme), qu’il pense comme lui, qu’il a décidé d’exposer le corps nu de la femme Inuit pour en faire un trophée exactement comme le débile dans le film (et en jouit) ; ou bien on peut décider de voir que, même dans ce contexte avilissant une femme est capable de dire : « on est pareil comme vous (pauvre con) », et c’est peut-être cela qui est fascinant. Cette vidéo existe (quelque part, dans la poubelle la plus profonde et inavouable du Web) et expose la ténacité révoltante des préjugés, la violence de l’exploitation sexuelle (du moins pour n’importe quelle personne sensée qui regarde ce film et est heurté par cette image et à toute la réalité à laquelle cette vidéo renvoie). Il nous rappelle que « c’est vraiment possible une telle merde », cette mise en tutelle douloureuse de corps exotisés, encore, toujours, aujourd’hui. L’image gêne. Absolument. Mais elle joue exactement le rôle contraire qu’on lui prête. On m’objectera : Mais est-ce parce qu’elle existe qu’il faut la montrer, à quoi sert-elle, là, ici, dans ce film ? je dirais qu’elle précise, justement, ce que l’on pourrait appeler un motif du film : celui des stéréotypes et de l’exploitation que veut montrer et « discuter » le cinéaste (j’interprète, peut-être trop, je me parle tout seul après tout). Certes, me dira-t-on, mais il enchaîne aussitôt après avec une vidéo montrant un Inuit saoul dont le quatre roues s’est retrouvé dans le fossé et qui tente de fuir (pas très certain dans cette vidéo s’il tente de fuir la scène de l’accident ou s’il cherchait à fuir une autre situation avant de se retrouver dans le fossé, mais cette scène, pour ma part, je la trouve absolument puissante, très cinématographique, avec les mouches qui volent, les gamins qui se pressent autour du type qui ne cesse de s’excuser en souriant). D’aucuns diront : ce que Gagnon nous dit, alors, c’est : voici, en fait, leur « réalité », des gars saouls qui foncent en plein jour dans des fossés. Oui, mais certains autres diront que le même plan peut être pris totalement à rebours : voici le préjugé du Sud envers le Nord qui est montré : ce sont tous des gars saouls sur leur quatre roues et l’enchaînement de ces deux plans permet de mettre en scène et de travailler le stéréotype, voire de le déboulonner. Really, de quelle façon ? En le nommant, en en proposant non une image juste, juste une image. Mais que peut bien être ce « juste une image » dans un contexte où cette même image est un champ libre, totalement vacant aux interprétations les plus variées, paranoïaques ou justificatrices à tout prix ? Je répondrai, tout cela tient par la matière proprement cinématographique de tous ces plans, etc. C’est peut-être au final ce vertige de l’interprétation que le film ouvre qui trouble, qui libère les dissensions et les clivages… et qui ouvre un gouffre, un trou noir. Je ne suis pas seul à penser que ce trou noir est salutaire.
Pour chaque plan ou image discutable (et il y en a), dans ma tête ou avec d’autres, se poursuivent ainsi les discussions. Il en va de même de ce plan (souvent cité), sur fond de music techno et de cris de foule provenant d’une scène de danse précédente (et qui crée le liant de la séquence), du corps nu d’une femme (on ne voit jamais la tête de cette femme, que le bas de son corps et elle exhibe un sexe ouvert à la caméra, sans doute un simple téléphone filmant le corps de travers). À ce plan est accolé un gros plan sur la queue d’un chien dont on taille les poils. On filme un chat se cachant derrière une poubelle. Un homme (qui tient la caméra peut-être), éructe un : « you bitch » 17 . Bien sûr tout cela peut être lu comme un enchaînement douteux, une métaphore visuelle : un raccord bête entre des poils pubiens et les poils d’un animal, un mot lancé qui se télescope violemment avec la scène précédente et vient s’accoler au corps d’une femme qui n’a sûrement pas demandé à se retrouver là. Tout cela — ce choix, ce raccord —, selon la manière qu’on décide de l’aborder, peut devenir indéfendable (et pourquoi, d’ailleurs au nom de quoi le défendrait-on à tout prix, ce n’est pas ce que je cherche à faire d’ailleurs). Est-ce que tout cela repose sur un jeu d’esprit, un montage choc des « attractions » ? Peut-être y a-t-il de cela, une volonté de heurter le bourgeois, un plaisir de transgression, de lui en mettre plein la vue, in your face ? Bien entendu, on peut décider d’y voir tout cela et de penser que le type aux commandes est un malade (personnellement, je ne m’y résous pas).
Car je ne crois pas être le seul a avoir vu ce film et, en me souvenant de ce plan, me souvenir d’avoir immédiatement pensé : L’origine du monde. Au-delà du « sujet » (n’importe quel film porno pourrait en dire autant), cette vidéo en effet possède les tons, la palette, la plasticité sombre, le cadrage, la mise en scène de la toile de Courbet, et il est à peu près impossible que le cinéaste n’ait pas été sensible à cette variation obscène du tableau. Soudain, là, dans la poubelle la plus profonde du Web, trouver un Courbet. Que faire. S’en servir, bien sûr. Lui trouver une place. Le placer justement là, au milieu d’un capharnaüm grotesque de beat et de cris, pour que en même temps, cette chose si belle, si fascinante en soi, si scanadaleuse en même temps, grince de toutes parts, parce que le Web — pas juste les images qui ont été tournées dans le Nord — est aussi fait de telles choses : des mecs qui filment leur travail (ici un type qui remplit une piscine), des accidents, des images porno, des vidéos d’animaux, des tempêtes, des vues sur l’intimité, un type qui taille la queue de son chien, et qu’il peut être juste de les penser ensemble. Cette image se trouve donc aux côtés d’une série d’images qu’on gagne alors à penser non par association mais dans le temps, dans la simultanéité radicale qui est aussi celle de Youtube (1 – 1 – 1 – 1). Pendant qu’une plateforme brille de ses feux, un avion atterrit, un jeune homme participe à un concours de talent, un homme remplit une piscine dans un centre sportif, à côté, une femme qui montre son sexe, et aussi un type qui trime la queue de son chien. Ces choses arrivent en même temps. Le tout est une affaire quotidienne. Mais la vie continue et il y a un chat qui fait du beatboxing 18 .







Ce film est un collage, fait de ressemblances qui crient, fait d’énigmes, de plans obtus, obstinés, destinés à troubler la toile rassurante du visible — je pense à ces plans affreux d’animaux tués, ou morts empoisonnés, qui pullulent dans le film à un moment. Cette accumulation rêche d’images finit, à force, par secouer — je ne parle pas que pour moi — l’indolence ou l’indifférence qui nous menace toujours dans nos certitudes. Ce film aura peut-être eu, chez certains, un effet de décillement, aura été capable d’ébranler positivement et durablement la perception du Nord, non parce que, comme je le disais, il viendrait renforcer ou confirmer des préjugés (ce serait, je le redis, à mes yeux parfaitement ridicule), mais au contraire, parce qu’il nous amène à les confronter, à les travailler, à les essaimer à travers une multitudes d’autres images. À imaginer, simplement.
Je crois dès lors que tout effort pour tenter de formuler un point de vue articulé et autorisé sur la question et dans la mesure où il est capable de s’appuyer sur le film pour en parler est légitime. En cela, je pense que le film devrait être montré, qu’on ne devrait pas en interdire les projections car cela à l’effet, à rebours, de le sacraliser, à la fois l’œuvre et son cinéaste, en entraînant ses détracteurs à porter l’odieux du blâme. De la même manière, aucune interprétation ne devrait, il me semble, s’arroger une préséance absolutiste sur toutes les autres lectures possibles du film (au nom d’un privilège identitaire inversé, finalement parfaitement délètère et stérile). Il ne faudrait pas, de même, être insensible à toutes les voix discordantes, issues des communautés elles-mêmes[[ Je me permets de rapporter ici quelques commentaires d’individus qui, il faut bien le dire, n’ont pas vu le film, réagissent à un article de la CBC traitant, au mois de novembre, de la controverse. Les propos tenus m’ont semblé intéressant à incorporer à la réflexion et dans la mesure où ils n’ont pas circulé largement (ils ont d’ailleurs été rapidement retirés du fil de discussion), je me suis autorisé à les reproduire ici :
- Posted by science on November 25, 2015
There is no moral obligation to depict Inuit life in any way – choosing only clips that Tagaq considers to be disparaging is not necessarily one-sided. Asking individuals to submit to censorship for fear of being labelled culturally insensitive is totalitarian. Without having seen the entirety of the film, it is difficult to make a judgement call, however, considering it is made up of found YouTube footage, is the implication that editing this footage together is a racist act contributing to a racist film?
- Posted by No Moniker on November 26, 2015
I’m with the apologists for the film maker, inasmuch as this is a discussion about the merit of the work, not the copyright infringement. I don’t see how the film is racist or disparaging from the clip, but as others have said you’d really need to see the whole film to judge. But, lets consider a counter narrative. It might not be flattering, it might not be the sanitized or romantic version of the north you’d like to project into the world. It might not be Inuit at their best, it might even be Inuit at their worst. But can you deny that it is authentic? That alone makes it a kind of art in my mind. Screaming “racist” every time some one shows you something you don’t like bout yourself is disingenuous. And, in my opinion a little juvenile.
- Posted by Inuk in Nunavut on November 26, 2015
Is she also deeply offended by the drunk Inuit in the film? I am sorry but these are people who exist among us – our family and friends. Maybe she is correct in that her permission was not granted for the use in this film, but as an Inuk I am deeply offended that she is deeply offended by the people in this film. This is a reality that maybe she wants swept under a rug? When all is said and done these people will still be doing the same things. She does not have to the right to tell me and to tell you what I can or cannot watch. If she succeeds in suppressing this work of art, you and I will never be able to watch it for ourselves and make up our own minds. She is going too far. and what she wants amounts to authoritarian bullying. Are you not interested in seeing for yourself so you can make up your own mind? She wants to take that right away from you. ]], ni de gens qui ont côtoyé le Nord de près et qui s’inquiètent, eux aussi, de la censure que subit ce film 19 .
Je pense qu’il est des plus nécessaire et salutaire de ne pas finir de parler de ce film, de permettre à toutes les voix de continuer à faire entendre leur rumeur, mais tout en ne perdant pas de vue l’objet dont on prétend parler. Ce sera en attendant de pouvoir voir un Goin’ South (perdre le Nord), des nouvelles itérations d’of the North, des films sur l’Est et l’Ouest qui se trament et qui déploieront d’autres cartes, qui indiqueront d’autres territoires, d’autres positions, d’autres pays où le cinéma essaie de se donner le droit, tant bien que mal, d’habiter, librement.



Notes
- Simon Galiero, « Un peu à l’Ouest », Panorama-cinéma, mars 2016, http://www.panorama-cinema.com/V2/article.php?categorie=9&id=436 ↩
- Dans sa première version, le son est recouvert par le puissant chant de gorge de Tanya Tagaq, chant qui a été retiré dans les dernières itérations, pour ne laisser qu’un long et froid silence sur des images muettes. ↩
- Pour ma part, suivant l’adage de l’ami Bordeleau, je pense qu’il faut toujours se méfier des critiques qui présupposent le pire de qui écrit, lit, regarde, entend. ↩
- Il serait intéressant de se demander de quelle façon, par cette posture, Dominic Gagnon tout à la fois réinvestit et renverse le personnage daté du armchair ethnographer. ↩
- La réponse incongrue fournie par le cinéaste à cette remarque concernant son « white privilege » montre à quel point c’est une question qui lui échappe complètement (« I don’t get that, I’m not rich) et que ces hiatus terminologiques aient pu joué un rôle dans le braquage des positions. Cela montre aussi qu’une formulation anglosaxonne issue pour l’essentiel des cultural studies, bien aguerrie sur ces enjeux de « politiques de la représentation » ou de pouvoirs identitaires, ne résonne pas du tout avec la même « évidence » auprès d’un francophone moins au fait de l’usage particulier, pour ne pas dire la torsion particulière de ces termes en anglais (on pourrait ajouter au lot des expressions comme « revisionist history » ou encore « white suprematist »). ↩
- Je me permets d’ajouter une objection qui m’a été faite sur ce point et que je crois nécessaire : “cette caractérisation des membres des deux camps en factions égales (et également enclines aux dérives), opère quand même un nivèlement trompeur, comme s’il n’y avait que des différences de regards et pas de positions du regard”. S’il fallait en effet caractériser plus en détail ceux qui s’opposent au film, on trouverait une grande majorité de personnes issues des communautés autochtones, des intellectuels qui ont une excellente connaissance du Nord, ou encore de cinéastes ayant travaillé auprès de ces communautés. Si on peut soutenir que toute personne peut avoir une vision éclairée des enjeux de la représentation, une expérience personnelle du film avec un point de vue valable sans connaissance étendue de la réalité en cause, on ne peut pas dire non plus que les autres, ceux qui ont une relation privilégiée avec cette réalité, ne seraient pas aussi en mesure de percevoir et d’intellectualiser les enjeux de la représentation et de réfléchir au cinéma. Si des points de vue valables sur le cinéma peuvent venir des deux côtés, on peut supputer — et chaque lecteur en fera ce qu’il en voudra —que dans la majorité des cas, ceux qui ont un lien de proximité avec la réalité représentée sont presque exclusivement du même côté et sont opposés au film, ou du moins, ne lui trouveraient aucun intérêt. Si je ne conteste pas cette affirmation (que j’ai pu moi-même vérifier à diverses reprises), je demeure néanmoins prudent sur la généralisation qu’elle implique (je n’ai pas fait d’enquête étendue sur la chose), et, surtout, je reste malgré tout troublé par la manière et le ton souvent condescendant qui s’est exprimé chez ces critiques, ainsi que par la lecture extrêmement sélective qui caractérise leur description du film. La question, pour moi, n’est pas de leur enlever le droit d’exprimer leurs réserves, voire leurs remontrances au sujet du film, mais j’aurais voulu — et le cinéaste en aurait sans doute bénéficié — qu’ils le fassent en parlant du film lui-même, et non, comme ce fut souvent le cas, sur la seule base de leur expérience douloureuse, pénible, traumatisante du film qui, du coup, comme un argument d’autorité supérieur et indiscutable, devrait suffire à le disqualifier sans procès. ↩
- Je pense pour ma part, sans chercher à l’excuser, que ces dernières devraient aussi être replacés dans les situations extrêmement tendues où le cinéaste se voyait ouvertement accusé de racisme, de « suprématisme blanc », qu’il répondait à chaud et piqué au plus vif dans son travail et ses visées qu’il pensait seraient bien comprises, piégé par des questions, il faut bien le dire, souvent insidieuses des intervieweurs qui le prenaient de haut. ↩
- Dans l’entrevue précédemment cité, on peut lire la chose suivante, qui éclaire en bonne partie les principes de son montage : « Je trouve beaucoup de vidéos de gars à la chasse à la baleine, qui tuent des phoques à coups de poing, chauds raides sur la banquise, des partys de danse, des points de vue subjectifs de danses dans des arénas, des batailles sur la patinoire, des courses de ski doo, etc. Il y a beaucoup de mouvement. J’aime ça parce que c’est plus vivant. Dans la « trilogie » c’est seulement du monde qui parle. Tandis que là, plus personne ne parle. Il y a beaucoup de mouvement, beaucoup de musique : c’est très cinématographique. […] On est retombé avec mes premières amours. Les mouvements, la caméra, tout ce qui fait le cinéma. Quand je regarde mon dernier montage et que je regarde la trilogie, je me dis que ça a bien plus à voir avec l’art vidéo que le cinéma, parce que ça parle, c’est fixe, et statique. Maintenant, j’ai vraiment l’impression de retomber dans l’image, ça fait du bien ! Juste à cause que [sic] le jeu qu’on propose aux gens est différent et que la technologie ne cesse d’évoluer. » (Ibid. ↩
- « I was looking at YouTube clips uploaded by Inuit after I watched this film, just to see how quickly a clip of a drunken Inuk came up, and I couldn’t find one. I just started scrolling through clips and I couldn’t find one. This guy had to really search out clips of drunken Inuit. It’s as if he went searching for clips of “drunk Inuit” or “drunk Eskimo.” This is a decision he made to portray us this way. He went in with his own perception; it’s not a reflection of how Inuit perceive ourselves. It’s not a perception of how I see myself, that’s for damn sure. » (« Curating the North : Documentary Screening Ethics and Inuit Representation in (Festival) Cinema », Art Threat, 17 décembre 2015. ↩
- L’ironie a voulu que la projection du 19 février au Belgo s’est déroulée à quelques centaines de mètres de la performance que livrait, au même moment, Tanya Tagaq et ses musiciens sur les images de Nanook of the North, participant d’un geste de réappropriation culturelle, de renversement de lecture du film. Bien sûr, il n’a échappé à personne que le titre of the North (avec le « o » en minuscule) s’approprie aussi le film de Flaherty là encore, mais par une opération qu’on a été nombreux à lui refuser, en cherchant à renverser et à redonner la « parole » et les armes de la représentation à ceux que Nanook of the North, en 1922, très certainement, instrumentalisait et exotisait. ↩
- Je tiens d’ailleurs à remercier plusieurs personnes qui m’ont confié leurs impressions sur le film ou qui ont lu des versions préliminaires de ce texte et dont les remarques et commentaires se sont trouvées intégrées à son argument. Merci à Élène Tremblay, Erik Bordeleau, Dolorès Parenteau-Rodriguez, Michèle Garneau, Renaud Desprès-Larose. Merci aussi à Nicolas Renaud, avec qui j’ai eu les discussions les plus vives à ce propos (et dont la voix adverse est partout présente dans ce texte), qui m’a aiguillé sur des points essentiels et m’a aidé à cheminer dans ma lecture du film. Merci enfin à Dominic Gagnon pour les éclairages, l’ouverture et la ténacité. ↩
- Il est bien sûr loin d’être le premier à œuvrer de la sorte. Mentionnons seulement au passage certains films récents de James Benning, les films du collectif Neozoon, etc. ↩
- En entrevue, et la remarque pourrait aussi en faire pouffer plus d’un, il se revendiquait volontiers d’une tradition issue du cinéma direct où il s’agissait, entre autre chose, de parvenir à capter une réalité en s’absentant du processus de capture. Accepte qui voudra. ↩
- On trouvera ici la version complète de la vidéo, qui mérite d’être vue. ↩
- Comme on me le faisait remarquer, un des problèmes serait justement que ces assonances sont trop souvent uniquement visuelles et tendent ainsi à laisser à la dérive la logique du signifiant : on a cité, par exemple, ces plans où on lie le mouvement des mains d’un homme sous l’influence du « crack » avec le mouvement des mains des enfants. Cet agencement d’images devient interprétable en tout sens. Si, comme ailleurs, on le considère comme un montage associatif, la chose peut être délicate et tendancieuse. Si on le prend comme un simple enchaînement rythmique, sans intention discursive, la coupe est parfaitement innocente, même poétique et belle. Le sens est, encore ici, dans la perspective et les intentions qu’on lui prête. ↩
- On lira sur ce point ce papier polémique concernant la réception critique du film, [of the South : Une critique de la réception québécoise de of the North-> [url=http://hyenesenjupons.com/2016/01/28/of-the-south-une-critique-de-la-reception-quebecoise-de-of-the-north/ ↩
- Un autre enchaînement langagier tout aussi irritant, a lieu un peu plus tôt dans le film, où on raccorde un plan, filmé de loin, où l’on voit un homme en train de pourchasser et de tabasser à coup de poing un phoque, provoquant l’hilarité odieuse du filmeur, et une autre vidéo, où l’on retrouve un gamin de deux ans, assis sur la toilette, qui lance un « Fuck », aussitôt réprimandé joyeusement par son père qui le filme en riant : « Don’t say that ». Un jeu de langage, juste une image, une façon de faire tenir ensemble deux plans terriblement disparates autour d’un son, d’une image. On peut aussi décider de n’y voir que ça ↩
- Je reprends ici un peu textuellement quelques phrases que Gagnon m’a envoyées quand je l’ai interrogé à propos de cette scène. Je me suis permis de me les approprier. Il m’en excusera. ↩
- Je signale ce texte récent, très sensible, sur le blogue de Carolyn Marie Souaid, ainsi que la lettre ouverte, qui vient de paraître au moment où je finissais ce texte, dénonçant la censure du film et où, parmi les signataires, se trouvent des cinéastes qui ont connu de près les communautés autochtones. ↩
