L’histoire d’un leurre
Difficile de penser meilleur titre pour le dernier film de David Cronenberg que A History of Violence : sa polysémie permet en effet de recomposer toutes les ramifications de ce film magistral, tout en rappelant l’une des trames singulières qui sillonne l’ensemble de son œuvre. Car chacun des films de Cronenberg décline, on serait amené à dire, une histoire de violence, ou, plus exactement, propose une variation sur le thème de la violence. Violence ludique mise en jeu dans eXistenZ ; violence du devenir-autre d’un corps, d’une chair, tantôt par hybridation (les corps-machines de Crash et de Videodrome, le corps-insecte de The Fly), tantôt par contamination infectieuse ou parasitaire (Rabid, Shivers) ; violence opératique et sentimentale dans M Butterfly ; violence – d’où il tire sa puissance – de l’imaginaire dans Naked Lunch. Le trauma identitaire de Spider prend racine dans une scène de meurtre indépassable et la violence de la séparation des jumeaux – « deux corps se déchirent » – est au cœur de la crise du « moi » de Dead Ringers. Cronenberg est également celui qui n’a cessé de montrer la violence inscrite dans les rapports sexuels, la violence d’exister dans une chair. Tout ceci ne fait pas de A History of Violence une somme cronenbergienne, comme pouvait l’être jusqu’à un certain degré eXistenZ (bien que ce type de constat paraisse à la longue assommant), mais plutôt comme la tentative la plus aboutie d’aborder de façon frontale – et donc tentaculaire – le problème de la violence, de son histoire et de ses figures archétypales. Si ce film offre un « détour » réflexif, c’est peut-être alors moins à l’œuvre de son auteur, qu’à cette question – qui a toujours intéressé le cinéma – et sa prégnance dans la société et la culture américaine.
Dans A History of Violence Cronenberg reprise un ensemble de figures et de trames narratives classiques, notamment du Western 1 et du Film noir (on pense à Bend of the River, Man From Laramie, The Man who Shot Liberty Valence, Big Heat, Naked Kiss, et quelques autres), en y intégrant un questionnement sur la nature de la violence qui imprègne l’histoire américaine (et toutes les nations, si on suit le cinéaste). Le film devient alors, à plus d’un titre, une méta-histoire de la violence, de ses représentations filmiques et du rôle qu’elle joue dans l’imaginaire, états-unien tout particulièrement. De la même manière qu’il analysait le fétichisme automobile et l’érotisation morbide du corps-machine dans Crash, un phénomène profondément enraciné culturellement (on se rappellera que Vaughan rejouait les grands accidents automobiles de l’histoire, celui de James Dean, de Jayne Mansfield), de la même manière Cronenberg propose ici une anatomie, sereine et sublime, de deux figures fondatrices de cette culture et de son histoire : le justicier (celui qui ne peut se fier aux lois pour garantir l’exercice de la justice, qui écrit lui-même une loi que la raison juste reconnaîtra) et l’homme rattrapé par son passé (celui qui a tout fait pour repartir à zéro, pour oublier, et qui doit confronter celui qu’il fut). Ces deux archétypes – au fondement de l’idéologie américaine – sont fondus ici en un seul personnage, celui de Tom Stall (Viggo Morgenstern), ordinary man par excellence : bon mari et père de deux « magnifiques » enfants, gérant d’un diner de la localité fictive de Millbrook, Indiana (le film fut en réalité tourné à Millbrook, en Ontario).

Dans le film, le justicier malgré lui qu’incarne Stall, une fois transformé en héros médiatique en abattant deux types horribles venus cambrioler son commerce, se trouve confronté par une bande de malfrats menée par Carl Fogaty ( Ed Harris) qui ont des comptes à régler avec Joey Cusack (alias Tom Stall), frère de Rickie Cusack (William Hurt, dans un sublime contre-emploi), chef d’un groupe de crime organisé. L’histoire (qui est celle de la violence de Cusack) veut que Joey ait défiguré Fogaty (membre d’un gang rival), avant de se terrer trois ans dans le désert et de réapparaître sous le nom de Tom Stall (celui qui, suivant l’onomastique, a été mis à l’arrêt, who has been stalled). Lorsque la bande décide de tourmenter sa famille, Cusack/Stall doit – pour parvenir à s’en débarrasser – tour à tour abattre les membres du gang, puis filer vers Philadelphie pour régulariser sa situation. En cours de route, il devra éliminer son frère et ses garde du corps, avant de pouvoir retrouver le nid familial, à la toute fin du film : il est certes devenu justicier (il a tué les bad men) mais n’est-ce pas en se montrant lui-même comme le bad man qu’il fut ? En effet, si l’on décline une nouvelle fois le titre du film, on peut dire que Joey Cusack possède a history of violence (comme en témoigne le visage de Fogaty dont l’œil a été arraché à l’aide d’un cintre métallique).
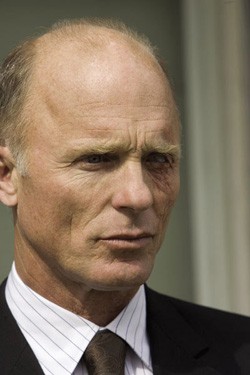
Fogaty (Ed Harris)
Dans une « autre vie », Joey prenait du plaisir à tuer, à massacrer : un lourd dossier pèse sur lui, même si nous n’en saurons que très peu sur ses activités. Afin d’empêcher ce passé de remonter et que soit compromise la vie quiète qu’il s’est démené à bâtir, Tom doit se caler, pendant 48 heures, dans le personnage de Joey, retirer son masque (à moins qu’il ne s’agisse de s’en affubler d’un). Il doit éliminer tous ceux qui veulent l’éliminer et troubler sa quiétude, renouer avec son passé violent pour mieux tenter de l’enterrer et ré-imperméabiliser son foyer. Au bout de l’exercice, Tom sera redevenu Joey, sans que Joey, rentré à la maison, à qui l’on tend timidement une assiette et un morceau de roast, sans que ce dernier ne parvienne à redonner pleinement corps à Tom, sans que le masque ne puisse tenir aux yeux de personne, ni du spectateur. Le visage fragilisé de Tom/Joey, que Cronenberg maintient pendant un long moment au dernier plan du film, nous lance une question morale : celui qui a rebâti sa vie et a fait disparaître tous les criminels malicieux qui voulaient lui faire du tort en lui rappelant son passé, est-il un justicier ou un criminel, un père de famille responsable (« I’ll settle this » dit-il en sortant) ou un meurtrier non repenti ? Ne faisait-il pas que protéger sa propre vie et celle de sa famille ? N’est-il pas coupable d’en avoir secrètement joui ? Ce paradoxe est plaqué sur le visage de celui qui est incapable de redevenir celui qu’il fut en faisant oublier celui qu’il a été.

C’est, au fond, ce que filme Cronenberg : le processus de transformation d’un homme en un autre qu’il n’a jamais cessé d’être, qui l’habitait, ou encore qu’un autre habitait. Cette situation particulière du personnage se traduit par une sorte d’absence à soi, de jeu décalé. À la différence de plusieurs autres films (The Fly, Videodrome, Naked Lunch, Rabid), dans lesquels le devenir-animal ou le devenir-machine supposait un « autre », extérieur au sujet, et qui prenait sa chair d’assaut, dans A History of Violence le soi intime de Stall est un autre. Un autre dans lequel il doit se camper, contre son gré, tout au long du film, à mesure également que son corps subit des assauts qui le rendent de plus en plus claudiquant, troué, percé de toutes parts (la plaie dans son pied se remet à saigner, après qu’il ait parcouru à la course la route entre son commerce et sa maison, soudainement affolé par l’idée que la bande de Fogaty puisse débarquer chez lui). On pourrait presque dire que, à mesure qu’il se révèle en tant que Joey, il perd de son sang, jusqu’à sa paradoxale rédemption (après la liquidation finale, il lave ses plaies au bord d’un étang, au petit matin, au cours d’une scène sublime).
Un phrase, une seule, adressée à Fogaty, complète la métamorphose de Tom en Joey, annoncée dès les tous débuts du film : « I should have killed you in Philie. » Nous sommes devant la maison des Stall. Fogaty s’apprête à tuer Tom qui vient de prononcer ces mots, quand, in extremis, le fils de Tom, surgi de nulle part, l’abatte d’un coup de carabine (le 12 qui est de service dans toute bonne maison américaine). Le père, en un éclair – et la violence dans ce film est affaire d’opportunité saisie, de virtuosité de l’efficace -, finira le boulot en tuant les deux autres truands. À cet instant précis, un retournement se produit dans le regard du père qui sait que son fils sait, qu’il a entendu, que quelque chose d’irréversible vient de se produire. Tout ensemble, dans le visage de Tom devenu en un contre-champ Joey – aussi efficacement que l’on passait en une coupe de montage de l’autre côté dans eXistenZ -, passe un regard composé d’un vertige inquiet (« dois-je tuer mon fils ») et d’une délectation sordide (« nous sommes de la même chair, et je n’ai plus besoin de le cacher »), comme si ce regard venait sceller un pacte, une transaction signée par le sang avec un fils qui vient d’apprendre qui est son père, qui entre’aperçoit sa propre origine en tuant lui-même un homme. Plus tôt, le fils – après l’événement dans le diner -, avait cassé la gueule à deux nigauds qui le tourmentaient depuis le début du film. Ce geste de violence avait été vivement condamné par le père : « In this family, we do not solve problems by hitting people ». À cela, le fils répondit par : « No, in this family, we shoot them »… Si le père gifle le fils arrogant, c’est en partie parce que le reste du scénario donnera raison à ce dernier. C’est aussi pourquoi le fils refuse le pacte, ambigu et terrible, que le père lui tend devant la maison, au moment où il comprend que les problèmes, pour son père, se réglaient, en effet, de cette manière.

Ce difficile transfert de responsabilité entre un père et son fils, pourrait faire penser à une autre scène, primitive celle-là aussi, où un fils comprend sur une pelouse, devant sa maison, que son père est un criminel, et que ce dernier exige sa complicité : cette scène est dans The Night of the Hunter. Le père vient de faire un cambriolage (parce qu’il ne supporte pas que ses enfants puissent avoir faim), et va se faire arrêter d’un instant à l’autre 2 . Il confie à son fils la responsabilité d’une liasse de billets qu’il cache à l’intérieur du lapin en peluche de sa sœur. Un instant plus tard, le père est cloué au sol et emmené par les policiers (il sera exécuté, plus tard dans le film)… le fils crie que c’est trop lourd à porter, qu’il n’en veut pas de cette responsabilité qu’on force sur lui.
Bien entendu – et c’est l’abîme qui sépare la démarche et l’Amérique de Laughton de celle de de Cronenberg – dans A History of Violence la scène se poursuit autrement : les cadavres des trois types reposent sur le sol. Ne demeurent que Joey et son fils, le seul qui sait, le seul qui a entendu la phrase qui trahit tout, se fixant dans les yeux. Pas une voiture de police à l’horizon, pas un voisin ; pour seule témoin, la mère, l’épouse, qui a tout vu par une fenêtre, à l’étage (mais elle n’a donc pas pu entendre la confession inopinée). Un étrange triangle ici se noue, entre le fils qui a entendu la phrase, la mère qui a vu la scène, et le père qui se sait vu et qui sait que celui qui est devant lui a tout entendu. Et la caméra se met à tourner… C’est le début et la fin du dévoilement, un nouvel ensemble de la mécanique se met en place…
Le premier ensemble de la mécanique superbement scénarisée par Josh Olson a été déclenché auparavant, nous le disions, par deux coups de fusil habiles tirés dans un acte de légitime défense, aussitôt monté en épingle par les médias qui font toujours leur miel des héros ordinaires. Forcé à sortir de l’anonymat par le hasard d’un acte héroïque qui en révèle d’autres, pas si héroïques, Jack/Joey doit faire le contraire de ce qu’il a fait jusqu’ici pour maintenir sa couverture : il doit s’arracher à son immobilisme, et parcourir en sens inverse le territoire. Comme dans tout bon Western – Joey a quitté l’Est pour devenir Jack à l’Ouest, Ouest qui, de tradition, ne pose pas de questions, tant qu’on sait se tenir et qu’on joue le jeu. Mais comme toujours, l’appel de l’Est ne tarde pas à sonner, littéralement : le frère prodigue a des comptes à rendre, qu’il fera payer aux autres en se rendant lui-même justice. Il tuera son frère et ses gardes du corps (non sans que ces derniers, bien entendu, n’aient tenté de l’abattre). Il est à noter d’ailleurs, que la violence de Jack se déploie systématiquement et uniquement quand aucune autre issue n’est possible : la violence est posée comme auto-conservatrice.
Se « rendre justice » (à une échelle individuelle ou étatique) est la notion fondatrice de cette nation des self-made men, traduite en son paroxysme au niveau individuel par la négation de l’état (de droit) et la reprise de la justice par d’autres moyens. Cette notion en suppose une autre : l’inefficacité du système judiciaire à répondre efficacement à un problème de justice. En effet, le shérif de la localité est comme dans plusieurs Westerns un sympathique niais, passablement impuissant, dont la seule préoccupation semble être de maintenir le mal (les bad men) en dehors de la ville, quitte à se faire le complice par omission de Jack (en ne posant pas trop de questions, alors que les faits sont plutôt douteux). « We take care of our own here », dira-t-il à Fogaty. Edie (Marie Bello), la femme de Jack, avocate, n’hésite pas elle non plus à répéter au shérif la « version officielle » (Tom n’est pas Joey), bien qu’elle la sache mensongère.
Tout ceci fait partie du vecteur entropique, ou auto-conservateur, qui anime chacun des personnages et la communauté dans son ensemble (cet instinct peut nous amener à cacher, nous dit Cronenberg, une grande violence). Ce fantasme d’une certaine Amérique reconduit le poncif suivant lequel la violence est toujours ce qui est dehors, chez l’autre, jamais à l’intérieur (alors que Cronenberg ne cesse de montrer tout au long du film que la violence est partout, à l’école, dans le cadre familial, dans les rapports sexuels, dans le langage, dans les rêves, etc.). Millbrook, Indiana est un lieu fictif à plus d’un titre, nourri par ce rêve que l’Amérique se fait d’elle-même, de la même manière qu’il suffit à Edie de se déguiser en cheerleader – lors d’une soirée intime – pour simuler régressivement un passé non vécu avec Tom, celui d’une adolescence de high-school sweethearts américains (on comprend alors que Tom ne vient pas de Millbrook, ce qui alimente nos soupçons).

Viggo Mortensen et Maria Bello
Cette pseudo-perfection de la communauté sera mise à mal par un événement, annoncé dès le premier plan, qui déclenchera une chaîne inattendue de réactions : l’arrivée dans la petite communauté de deux meurtriers, las et esseulés, l’un jeune, l’autre plus âgé, venus visiblement des grandes villes de l’Est, à la recherche d’argent et de sensations fortes. Toute la première partie du film alternera entre la vie ordinaire de la famille Stall, et l’ordinaire de la vie des deux criminels errants, jusqu’à ce que leur route de perdition croise, par hasard, celle de Tom, dans le restaurant de ce dernier…
L’alternance que Cronenberg met en place produit un effet de contraste, certes, entre deux modes de vie décalés, mais en même temps, produit subtilement un effet de liaison, au point où on peut être amené à croire, au premier visionnement, et ce, jusqu’à ce que le duo de tueurs aboutisse dans le village, que l’épisode des deux malfrats est une vision du passé, fait déjà partie de l’histoire qu’imagine Tom (il faut dire que les bandes-annonces nous en avaient déjà beaucoup dit avant de rentrer dans la salle). Cette impression est renforcée par le cri affolé de la fille de Tom, éveillée en pleine nuit par un cauchemar, qui suit immédiatement la première scène du film au cours de laquelle une petite fille dans un motel, sortie de derrière une porte entre les cadavres de ses parents fraîchement abattus, sera à son tour tuée par le jeune brigand… Le montage entre ces deux scènes présente déjà, en raccourci, l’intrusion de la violence dans la maison des Stall, que Tom tentera d’endiguer… Mais cette scène inaugurale peut nous donner l’impression d’un cauchemar, rêvé par Stall lui-même, une scène de son passé, qui pourrait lui revenir, la nuit. Et l’arrivée des deux hommes dans Millbrook lui apparaîtra en effet comme un cauchemar, le retour au « présent » de quelque chose du « passé », dont il croyait s’être débarrassé (c’est tout le flirt typiquement cronenbergien avec la psychanalyse). Le jeune acolyte n’a-t-il pas quelque chose de l’allure et de l’âge de Joey, quand il décida d’interrompre sa vie criminelle ; la nature de sa violence et cette étrange jouissance à l’exercer ne ressemble-t-elle pas à ce qu’il décrira plus tard dans le film ? Remonter le fil du temps, c’est le chemin qu’aura à parcourir Tom pour arriver à se débarrasser de sa hantise…
Ce qui frappe dans toute cette première partie, et ailleurs dans le film, c’est le thème de la lassitude, d’une certaine fatigue, d’un certain vide qu’éprouve celui qui trempe au quotidien dans l’horreur. Cette impression, Cronenberg nous la fait éprouver, notamment, au cours du très long plan séquence qui ouvre le film (sans doute un des plus réussi de toute son œuvre), quand les deux hommes se plaignent de la chaleur, de la lourdeur du temps, que la caméra se déplace latéralement, très lentement, suivant la décapotable qui s’arrête devant la réception du motel où vient de se commettre, sans qu’on ait entendu un son, le meurtre des gérants. On ne peut s’empêcher d’associer cette fatigue à celle qui a fait que Joey quitte cette vie, et à celle qui s’abattra à nouveau sur lui à mesure que l’intrigue se développe. La fatigue apparaît alors comme le catalyseur et le point d’aboutissement désespéré de la fiction.
En parvenant à attirer vers son personnage bipolaire l’empathie du spectateur, qui s’accroît même à mesure qu’il tue, Cronenberg rejoint avec grande force et finesse l’un des motifs majeurs du plus grand cinéma classique américain. Recueillir l’adhésion du spectateur, tout en faisant de cette adhésion spectatorielle l’objet d’un questionnement : à qui adhère-t-on, finalement ? À Tom, à Joey ? À moins que ce ne soit, plus fondamentalement, à la puissance de la fiction. Une fiction qui nous dit que l’histoire de la violence est peut-être avant tout l’histoire des mensonges (entre autres, envers soi-même) que nous devons inventer afin de nous en prémunir.

en-tete
Notes
- Cronenberg raconte comment le célèbre Howard Shore, qui signe la trame musicale, a visionné avec lui plusieurs Westerns de Ford pour trouver une source d’inspiration pour ce film. ↩
- La différence majeure étant bien entendu ici que le crime du père, qui répondait selon ses dires à une situation historico-économique encore plus criminelle, vient d’être commis, alors que, dans le cas de Tom, il s’agit d’une longue histoire criminelle qui n’a jamais été traduite en justice, bien enfouie dans le passé, qui apparaît soudain aux yeux du fils. ↩
