Hommage à Jean Rouch : caméra intouchable
Je me rends compte maintenant que j’ai toujours senti une sorte de malaise avec la caméra de Jean Rouch, son « gaze », comme les post-modernistes anglophones aiment dire. Mais pour plusieurs raisons, je n’ai jamais cherché la source de ce malaise, ses contours, ses conséquences. Tout ce que je savais c’est que j’avais une certaine affinité avec le projet anthropo-cinématographique de Rouch et que certains de ses films m’avaient beaucoup marqué, tant au niveau de ma pensée que dans ma façon d’enseigner l’anthropologie. Je sais aussi que je n’étais pas le seul à être fasciné, voire envoûté par les films de Jean Rouch. Maintenant que le vrai maître fou est devenu un ancêtre, je propose de poser un regard sur son œuvre, mais aussi sur notre fascination envers elle.
Pour comprendre l’impact de Jean Rouch, il faut comprendre l’impact qu’il a eu sur plusieurs disciplines. Rouch est comme le fameux éléphant qui se fait toucher par les aveugles qui « voient » tous un aspect différent de la réalité. Son œuvre est citée par des chercheurs en études cinématographiques, en anthropologie, en études africaines pour ne nommer que ceux-ci, et chaque tradition disciplinaire va toucher une partie différente de son projet filmique. Jean Rouch a réalisé au moins trois sortes ou trois registres de films : des films « ethnographiques », produits dans le contexte de ses recherches avec l’ethnologue français de renom Marcel Griaule ; des films documentaires expérimentaux du genre « cinéma vérité » ; et des films qui explorent les frontières entre l’ethnologie et la fiction, ce que l’on nomme souvent l’«ethno-fiction ».
Je n’ai jamais pu regarder les films de la première catégorie (les films ethnographiques), en partie à cause de ce que Lévi-Strauss a identifié comme la caractéristique principale du genre du film ethnographique : ils sont ennuyants. Effectivement, vu les talents narratifs de Rouch, c’est étonnant de voir à quel point il a su réaliser des films «soporifiques dans ce genre : narration voix de dieu, imposition d’analyses ethnographiques, fixation taxonomique (voir par exemple la série Sigui, qui documente à travers plusieurs années de tournage une série de rites cycliques chez les Dogon). Si Rouch tenait autant à ces films ce n’est pas seulement à cause de l’affection qu’il avait pour les gens de cette région (il avait fait beaucoup de terrain chez les Dogon du Mali et chez les Songhay du Niger), mais aussi parce que son identité professionnelle était liée de façon intime à la tradition ethnologique française, qui s’est toujours défini comme une science de l’observation 1 .
Le deuxième registre de ses films (cinéma vérité) doit être considéré dans le contexte des critiques faites à Rouch suite à la projection des Maîtres fous. Ce film avait choqué la gauche (entre autres Griaule) qui le trouvait raciste ; il avait également offusqué la droite (et ceux qui soutenaient l’idée de la France comme garante de la civilisation en Afrique) qui le considérait anti-colonial. Le film qui a canonisé ce deuxième registre de film, Chronique d’un été, a aussi permis à Rouch de se défendre contre ses détracteurs qui lui reprochaient d’avoir rendu exotiques les sujets de ses films. Suite à l’invitation d’Edgar Morin, Rouch tenta d’appliquer une méthode ethnographique à sa propre société, bien que ce soit un film qui est rarement discuté par les ethnologues.
C’est le troisième registre des films de Rouch (l’ethno-fiction) qui m’intéresse le plus. Pourquoi ? Est-ce parce que je suis ethnologue? Je ne pense pas ; en général l’idée de mélanger la fiction avec le travail « sérieux » de terrain ethnographique (notre fétiche disciplinaire) n’est pas bienvenue en anthropologie, même vingt ans après la publication du livre Writing Culture, édité par George Marcus et James Clifford. Est-ce parce que j’ai passé beaucoup de temps en Afrique (où Rouch a tourné les plus grands exemples de ses ethno-fictions) ? Peut-être. Mais il y a une autre raison : c’est la particularité de sa vision utopique. Ce n’est pas une utopie politique, ni religieuse, ni économique, mais une utopie de l’intersubjectif, ou plutôt l’utopie par l’intersubjectif, ce que Rouch a appelé une ou deux fois en passant « l’anthropologie partagée ». C’est exactement cet énoncé qui m’a envoûté depuis ma première ciné-transe rouchienne. Anthropologie partagée. Anthropologie. Partager. Je n’arrive pas à m’en débarrasser. Qu’est-ce qu’il voulait dire avec cette expression ? Pourquoi avait-elle autant de résonance personnelle et professionnelle pour moi ? Était-ce une réponse au cul-de-sac post-moderniste que j’avais adopté afin de me démarquer d’autres hégémonies anthropologiques ? Était-ce la solution au problème de la représentation posé suite à la vague engendrée par Writing Culture ? Est-ce qu’Edward Saïd avait raison quand il parlait du narcissisme du geste ethnologique 2 ?

Rouch durant un tournage
Rouch lui-même n’a jamais examiné de façon critique ce qu’il voulait dire par l’expression « anthropologie partagée ». Dans son texte le plus souvent cité, il déclare que l’avenir du cinéma sera témoin d’une prise en main de la représentation par ceux qui sont d’habitude les objets du regard anthropologique, et que c’est ainsi que le cinéma « nous aidera à partager l’anthropologie 3 . Le glissement ici est révélateur : est-ce que Jean Rouch voulait partager l’anthropologie ou partager la culture Africaine ? Lequel et avec qui ? Pour lui, « l’expérience décisive » de l’anthropologie partagée consistait à documenter les rites sigui chez les Dogon en utilisant une méthode de « feedback » où les figurants donnaient des commentaires sur la production du film au fur et à mesure du tournage et montage. Mais il n’y avait rien de nouveau dans cette méthode. Elle avait été utilisée par Flaherty durant le tournage de Nanook of the North (d’où Rouch a eu l’idée) et depuis que les anthropologues se rendent sur le terrain, ils ont pris l’habitude de vérifier leurs données avec un certain nombre d’interlocuteurs privilégiés (la spécialité de Griaule). Ce qui est plutôt rare, c’est le fait de documenter des cérémonies cycliques à travers le temps et ce, dans un contexte où le savoir rituel peut se limiter à certaines personnes ou catégories de personnes. Mais les réticences de certains membres de la communauté où Rouch filmait ne semble pas l’avoir dérangé :
« Donc, lorsque nous projetterons l’ensemble de nos films, puis la première ébauche de synthèse, nous permettrons à des Dogon de voir un rituel essentiel qu’aucun Dogon n’a jamais vu. Nous ne savons pas ce que sera leur réaction (certains informateurs de la falaise laissent entendre que notre trop grand appétit de connaissances aurait dû être déjà sanctionné par notre mort avant la fin du périple) mais nous sommes certains que nous ouvrirons ainsi le dialogue à de nouvelles questions, à de nouvelles réponses 4 . »
Étant donné que Rouch n’a jamais vraiment expliqué ce qu’il voulait dire par cette expression, on peut simplement imaginer ce qu’il a « partagé » en regardant ses films : l’humour, un sens de théâtralité, la bière, la route et le projet d’improviser une série de variations autour d’un thème culturel qui n’est pas le sien. Dans l’introduction de son livre – à mon avis la ressource la plus importante dans les deux langues au sujet de Rouch – Steven Feld essaie de donner un sens plus systématique à cette anthropologie partagée. Selon lui, il y a trois sortes de partage dans le cinéma rouchien : le partage du résultat final avec les figurants et leur communauté (comme dans le cas de Sigui), le partage qui émerge dans le phénomène de la ciné-transe, et le fait de travailler en équipe avec une méthode de travail collectif (comme par exemple dans Jaguar) 5 . Cet aspect du travail de Rouch (le partage) lui permettrait de créer un « nous » qui semble vouloir exister en dehors du temps et qui semble transcender les différences de classes et de races imposées par l’ordre colonial. Ceci n’a pas empêché Rouch d’utiliser le cinéma pour réfléchir sérieusement à ces sujets (Chronique d’un été, La pyramide humaine, Moi, un noir), mais sa notion de partage lui donne bonne conscience de penser que dans l’espace d’intersubjectivité créé par l’intermédiaire de sa caméra, les différences de peau et de pouvoir n’ont pas d’importance. L’utilisation de la technologie occidentale peut créer un nouveau « nous ».

Jaguar (1954-1967)
Mais qui c’est, ce « nous » ? Quand, au départ du périple de Jaguar, Rouch déclare que « nous sommes partis à trois », qui sont les trois ? Damouré (la version africaine de Rouch, un aventurier « gallant »), Illo (un pêcheur), et Lam (un berger). Comment fait-il pour faire partie du nous sans en faire partie ? Pourquoi n’est-il pas visible dans ses films d’ethno-fiction tournés en Afrique ? Pourquoi dans Les maîtres fous, Moi, un noir et Jaguar, Rouch est effacé du texte visuel mais non de la narration ? Pourquoi son « camarade » Damouré, homme à tout faire et fanatique de la modernité n’a jamais pris la caméra pour filmer un peu ? Qu’est-ce qu’ils ont partagé exactement, à part l’envie de tourner un film ensemble et le rire de complicité masculine autour des jeunes filles séduites comme « Dorothée L’Amour » (Moi, un noir) ?

Jean Rouch dans “La pyramide humaine” (1961)
Une chose est certaine : Jean Rouch a toujours préféré travailler avec des marginaux («Damouré est allé à l’école, mais il n’aime pas l’école », entend-on dans Jaguar). Les personnages dans Chronique, Jaguar, Moi, un noir par exemple sont des ouvriers désabusés, des prostituées, des jeunes sans abri, des étrangers aliénés, des artistes en fuite, des noirs à Paris. En fait, une des choses qui semble réunir les personnages de Jean Rouch c’est qu’ils ont moins de statut social que lui, et qu’ils se trouvent dans une situation de mobilité sociale ou géographique, parfois périlleuse. Pourquoi dans ses films africains Jean Rouch travaille principalement avec des illettrés (si on exclut La pyramide humaine) ? Avec des gens qui se trouvent en ville sans aucune attache familiale (chose qui est assez rare dans les centres urbains en Afrique, même aujourd’hui). Pourquoi a-t-il essayé de nous convaincre à plusieurs reprises qu’il n’avait pas choisi ses interlocuteurs mais c’est plutôt lui qui a été choisi ?
La vérité de Jean Rouch n’est qu’une vérité partielle, une vérité profondément idéologique et malhonnête qui parle à travers les autres tout en disant que l’autre parle pour lui-même. Je ne veux pas reproduire une critique déjà vue qui veut démontrer que la réalité dépend de la perspective de celui qui regarde (l’histoire de l’éléphant) ; certainement Jean Rouch a beaucoup fait pour nous faire réfléchir sur la force médiatrice de la caméra et l’influence de celle-ci sur le produit final. Ce qui m’intéresse ici est le fait que Rouch ait complètement ignoré sa propre position idéologique vis-à-vis le type de personne qu’il choisissait comme collaborateur, et surtout par rapport aux enjeux politiques de cette collaboration.
L’idée que j’essaie d’avancer n’est pas évidente, surtout pour ceux qui, parmi nous (moi le premier), ont participé à la folie de l’intouchabilité de Jean Rouch 6 . En réaction à mon texte, mon collègue André Habib a identifié un élément important de ma critique, la position du cinéaste vis-à-vis les personnes qu’il représente :
« Je crois que, à la différence de Flaherty qui était encore dans un idéal de transparence par rapport aux éléments fictionnels qu’il apportait, qui prétendait pouvoir “rendre la vérité” par la manipulation, Rouch se pose d’autres questions, complètement. Sa “fabulation”, c’est aussi celle de ceux qu’il filme, c’est du moins ce qu’on voit, ce qu’on entend sur la bande-son. Et elle est peut-être là, alors, la méprise. C’est peut-être là que le narcissisme de l’ethnologue dont tu parlais (en citant Saïd) me semble plus claire : c’est le narcissisme du chef d’orchestre qui demande qu’on acclame ses musiciens, tout en sachant que c’est que grâce à lui (sa technique, son initiative, sa présence, sa direction) qu’ils étaient si bons 7 . »
Le geste représentatif ne peut pas exister en dehors d’une relation de pouvoir. Un chef d’orchestre qui demande aux musiciens de se lever pour se faire applaudir reste un chef d’orchestre, et on ne peut évaluer ce geste de pouvoir en l’isolant de sa relation au spectacle.
-
Peut-être fallait-il que Jean Rouch meurt pour que je quitte l’emprise de sa caméra. Maintenant qu’il n’est plus de ce monde, il est encore plus fidèle à son image d’esprit libre, d’ancêtre, de provocateur. Sa mort m’a permis de me demander pourquoi ses films m’avaient autant attiré. Manthia Diawara, dans un film documentaire fascinant au sujet de la vie et de l’œuvre de Jean Rouch (Rouch in Reverse), tente de retracer son influence sur une génération d’artistes et d’intellectuels originaires des anciennes colonies françaises. Dans une séquence vers la fin du film, Diawara se fait corriger en récitant un poème qu’il avait probablement déjà répété maintes fois en tant que jeune étudiant dans le système d’éducation colonial français. Mais cette fois-ci la leçon se passe à Paris, dans un parc public sous un ciel grisâtre, devant un monument. Diawara est un professeur dans une université prestigieuse aux États-Unis. Rouch va mourir dans quelques années. C’est pour moi la première fois que j’ai vu le vrai visage de Jean Rouch, chauvin, paternaliste, incapable d’écouter. Diawara, malgré le fait qu’il est visiblement inconfortable, décide de laisser cette séquence dans le film. De toutes façons, il ne peut pas la supprimer. C’est la seule preuve qu’il a pour montrer que le projet utopique de Jean Rouch a été subverti, voire prédéterminé par son incapacité à se détacher de lui-même.
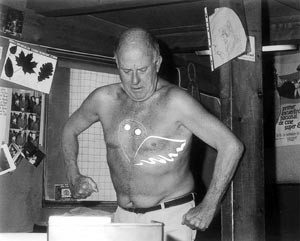
Notes
- Pour une excellente description de cette tendance intellectuelle, surtout en rapport avec son « evil twin » le relativisme culturel Américain, voir Johannes Fabian, Time and the Other, New York, Columbia University Press, 2002. ↩
- Edward Saïd, « Representing the Colonized : Anthropology’s Interlocutors », Critical Inquiry, nº 15, hiver 1989, p. 205-225. ↩
- Jean Rouch, « The Camera and Man », trad. par Steven Feld et Marielle Delorme, Studies in the Anthropology of Visual Communication, vol. 1, nº1, 1974, p. 37-44. (Je traduis) » ↩
- Jean Rouch, « Le renard fou et le maître pâle », dans Systèmes des signes, Textes réunis en hommage à Germaine Dieterlen, Paris, Éditions Hermann, 1978, p. 21. (Je souligne) ↩
- Steven Feld (dir.), Cine-ethnography, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2003. ↩
- J’aimerais remercier Nicole Bernier de m’avoir aidé à demeurer honnête par rapport à cette folie, et à André Habib, de Hors champ, pour ses commentaires constructifs. ↩
- Communication personnelle, 3 novembre, 2004. ↩
