Espace de reliaison
Dialogues entravés par la guerre: Beyrouth la rencontre - Borhane Alaouié (1981), (posthume) - Ghassan Salhab (2007)
Face aux ruines de la guerre, Beyrouth la rencontre de Borhane Alaouié et (posthume) de Ghassan Salhab ne choisissent pas le chemin de la fiction, mais celui de son impossibilité, tentant de reconstruire un regard détruit par les conflits et de recréer, malgré la douleur et les tensions encore vives, un espace de dialogue.
I – La « ruine-image » : image des ruines ?
Dans la partie centrale de Beyrouth la rencontre, qui est l’entre-deux nocturne où, peut-être, est et ouest peuvent se retrouver, Zeina éteint la lumière tandis que Haydar dans le noir livre ses paroles au magnétophone. Ils préparent tous deux l’espace de l’échange par les mêmes gestes rituels. Voilà le noir de l’image, cette absence de lumière qui témoigne de la dimension purement sonore de l’échange : les deux personnages n’ont pas réussi à se voir. C’est de cette obscurité que jaillit la nuit beyrouthine, avec ses ruines à demi-mots, les rues grignotées par les ténèbres silencieuses. Haydar dit à travers la bande magnétique « Au moins j’ai bien des raisons de voir qu’entre toi et moi, entre deux êtres qui se cherchent à Beyrouth, il y a non seulement 60.000 morts mais un quart de millions de voitures, deux millions de montagnes d’ordures, des millions de mots écrits sur les murs, des balles, des corps et des voix humaines ». Cette phrase accompagne la disparition, la dissolution de Haydar dans la nuit : son corps disparaît, ne reste que sa voix qui s’imprime sur l’espace obscur où son énumération résonne.


Ce que dit Haydar, c’est précisément ce que nous présente la deuxième partie : la fragmentation des images qui, en mêlant les vues nocturnes et inertes, les ruines du village de Haydar et les souvenirs des deux amis pris dans les ruines, transcrit par l’image la fragmentation de la société provoquée par la guerre. Alors, l’image des ruines n’a plus pour but, dans cet amas silencieux qui réunit aussi des paysages, des silhouettes et des vieilles photos, d’être la représentation de la destruction urbaine mais participe à une transcription visuelle des meurtrissures du Liban. Ces « ruines-images » ne sont pas les images des ruines mais des images en ruines.
Le montage d’Alaouié participe à la création d’un amas de souvenirs, de visions et d’espaces urbains : leur conversation est tirée entre l’espace et le temps, entre le passé à raconter et le territoire à traverser par l’image. Les éléments de cet assemblage n’apparaissent jamais entiers mais rongés par la guerre : le village est en ruine, les murs du souvenir sont impactés de balles, la ville nocturne est envahie par le noir. Toute cette montagne d’images la plupart du temps fixes (sauf lorsqu’elles rejouent le mouvement d’un souvenir), devient les bribes visuelles de cette conversation seulement faite de bribes de paroles, de cet échange en ruine qui tente de construire la rencontre. Mais cette formule de « ruine-image», Cyril Neyrat l’utilise pourtant initialement pour évoquer le travail de Ghassan Salhab dans (posthume). En effet, le film entier de Salhab qui se déroule en bégayant dans un fatras d’images en surimpression, une forêt sonore hypnotique qui mêle la musique, les voix et les bruits de la destruction, dessine les contours flous et déréglés des ruines, et forme par ces décombres d’images la figure détruite du Liban après 2006. Cyril Neyrat écrit « Salhab assimile les ruines de Beyrouth aux images empilées : l’image comme ruine – certes pas la belle ruine romantique, mais la ruine informe que laisse derrière elle la guerre 1 ».
Cette informité de la ruine se retrouve dès le premier plan où la silhouette de Aouni Kawas est dévorée par le grésillement visuel et sonore de l’image sans signal. Plus tard dans le film, l’image télévisuelle prend ponctuellement une importance considérable, agissant comme un parasite, venant brouiller l’image, effacer les paroles par des brouhahas informatifs.


La télévision constitue un débordement d’images, qui comble artificiellement la destruction du réel par la surreprésentation de cette destruction, comme cela apparaît dans les paroles des « personnages » (une voix féminine dit « un torrent d’images assaillent nos yeux »). Les images grumeleuses parfois en très gros plan, se superposant les unes sur les autres transforment l’écran de télévision en un lieu de décombres où le regard n’a plus sa place, car il n’y a plus rien à voir. Ce montage appelant constamment des images issues de la télévision donne à sentir une ruine du regard lui-même, le sentiment de ne pouvoir réellement entreprendre de voir, comme si l’informité de la ville empêchait de la mettre en forme cinématographiquement. De plus, la superposition de ces images sans forme avec les paroles d’une des voix qui évoque les destructions des infrastructures libanaises par Israël, assimile la bouillie d’images présentées à cette destruction réelle, faisant du flux visuel une représentation de la destruction, traduisant en termes d’images la ruine matérielle du pays. Un des exemples les plus visibles de ruine-image, ce sont les plans de pelleteuses s’évertuant à détruire et vider le champ dans un vacarme de poussière. L’image met en scène sa propre destruction, mais une destruction qui n’est pas absolue, conservant cet état de ruine qui donne matière à détruire. Nous ne sommes jamais devant une image détruite, mais une image en cours de destruction (comme en témoignent les panneaux de chantier), une image en morceaux. Ainsi les deux films transforment leurs images en ruines, traduisant par le cinéma les blessures de la société libanaise, autant à l’échelle de l’individu que du territoire entier. La ruine-image se fonde sur la multiplication d’un manque : le montage, reliant les différentes images de ruines et ce qui les borde, forme par la dégradation des images un amas contenant en lui de nombreux espaces. Entre les plans de Beyrouth la rencontre, la parole se faufile dans la nuit, dans le brouhaha de (posthume), les images effritées constituent le fond de notre regard : c’est alors à nous de reconstruire les images grâce à ce qu’elles ne contiennent pas, réassembler les morceaux sans que rien ne se reforme vraiment, mais en tentant de comprendre ce que cache ce délabrement visuel. Sur les ruines de l’image, il s’agit de percer une brèche et, entre les images, laisser respirer les blessures pour permettre au regard de se reconstruire.
II – La fiction impossible
Beyrouth la rencontre comme (posthume) se caractérise par la difficulté visible de dérouler une histoire. Dans le premier cas, le récit, qui ne peut commencer que par la rencontre de Zeina et Haydar, se trouve entravé par l’espace en état de guerre, le temps qui sépare leur dernière rencontre et leurs propres sentiments liés au conflit. En ce qui concerne le film de Ghassan Salhab, la forme choisie par le cinéaste, au seuil de l’expérimental, où seuls des visages et des bribes de paroles constituent les grumeaux fictionnels errants dans un matériel sans histoire (bien qu’en réalité, rien que dans la silhouette de la tour « Murr », toute l’Histoire et ses histoires sont là), l’absence de mise en fiction apparaît comme une réaction face aux événements. Cependant, la partie centrale de Beyrouth la rencontre est une imbrication de récits : les deux personnages s’entre-racontent pour combler les années sans s’être vus, passées ou futures. L’impossibilité de fictionnaliser prend donc forme à partir de cette multiplication des histoires : c’est le poids d’un passé criblé de balles qui empêche le présent de se former. La rencontre n’a pas lieu, ou bien seulement par le montage nocturne, et il semble que c’est précisément cette nuit de la presque-rencontre qui est le noyau de l’inaboutissement de la rencontre. En délivrant leur parole fissurée, les personnages font face à une douleur qui ne peut et ne pourra être le point de départ des retrouvailles.


Dans (posthume), bien qu’il n’y ait pas d’histoire, les visages apparaissent comme les réceptacles d’histoires. Comme l’écrit Ghada Sayegh « les visages face caméra de (posthume), en ouvrant ou en fermant les yeux, introduisent la question de la présence et de la conscience historique – non comme savoir objectif mais comme émotion, douleur 2 ». Par ces gros plans frontaux, Ghassan Salhab introduit l’humain dans la ruine et laisse les corps exprimer par leur simple présence des sentiments qui contiennent les récits absents. Le visage du témoin porte en lui ce qu’il a vu, et ces yeux braqués sur les nôtres nous renvoient des regards emplis d’histoires : celles des acteurs et plus généralement l’Histoire qui s’abaisse comme leurs paupières, « avec sa grande hache ». Mais ces corps qui regardent et qui racontent en se taisant n’échappent pas au processus de la destruction. Ainsi, alors qu’une voix énonce « il y a une faible différence entre ce qui s’est passé au-dedans… » accompagnant le visage d’un des acteurs, la parole est coupée brutalement et le plan écrasé par l’image d’une masse détruisant des ruines. Le montage exprime donc cette fissure intérieure qu’évoque la voix, mais vient aussi briser le discours, entraver l’expression, la ruiner. Les corps apparaissent souvent en surimpression, sortant du grésillement, voire gommés numériquement, devenant des corps en ruine qui ne sortent d’ailleurs jamais du cadrage en buste, emprisonnés par un décor inapte à accueillir leur déplacement et leur(s) histoire(s). Chez Alaouié, le corps est aussi un paradoxe fictionnel : bien que la séquence nocturne soit celle de la mise en récit, elle est aussi celle de l’immobilisation du corps présent qui adopte la pose du conteur et se retire ainsi métaphoriquement du monde. Il semble alors que c’est par cet écart au présent que la fiction peut naître. Cependant les histoires que racontent les deux personnages n’ouvrent sur aucun futur. Cet immobilisme contraste avec les deux autres parties du film où, quoiqu’il advienne, le mouvement est toujours entravé ou vain, s’épuisant dans la traversée. L’impossibilité de l’action dans Beyrouth la rencontre traduit le pouvoir destructeur de la guerre qui rompt les relations et s’interpose entre les êtres. Ne pas faire aboutir la fiction, c’est représenter la difficulté d’exister en temps de guerre tout en exprimant aussi une position éthique : Alaouié ne fantasme pas la guerre, il n’en fait pas un fond fictionnel mais au contraire choisit de montrer ses effets en creux en refusant le sensationnalisme, pour donner à ressentir au spectateur une réalité humaine à la fois banale et profondément meurtrie par le conflit. C’est un film sur l’épaisseur de la guerre, celle qui sépare Haydar et Zeina. En cela, la nuit prend une dimension symbolique : c’est le moment de la cécité, celui où plus rien n’est visible, le moment où les voix, peut-être, pourront percer les frontières mais les corps, eux, restent prisonniers du noir. Ghassan Salhab décrit (posthume) ainsi : « C’était un impossible témoignage, c’est toujours impossible un témoignage (car qui témoigne pour le témoin ?) 3 ». Cette affirmation qui se nie elle-même, posant de fait l’entreprise cinématographique comme un échec accepté se fonde sur la figure du témoin, c’est-à-dire celui qui a vu et qui raconte. Cela explique les corps immobiles, qui expriment la stupeur d’une attaque violente et imprévue. Le témoin, c’est alors le personnage qui s’arrête parce qu’il ne peut pas avancer sans se délivrer du poids de son expérience passée.


On parle souvent de l’importance du fantôme chez Ghassan Salhab, et il me semble que les semi-personnages de (posthume) sont aussi des fantômes : non seulement par leur constante translucidité, leur apparition-disparition, la spectralité de leurs silhouettes, mais aussi par le fait qu’ils sont des corps accrochés à un lieu – Beyrouth –, dont le passé les empêche de poursuivre leurs routes. Ce qui paralyse donc la fiction dans les deux films, c’est l’immobilité des corps, l’absence d’une mise en action, mais surtout une réalité où le passé entrave le présent, où le territoire détruit ne permet pas l’existence d’un espace d’action. C’est au seuil de la fiction qu’Alaouié et Salhab expriment la difficulté de vivre avec la guerre. Ils construisent un espace temporaire de réflexion, un lieu où les personnages au bord du récit examinent leurs blessures pour pouvoir réussir à se relever des ruines et vivre de nouveau.
III – Le cinéma : espace liminaire d’une reliaison
Comme nous l’avons vu, les deux films transcrivent dans la pellicule ce que la guerre a de destructeur, fondant leur construction sur une fragmentation et un inachèvement. Nous sommes face à un cinéma au bord de la fiction, représentant sa propre difficulté à exister. Cependant, cela ne signifie pas que les films sont simplement le symbole d’une fracture causée par le conflit, ils portent aussi avec eux un regard sur l’avenir, notamment en construisant paradoxalement un espace de reliaison. Comment relier, dans ce paysage de ruines où même les paroles s’effritent ? Cette reliaison transparaît d’abord par le rapport au temps. Les deux films charrient avec eux un élément qui est lui-même souvent considéré comme représentation du temps (ou plutôt mise en présence consciente des effets du temps) : la ruine. André Habib écrit dans Le temps décomposé : cinéma et imaginaire de la ruine : « La ruine offre […] un bon modèle pour appréhender la structure temporelle de l’image (de 1’image cinématographique en particulier)4 ». C’est en effet à partir de cette capacité du cinéma comme de la ruine à représenter le temps que Beyrouth la rencontre et (posthume) construisent leur réflexion. Dans Beyrouth la rencontre, les strates temporelles forment un tissu complexe puisque l’on est face à un présent doublé en montage alterné (d’un côté Haydar, de l’autre Zeina) dont la séparation paraît presque hermétique, comme si la temporalité spatialisée par les ruines (que l’on voit dans les plans nocturnes et les souvenirs) altérait l’unicité du temps présent. D’ailleurs, le chassé-croisé des personnages (qui traversent les mêmes lieux sans s’y rencontrer), donne l’impression d’un présent fissuré, comme si chaque côté de Beyrouth avait sa temporalité et empêchait les protagonistes de se retrouver dans un espace-temps unique. A cette complexité du présent s’ajoute le constant report au passé. Par les souvenirs mis en image ou bien par les paroles enregistrées, Haydar et Zeina ne parlent que de leur relation passée, de leurs souvenirs de guerre et finissent, en ne se rencontrant pas, par empêcher le futur de naître (la cassette de Haydar se transforme elle-même en ruine, écrasée par la circulation, faisant corps avec cette ville au présent fragmenté par les traumas du passé). Dans (posthume), on retrouve cette ruine temporalisée qui semble ressasser le passé, dont la destruction par les pelleteuses rejoue celle causée par la guerre et finit de transformer Beyrouth en un champ (chant ?) de ruines. Mais, dans les deux films et plus particulièrement dans celui de Ghassan Salhab, le mouvement engendré par le cinéma garantit un aller-en-avant, un enchaînement du monde qui induit du passé un présent, du présent un futur. Ainsi, le long travelling en surimpression à la fin de (posthume) est à la fois l’achèvement de la ruine-image et son démantèlement : on est face à une image qui, en mêlant différentes vues urbaines, forme un amas de béton.


Mais en laissant durer le trajet et en faisant se croiser les différentes images qui se rejoignent, se dépassent, se délaissent, repartent seules, ce plan dessine les contours d’une réalité sans cesse en mouvement. C’est ce mouvement où résonne la destruction qui permet de faire s’entre-respirer les différents espaces et temporalités, et de faire naître ainsi quelque chose de nouveau. Ghada Sayegh analyse le titre du film ainsi : « (posthume), c’est-à-dire après la mort, après la guerre, au seuil d’un troisième temps, celui de la résurrection 4 ».
(posthume) est en effet un film du seuil qui présente les cendres de la renaissance, et c’est ce Beyrouth fumant de poussière qui relie les différents personnages dans une souffrance commune, et par celle-ci, au point de passage qui, en représentant le choc, permet de se délivrer d’un poids. La reliaison de (posthume), c’est la présence prégnante de ce qui le précède ouvrant sur le reflet de ce qui le suit : le film n’est fermé que par ses parenthèses, il est un espace irrespirable de respiration, le lieu de l’état des lieux. En réfléchissant sur la situation présente par une mise en mouvement constante et mêlée de la ville et de ses visages, Ghassan Salhab fait sentir, au-delà de la mort, la vie qui s’échappe des décombres. Dans Beyrouth la rencontre, le film devient un espace qui va à contre-courant du réel : le dialogue n’est qu’un monologue, la rencontre n’aura pas lieu, pourtant le dialogue est un dialogue et la rencontre a bien lieu, cela grâce au cinéma (c’est-à-dire au mouvement). Par cette séquence, Alaouié donne aux personnages la possibilité de se rencontrer cinématographiquement : le montage de leurs deux paroles forme un dialogue qui dépasse les brèches territoriales et temporelles. Par le simple fait que ces paroles sans lendemain soient destinées à parler à l’autre, à former un dialogue déphasé, une liaison se créé même éphémère (et pour toujours gravée dans la pellicule) entre Zeina et Haydar. Et c’est ici que le film prend une ampleur considérable : il ne nous présente pas un présent achevé, accompli (où les deux personnages se rencontrent) mais un présent en devenir où les paroles captées n’ont qu’une valeur future. La séquence nocturne représente le cœur du film car elle capte toute l’ambiguïté de cette rencontre faite-défaite : peut-être que si les deux personnages ne se rencontrent pas, c’est que dans la nuit, par cet enregistrement rituel, ils se sont déjà rencontrés. Philippon écrit sur le film : « On voit véritablement la parole se frayer un difficile chemin au travers des ruines ( …) . [L’auteur] a filmé la parole comme quelque chose de visible, comme une matière en mouvement 5 », tandis que Deleuze commente cette remarque en ajoutant : « au lieu d’une image vue et d’une parole lue, l’acte de parole devient visible en même temps qu’il se fait entendre, mais aussi l’image visuelle devient lisible, en tant que telle, en tant qu’image visuelle où s’insère l’acte de parole comme composante 6 ». C’est en effet par cette imagination de la parole, où la parole devient image et où l’image n’apparaît plus que comme la parole réalisée que les personnages communi(qu)ent. Que sont ces plans de la séquence nocturne ? Les seuls de tout le film qui ne s’accrochent à aucun déplacement concret des personnages. Ce sont les images de déplacements plus profonds, ce sont les vues fragmentées d’une reliaison latente. S’il y a reliaison, c’est parce que la liaison doit enjamber les ruines de la guerre, mais c’est aussi parce qu’elle n’est pas évidente, elle se conçoit en-deçà ou au-delà du film, au regard de la déliaison, la fragmentation, la destruction que le film contient aussi. C’est cette dialectique de la destruction et de la reconstruction, de la déliaison et de la reliaison qui fait de ces deux projets des espaces cinématographiques où le spectateur peut réfléchir et colmater par son regard les béances incomplètes de la réalité.
Borhane Alaouié et Ghassan Salhab choisissent de situer leurs films dans un après-pendant du conflit, un moment où le passé résonne encore dans le présent, où la fiction ne peut naître réellement, encore empêtrée dans un espace en ruine où la circulation des êtres est mise à mal. Par les « ruines-images », ces fragments cinématographiques qui s’entassent et se mêlent avec souffrance et difficulté, de la séparation la poésie peut naître et dans la nuit de la rencontre, les images comme des vers viennent dessiner le squelette d’une parole. Mais c’est par cette représentation de l’inachèvement que les deux films fondent un espace de dialogue, de réflexion et de reliaison. Les œuvres ne sont plus des histoires à suivre, mais des espaces-temps à ressentir, à réfléchir, des fenêtres ouvertes sur les décombres où l’observateur se reconstruit, le regard dans la poussière. Dans Beyrouth la rencontre et (posthume) rien n’aboutit, certes, mais c’est cette absence d’achèvement qui témoigne de la douleur de la reconstruction.
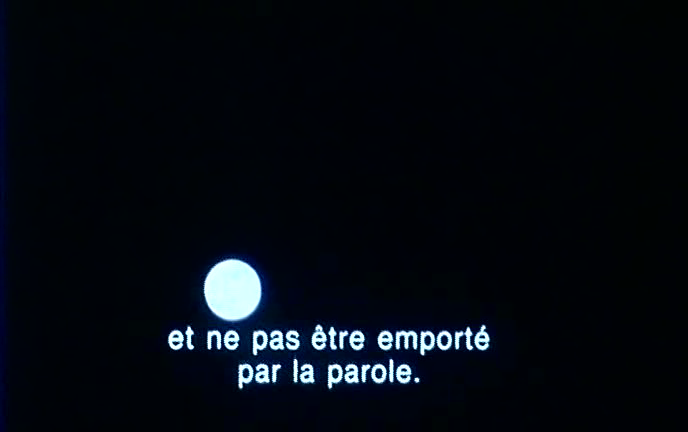
Notes
- Cyril Neyrat, « Les fantômes de Vienne », Paris, Cahiers du Cinéma, n°627, octobre 2007. ↩
- Ghada Sayegh, Images d’après : l’espace-temps de la guerre dans le cinéma au Liban, du « nouveau cinéma libanais » (1975) aux pratiques artistiques contemporaines (de 1990 à nos jours), Thèse de doctorat, Nanterre, Université Paris Ouest Nanterre la Défense, 2013. p. 283. ↩
- Ghassan Salhab interviewé par Heike Hurst, « Rencontre avec Ghassan Salhab : à la recherche d’un territoire », Montreuil, Jeune Cinéma, n°333/334, automne 2010. ↩
- Ghada Sayegh, op. cit., p. 283. ↩
- Alain Philippon, Cahiers du cinéma, n° 347, mai 1983. p. 67 ↩
- Gilles Deleuze, L’Image-Temps, Paris, Éditions de Minuit, 1985. p.303. ↩
