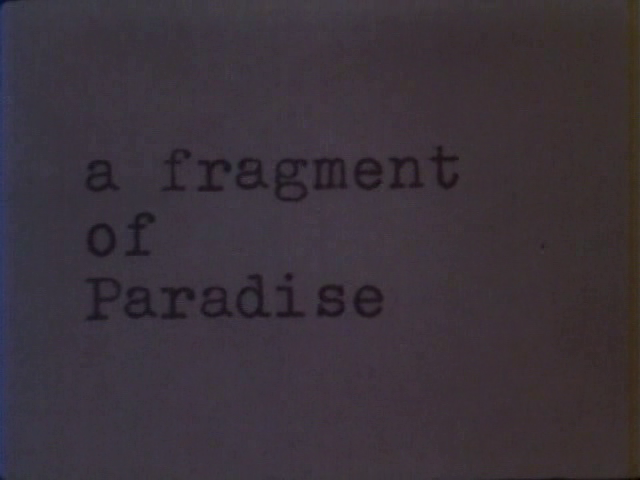Éclats pour Jonas

Octobre 2001, FNC.
Le nom de Jonas Mekas m’était un peu familier, mais je n’avais pas eu l’occasion de voir ses films (leur distribution était quand même très lacunaire à l’époque et je n’avais commencé à m’intéresser au cinéma expérimental que depuis peu). Je vois apparaître à l’horaire du Festival du nouveau cinéma un titre dont la longueur semblait proportionnelle à la durée du film : As I was Moving Ahead Occasionnaly I saw brief Glimpses of Beauty, 288 minutes. Avec les premières notes de l’automne qui piquaient les joues, par un beau matin de dimanche, je m’enfonce dans une salle obscure (la défunte salle Fellini d’Ex-Centris) pour recevoir, en éclaboussures de couleurs, en pizzicati filmiques, ce déferlement d’images sans prétentions, brillantes de trivialité : enfants, fleurs, ville, visage, amis, parc, tout le registre ordinaire du cinéma de Mekas que je découvrais soudain, avec stupeur. Cette voix, unique entre tous, la bouche toujours un peu trop collée au mauvais micro, disait en substance après un moment (je cite de mémoire, n’ayant jamais osé revoir le film depuis, autrement que par extraits), « j’ai essayé d’ordonner toutes ces bobines chronologiquement, mais je me suis vite découragé ; les voici, dans le désordre ». Ponctuée de musiques (toujours, Chopin), de commentaires (« Oh, my friends. Drinking wine with friends in Central Park, etc. »), Mekas fait un (autre) petit bilan de sa vie en images (repassant toute une série des bobines chronologiquement ultérieures à celles de Walden, mais aussi organisées avec un désordre plus jubilatoire). Nous revoyons ces images par ces yeux, lové dans ces éclats du jour, d’une vie toujours suspendue sur le fil du bonheur, mais qui n’est pas sans son lot de gravité (un carton nous répète, à plusieurs moments : « THIS IS A POLITICAL FILM »).



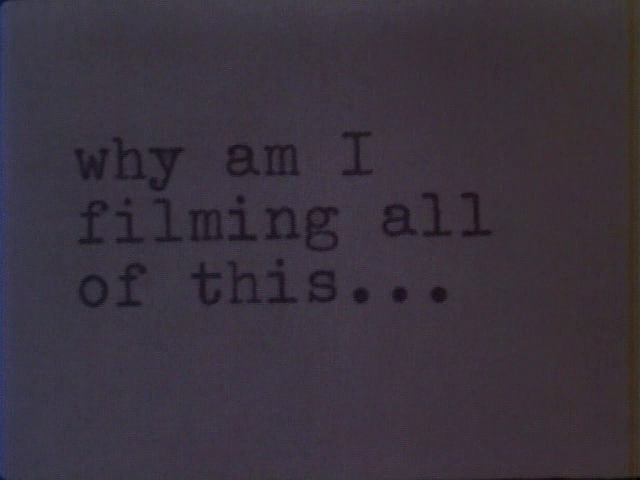
À un moment (au bout de 2h, 2h30, on perd rapidement le fil du temps), s’installe une chorégraphie singulière (que j’ai recomposée mentalement, sans pouvoir être absolument sûr si cela correspond exactement à la scène du film, mais peu importe au fond). Le point de fuite d’une rue de Manhattan dans SoHo débouche sur les tours jumelles. Elle viennent d’apparaître dans la mire des new yorkais. Et la Bolex de Mekas improvise ce qui est dans mon souvenir une petite danse, suivant la forme des tours, de haut en bas, une sorte de révérence de troubadour, comme pour saluer les nouvelles venues, et ce mouvement se confond avec un vol de mouettes qui passaient par là, et que la caméra décide de suivre. Et à quelques reprises dans le film, les tours surgiront en arrière-plan. Personnage de décor massif mais discret, haut perché dans les nuages. Et si, enfoncé dans mon siège ce matin, elles avaient l’effet d’un punctum dramatique et sidérant, c’est que ces deux tours venaient tout juste, il y avait à peine un mois, de disparaître du skyline de New York. Et l’innocence de ces plans aériens, tournoyant autour des tours du World Trade Center, faisait un tel contre-poids à la lourdeur avec laquelle on nous assénait ces jours-là et depuis un mois ces déjà sempiternelles « images du 11 septembre », que ces petits coups de pinceaux de Mekas, simplement prélevés sur le tissu de la vie qui passe, avaient soudain la splendeur poétique que revêt un usage vernaculaire qu’on croyait perdu.





En 2010, Mekas réalisera un magnifique petit film, WTC haikus. Le film consiste en un remontage de toutes les apparitions inopinées de ces tours dans des scènes où, bien souvent, elles n’étaient pas, à première vue, le sujet principal. Des copains bouffent du melon d’eau sur un toit, sa femme et sa fille se promènent sur le trottoir et, comme un spectre de brume bienveillant, les deux tours étirent leur cou à l’horizon, sans que personne, même la caméra, ne la remarque souvent. Elles ne sont qu’un élément décor. Mais par un renversement, de l’ergon et du parergon, provoqué par cette nouvelle redistribution de ces images ordinaires (dont Mekas a souvent eu le tour), soudain, elles deviennent le sujet éblouissant de ces scènes. Comme disait l’autre, « on ne sait jamais ce qu’on filme. »
Mekas savait-il ce qu’il filmait ? Qu’en filmant ces amis, il constituait une archive singulière, unique et précieuse (mais en même temps anodine et triviale), de l’avant-garde de la seconde moitié du XXe siècle et du début du XXIe siècle, mais aussi de sa ville (et de quelques autres) ? Certes parmi les milliers de visages qui peuplent son cinéma, on sera happé par les Yoko Ono et John Lennon, les Timothy Leary, les Warhol, les Kennedys, les Allen Ginsberg, les Velvets, les spectacles du Living, mais il y a aussi toute une galerie d’heureux anonymes qui n’ont été que les sujets provisoires du témoignage de sa présence au monde et qui pour ma part sont tout aussi importants (comme ils l’étaient pour Mekas). On a pu sourire parfois de ce petit côté people de Mekas (son amiité avec les Kennedys, par exemple), mais qui me semble aussitôt s’éclipser aussitôt qu’on accepte de se laisser emporter par le courant de ses films.
Views from the Avant-Garde, New York, 2011.
Depuis trois jours baigné d’images de tout acabit. Ça commence à 9h et ça se termine souvent tard dans la nuit. Depuis le début du festival, une présence auratique – avec son légendaire chapeau et sa démarche claudicante — rôde, entre et sort des salles, s’y renfonce, entouré de sa petite garde rapprochée. Un soir, il doit être 22h, nous le voyons qui émerge d’une ultime séance. Quelqu’un lui demande : « Still here, Jonas ? », à quoi il répondra, de cette voix un peu éraillée et avec cet accent qui n’a jamais quitté sa langue, « Yes. Not bored enough yet ».
Mekas est mort à 96 ans. À l’annonce de son décès, cette phrase a soudain surgi dans mon esprit. Oui, je pense qu’il a fini par s’éteindre, en ayant épuisé sa capacité à supporter l’ennui du monde, non sans en avoir au préalable extirpé toutes les ressources de beauté, de lumière et de joie, dont il a fait la substance vibrante de ses films.
Caraquet, 2010.
J’ai découvert Walden, une première fois (car chaque nouveau visionnement, chaque projection est une première fois) en vacances, à Caraquet, au Nouveau-Brunswick, en DVD (la belle édition de Re :voir). Il y a longtemps, me semble-t-il. Il m’était venu, à cette occasion, l’idée de rédiger un petit texte sur les images de vacances (ou les vacances du cinéphile), qui contenait entre autre ceci, que je me permets de retrancrire :
« Les vacances devraient ressembler au film-journal au long cours de Mekas, Diaries, Notes and Sketches also known as Walden (1969), ou plutôt, Walden — le film, mais aussi le lieu et le temps paradisiaque que ce nom pointe chez Mekas — c’est un peu les vacances, mieux, le nom du regard que l’on adopte, qu’on aimerait posséder en vacances : illuminé, fasciné, reposé, enfantin, joyeux… Ce regard, c’est toujours, il nous semble, le point de vue de Mekas sur les choses (qui d’autre s’extasierait devant une livraison de charbon à New York au mois de novembre ? Un début d’orage ? un peu comme, en vacances, on s’extasie devant deux vaches dans un pré). Walden c’est des bouts de paradis, de ce paradis toujours déjà perdu, mais retrouvé, par minuscules bouffées, en petits lambeaux de films, arrachés au fil du temps [peut-être parce qu’il présuppose des pelletées immenses de choses oubliées]. Le paradis, c’est aussi la détresse de jadis (le froid, New York, la solitude, la nostalgie) que l’on perçoit à travers le prisme du présent, celui du Mekas-monteur-mémorialiste de sa propre vie, et qui se trouve anoblie par le passage du temps (j’ai survécu à tout ça, cela, c’est ma vie, ma demeure). Mekas nous dit : « ma vie, qui en vaut une autre, est, comme la tienne, un âge d’or, si tu prends le temps de la regarder. » Et Walden c’est aussi l’utopie d’un âge d’or de l’underground new yorkais, où se côtoient avec bonheur Brakhage, Ginsberg, Warhol, Ken et Flo Jacobs, Conrad, Nico, Lou Reed, etc. Les mariages s’enchaînent sur les fêtes, sur les naissances, les vacances, même les bureaux du Village Voice, semblent vacants, sans le bourdonnement de l’activité qui devait y régner… Walden, c’est un peu les vacances d’un cinéaste, ou encore quelque chose comme « l’underground américain s’amuse » (même si on sait à quel point, dans les coulisses, les temps étaient difficiles). Cette joie — même menteuse, même paradoxalement amnésique —, cette jubilation du filmeur devant son monde immédiat, cet état d’enfance, c’est celui, retrouvé, d’Auguste Lumière donnant le déjeuner à son bébé (Walden est d’ailleurs dédié aux frères Lumière).
Le cinéma aurait ainsi en partage avec le temps des vacances un même état d’enfance, quelque chose qui aurait peut-être à voir avec les origines du cinéma… C’est le type de « leçons de choses » que le cinéphile en vacances se fait tranquillement, en regardant Walden, emmitouflé sous une couverture, en sachant que, pas très loin, un soleil se couche sur un horizon de mer et de sable. »
Après avoir relu ces lignes écrites il y a longtemps, en pensant à la disparition de Mekas, il m’est revenu la dernière phrase de la Supplique de Brassens :
« Pauvres rois, pharaons! Pauvre Napoléon!
Pauvres grands disparus gisant au Panthéon!
Pauvres cendres de conséquence!
Vous envierez un peu l’éternel estivant,
Qui fait du pédalo sur la vague en rêvant,
Qui passe sa mort en vacances… »
On ne peut que se réjouir d’une telle définition du paradis. Mekas n’est-il pas, à son tour, parti retrouver dans l’éternité ses « brefs éclats de beauté », dérivant en pédalo sur l’étang dans Central Park, soustrait à la cohue du monde, les yeux éblouis par le scintillement d’un soleil oblique, lançant des diamants de couleurs à celui qui n’aura cessé, toute sa vie, as he was moving ahead, de saisir l’occasion en en cueillant quelques éclats.