Trois souvenirs de la jeunesse (du cinéma)

Hiver 2001. J’ai à peine plus de vingt ans, et pour quelques années encore, je vis cette situation qu’ont si joliment décrite les cinéphiles qui ont grandi loin des grandes villes dans les années 1950 ou 1960 : voir les films était difficile alors, et il fallait donc se déplacer, quand on le pouvait, ou le plus souvent, attendre qu’une occasion se présente dans une salle de son quartier, ou plus tard à la télévision, ce pis-aller qui rendit pourtant bien des services aux amoureux d’images en mal de découvertes. Patienter, guetter : la cinéphilie fut ainsi, longtemps, une activité de chasseur-cueilleur. Et bien souvent, le plaisir du film était à la mesure de l’attente qu’il avait suscité.
À défaut et pour combler l’attente, restaient donc les livres, les revues, les photographies. Je n’avais pas internet, qui dans ma tête et pour quelques temps encore, n’existait quasiment pas ; et comme beaucoup de gens, j’ai donc beaucoup rêvé les films, sur le papier, avant de les voir. Je croisais souvent le nom de ce cinéaste et poète, Jonas Mekas, mais j’étais surtout intrigué par les rares images de ses journaux filmés, petites poignées de photogrammes pressés les uns contre les autres, généralement disposés à la verticale, tous différents. Éclats d’images, brusques agencements de formes et de mémoire dont j’ignorais encore qu’ils seraient bientôt l’emblème du cinéma de Mekas, tant de fois mentionnés par lui et par tant d’autres. Une série de battements du cœur et du regard : Glimpses.
Le marché de l’édition vidéo était alors en pleine expansion, et quelques rares films expérimentaux commençaient à être disponibles, en VHS, notamment grâce au travail des éditions Re:Voir. Parmi eux il y avait Diaries, Notes and Sketches (also know as Walden), mais que tout le monde appelle Walden, peut-être pour le mêler et le confondre définitivement avec le grand ouvrage de Thoreau. Sitôt la VHS disponible à la bibliothèque de mon université, je m’en suis emparé sur le champ. J’ai emprunté à un ami un vidéoprojecteur, massif et très lourd, tombé d’on ne sait trop quel camion, et organisé pour ceux qui le voulaient une projection sauvage dans mon appartement. Là, sur un drap tendu à la va-vite entre une pile de vaisselle sale et un tas de livres, m’est advenu un enchantement comme j’en ai peu connu depuis (j’en ai eu quelques-uns, tout de même). Sur l’écran de fortune, ce n’était pas seulement la puissance des souvenirs et l’intensité de la mélancolie du cinéaste qui me frappaient en plein visage – sur ces registres, il en faut souvent peu aux jeunes gens pour être éblouis –, mais surtout les formes au travers desquelles elles s’énonçaient : un mouvement paradoxal, à la fois heurté et limpide, brutal et infiniment tendre, fait d’immobilités qui avancent, et déroulent un grand récit intime, une pyrotechnie modeste, un « festival d’affects 1 », pour reprendre l’indépassable formule de Roland Barthes. La rhétorique visuelle du cinéma expérimental m’était un peu connue, et ce qui m’a surpris alors ce n’était pas tant la vitesse, le choc ou l’abstraction, mais plutôt la façon dont cette syntaxe traduisait une urgence vitale à filmer, à écouter et à sentir, pour retenir quelque chose du monde tout en en célébrant la beauté. Pour l’une des premières fois peut-être, je percevais l’écheveau complexe sur lequel un cinéaste tissait un fil ténu, fait d’exigence et de sensibilité, et qui ne ressemblait à aucun autre, parce qu’il ne racontait rien, n’allait nulle part et, au fond, n’avait rien à dire. Une forme tout à la fois spectaculaire et pudique, évidente et sophistiquée, une contradiction vivante, c’est-à-dire le regard et la voix d’un homme me donnant et le sens, et le grain. Mes invités partis, mais le drap toujours tendu dans la pièce, le lendemain j’ai regardé Walden une deuxième fois.
Décembre 2011. Adulte à présent, j’ai vu en dix années d’autres films de Jonas Mekas, pour l’essentiel les grandes fresques de ses journaux filmés avec sa Bolex 16mm. J’ai pris le train avec lui pour rendre visite à Stan Brakhage, j’ai pris un petit déjeuner au lit avec John Lennon et Yoko Ono, j’ai donné un bout de croissant à un chat à la terrasse d’un bar de Marseille, j’ai arpenté les rues avec les immigrés lithuaniens dans le Brooklyn d’après-guerre. J’ai rendu visite aux enfants de John et Jackie Kennedy, et compté les secondes seul dans le désert. Et puis je me suis retrouvé à New York, pour de bon cette fois-ci, pour interviewer un des compagnons de route de Mekas, Ken Jacobs, un autre très grand cinéaste. Le lendemain j’avais repéré une projection d’un film de Mekas que je ne connaissais pas, dans un coin sur les bords de la rivière Hudson. Comme un touriste, naïf, en tout cas imprévoyant, je n’avais pas compté avec la neige, qui s’est mise à tomber très fort et très vite sur mon trajet. Et c’est trempé jusqu’aux os, frigorifié, que je suis entré dans cet entrepôt situé un peu loin de tout, où l’on projetait un film réalisé par Mekas en 1990 à l’invitation d’une chaîne de télévision française, intitulé Mob of Angels : a Baptism.
En arrivant dans la salle, espace industriel reconverti, vaste et haute de plafond, j’étais le seul spectateur. Et j’allais rester le seul spectateur tout au long de la séance, parce que personne n’avait pu ou voulu sortir sous la neige, un samedi de décembre, en début d’après-midi. Solitude amusée, et compensée aussi par l’impressionnant système de chauffage de cet ancien entrepôt qui m’a vite fait ôter veste, chaussures, chaussettes, et allonger mes jambes pour me sécher les pieds à mon aise, en regardant ce film qui allait changer assez radicalement l’idée que je me faisais du cinéma de Jonas Mekas.

Mob of Angels : a Baptism (Jonas Mekas)
Contrairement aux formes d’organisation très complexes qui président aux journaux filmés en 16mm, Mob of Angels : a Baptism peut être décrit assez simplement. Le film débute dans la rue, au pied d’un immeuble dans lequel Mekas entre et prend l’ascenseur, pour déboucher dans un vaste appartement où un groupe de femmes vêtues de blanc accompagne, par des chants et des danses, le baptême d’un enfant selon des rites tibétains. Pendant près d’une heure, le cinéaste enregistre en une seule prise ce rituel dans lequel il nous place in media res. Tantôt de loin, tantôt de très près, il alterne gros plans sur les visages concentrés, sinon extatiques, et circulations d’un corps à l’autre, reliés par la musique, avant de quitter l’appartement tandis que la cérémonie se poursuit pour reprendre l’ascenseur en sens inverse, retrouver la rue et, tout aussi simplement que brutalement, mettre fin au film en coupant la caméra.
Pour moi qui connaissait suffisamment le cinéma de Mekas pour m’attendre à y retrouver toujours un certain nombre de motifs – plans brefs, giclées d’images, explosions lumineuses, commentaires poétiques en voix over, montages sonores à la beauté rêche –, mais pas assez pour savoir qu’il ne s’en était pas tenu là, le choc est conséquent. Et ce qui m’impressionne alors n’est pas tant qu’il ait délaissé le mécanisme d’horlogerie de la Bolex pour le velouté imprécis de la vidéo, ni même l’instant pour la durée ; mais plutôt qu’il ait troqué un tremblé contre un autre. Et que ce faisant, et comme l’air de rien, il ait ainsi remis en jeu et de fond en comble, à 68 ans, les fondations de son travail de cinéaste. Qu’il se soit forcé à oublier – sans l’oublier tout à fait – tout ce qu’il avait longuement appris, les habitudes, les gestes, le poids et le fonctionnement de la caméra à travers laquelle il avait construit son rapport au monde, pour tout réinventer. C’est donc un peu abruti, mais pleinement content de cette leçon de jeunesse, que je suis ressorti de l’entrepôt en cet après-midi désormais un peu plus avancé. Dehors, la neige n’avait pas fondu, mais elle luisait déjà sous un soleil pâle, et mes pieds de nouveau secs pouvaient me porter ailleurs. Un écran les avaient réchauffés. Une fois dehors, je pense sans pouvoir m’en détacher à cette image d’un de ses films (peut-être Lost Lost Lost), aperçue un jour dans un livre, où l’on voyait une rue toute enneigée avec au premier plan ce panneau : « Spring Street ».
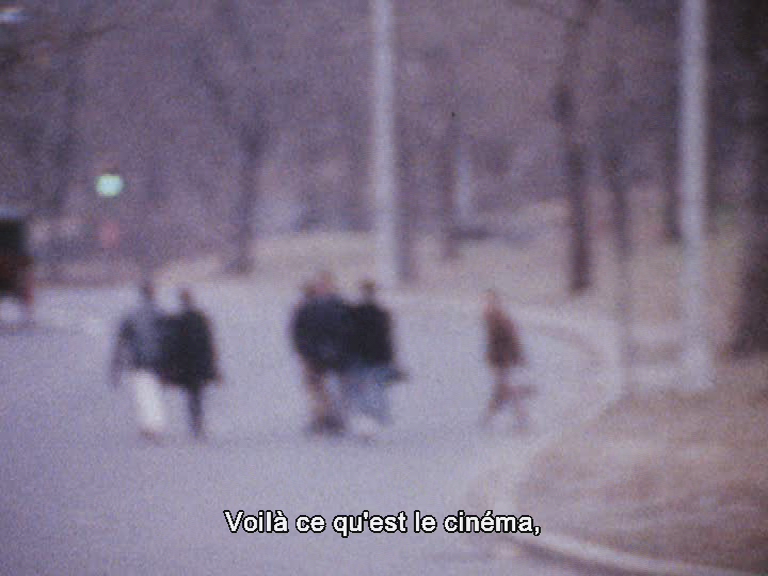





Juin 2065. Je suis à présent un vieil homme, qui a vécu pas mal de choses, en regrette certaines, mais en chérit beaucoup. Je suis un homme âgé qui ne finit plus ses journées mais les commence, désormais, au petit jour, à l’heure où se tient la conférence des oiseaux. Comme tous les vieux, me baladant les mains dans le dos, je joue et rejoue avec mes souvenirs, que j’enjolive chaque fois un peu plus, sans me laisser aller pour autant au constat, semble-t-il général, que le monde est devenu un endroit assez mal famé. Parfois je pense à ce cinéaste dont le nom commence à m’échapper, Jonas quelque chose. Je me souviens à quel point il a compté pour moi, et l’épaisseur qu’a pris son œuvre avec le temps, jusqu’à sa mort (en quelle année était-ce, déjà ?) et après elle, jusqu’à ce que, comme tout le monde, il tombe dans l’oubli, et qu’on commence à lui foutre un peu la paix.
Ce matin de juin, je me rappelle les moments simples qui constellaient ses films, des moments que j’ai quelquefois trouvé banals quand je les ai vus la première fois, parce que donner un croissant à un chat, regarder le soleil couchant depuis la vitre d’un train ou observer des enfants qui jouent, ça ne me semblait pas tellement extraordinaire en soi. Et pourtant, quand j’y repense aujourd’hui, à ces petits moments coincés dans de touts petits bouts d’images, je les trouve charmants, tout chargés qu’ils sont de ce qui me parle, à la fin de ma vie : la nostalgie des voyages, des rencontres hasardeuses, de l’errance, du sentiment délicieux – et douloureux – d’être dans le monde. Je crois me rappeler qu’il les montrait, et les montait, de façon unique, incomparable, virevoltante et douce ; qu’il avait cette manière bien à lui de partager sa chronique, celle d’un homme qui a traversé l’existence en dansant, avec une caméra en main. À tel point qu’un jour, après une projection, je crois avoir vu un de mes étudiants sortir de la salle avec les yeux rougis d’avoir pleuré. Et je me souviens l’avoir brièvement envié, puis m’être aussitôt reproché cette impulsion idiote, parce qu’à vingt ans on est peut-être plus triste et seul et désemparé qu’à n’importe quel autre âge de la vie, et que la sensibilité peut être aussi un fardeau. Mais tout ça s’efface, comme le reste, et d’ailleurs je crois qu’il est temps que je rentre : les oiseaux dehors ont terminé leur conciliabule, et je voudrais que Caroline trouve du café chaud quand elle va se lever. Quand l’été arrive, elle aime le prendre dehors, tant que sur les fleurs la rosée s’accroche.

Notes
- Roland Barthes, « En sortant du cinéma », Communications, no 23, 1975, p. 104. ↩
