Tracé d’un geste. Entretien avec Erin Weisgerber
Le 9 juin 2022, dans le cadre du Symposium de cinéma expérimental « créer, conserver, performer » a eu lieu, à la Cinémathèque québécoise, un programme double composé de films sur support 35 mm, réalisés par des membres du collectif montréalais Double Négatif : earthearthearth de Daïchi Saïto et Dans les cieux et sur la terre de Erin Weisgerber. Or, si les écrits sur Daïchi Saïto pullulent, le nom d’Erin Weisgerber est moins connu. Pour rectifier le tir, je me suis entretenu avec la cinéaste la veille de son départ pour la Bulgarie où elle se rendait assister Ralitsa Doncheva sur le tournage de son prochain film.
Erin Weisgerber est, à mon sens, l’une des plasticiennes les plus talentueuses du cinéma montréalais actuel. Maniant les puissances spécifiques du cinéma photochimique, elle crée des films au sujet mouvant, à la frontière entre l’abstraction et la figuration. Weisgerber fait également partie de Jerusalem In My Heart, une formation de performance audiovisuelle fondée par le musicien et producteur Radwan Ghazi Moumneh. Elle est la quatrième artiste à assumer la partie visuelle du projet, après Karl Lemieux, Malena Szlam et Charles-André Coderre.
Philippe Bouchard-Cholette (P.B.C.) : Lorsque j’ai assisté à la programmation dont tu faisais partie avec Richard Kerr à la lumière collective 1 , je voulais te poser une question naïve : comment devient-on cinéaste expérimental ?
Erin Weisgerber (E.W.) : Voyons voir. Je n’ai jamais été une grande cinéphile. J’étais beaucoup plus intéressée par la musique et la littérature. Quand j’ai fait mon baccalauréat en philosophie et littérature à l’Université d’Alberta, à Edmonton, j’ai dû suivre certains cours d’art. On nous permettait de suivre un cours de cinéma en beaux-arts. J’ai donc, pendant un an, suivi le cursus en études cinématographiques au titre ambitieux « World Cinema and Film Theory » donné par Jerry White. Il excellait à relier les films à tout ce qui se passait textuellement autour d’eux, à d’autres mouvements artistiques, à la politique. Ce cours m’a permis d’ouvrir ma compréhension de ce que le cinéma pouvait faire. Je suis de cette façon devenue amoureuse du cinéma comme médium. Puis, j’ai commencé à faire un peu de radio à la station CJSR, à réfléchir aux façons dont les idées pouvaient être canalisées de manière non écrite. J’étais surtout à l’aise avec la rédaction académique à ce moment-là, mais je ne savais pas du tout comment travailler avec le son, comment travailler avec l’image, comment communiquer un sentiment ou une pensée avec ces médias.
J’ai demandé à Jerry White comment je pouvais m’initier à la pratique du cinéma. Il m’a dirigé vers la coopérative Film and Video Arts Society (FAVA), étant donné qu’il n’y a pas d’école de cinéma à Edmonton. Je m’y suis inscrite — à un défi super 8 — et j’ai tourné mon premier et dernier rouleau de Kodachrome. Le défi avait été créé quand le Kodachrome venait d’être discontinué. On m’a dit que c’était un type de film très spécial, mais je n’avais aucune idée de ce que c’était. C’était ma première expérience de tournage. J’ai appris à utiliser un posemètre, mis la main sur une caméra et filmé. La personne qui a donné cet atelier était le directeur photo aAron Munson. C’est aussi une figure importante du cinéma d’art à Edmonton. J’avais auparavant vu des œuvres de Maya Deren et de Stan Brakhage ou des films d’animation de l’ONF à la télévision, mais c’était la première fois que je rencontrais quelqu’un qui faisait ce genre de films. Il effectuait beaucoup d’effets spéciaux in-camera 2 et de manipulations directement sur la pellicule.
C’était comme si une ampoule s’était allumée. J’ai compris qu’il était possible de créer un film sans avoir besoin d’embaucher des acteurs, sans avoir besoin de payer toute une équipe, de tourner sans scénario. Qu’il était possible pour une seule et unique personne, munie d’une caméra et d’un rouleau de film, de faire quelque chose et de transmettre de la sorte des sentiments et des idées.
P.B.C. : À Montréal, tu as rencontré les cinéastes du collectif Double Négatif, dont tu es devenue membre. Comment s’est produite cette rencontre ?
E.W. : Une de mes amies avait vu un programme de Double Négatif à Victoria. Elle m’a dit de garder un œil sur leurs activités lorsque j’habiterais Montréal. Des installations du collectif étaient exposées, à Montréal, dans une galerie qui n’existe plus, CTRL Lab. Eduardo Menz, qui est membre de Double Négatif, était l’un des commissaires de cette galerie. J’ai vu l’exposition et j’ai adoré. Je me souviens d’être allée voir des spectacles de performance et de musique, avec Karl Lemieux par exemple, et de voir Malena Szlam performer avec Jerusalem In My Heart. Quand Double Négatif organisait des projections, je m’assurais d’y aller.
Je crois que j’ai rencontré personnellement Daïchi Saïto et Malena Szlam quand ils ont commencé à programmer pour Cinema Space. À l’époque, j’étais bénévole à CKUT Radio, la station communautaire de McGill. Il y avait une émission sur le cinéma à laquelle je collaborais parfois. Ils cherchaient des gens pour faire des entretiens avec les cinéastes qu’ils invitaient, alors je les ai contactés. J’ai commencé à profiter de toutes les occasions possibles pour interviewer des cinéastes. Je me souviens m’être entretenue avec Janie Geiser, Tomonari Nishikawa et Emmanuel Lefrant, parmi d’autres.
Je suis assez timide. Si je n’avais pas été engagée pour le faire, je ne me serais pas sentie à l’aise d’aller voir un cinéaste et de lui poser des questions. Je n’aurais même pas levé la main à la fin d’une projection. C’était donc l’occasion de regarder des films, de prendre le temps d’effectuer des recherches sur les pratiques concernées, puis de réfléchir attentivement à ce dont je voulais parler avec les artistes. C’est ainsi que Daïchi et Malena ont appris à me connaître. Puis je suis allée à l’école de cinéma, à Concordia. C’était, je pense, Malena qui a insisté pour que je rejoigne le collectif par la suite.


Dans les cieux et sur la terre (2022)
P.B.C. : La plupart, pour ne pas dire tous tes films, sont tournés avec une caméra Bolex 16 mm, un instrument avec lequel tu es évidemment très habile. Quand tu prépares un film, l’imagines-tu selon le langage de la Bolex ?
E.W. : Non, je ne pense pas, bien que j’imagine généralement mes projets à travers le langage et les possibilités du cinéma analogique. Être en mesure de développer à la main, de re-photographier les images à l’aide d’une tireuse optique, de travailler directement sur le film, ce sont des choses qui me viennent à l’esprit très rapidement.
P.B.C. : Et au-delà des aspects techniques de ta pratique ? Prenons l’exemple de ton dernier film, Dans les cieux et sur la terre (2022). Pourquoi filmer une église ? Le sacré est-il quelque chose qui t’intéresse en soi, ou seulement dans sa relation avec le cinéma ?
E.W. : Non, ce n’est pas le rapport entre le sacré et le cinéma qui m’intéresse. Quelqu’un d’autre m’a fait part d’une piste d’interprétation similaire. Certaines personnes considèrent le cinéma comme quelque chose de sacré, mais je ne sais pas si je fais partie de ces gens-là.
P.B.C. : Mais le cinéma permet une expérience du sacré.
E.W. : Oui, c’est certainement vrai. L’église qui figure dans le film est Saint-L’Enfant-Jésus-du-Mile-End, sur Saint-Laurent, entre Saint-Joseph et Laurier. Le choix de cette église comme sujet a une histoire, mais il a surtout à voir avec mes premières expériences à Montréal. Bien sûr, nous n’avons pas ce genre d’architecture là d’où je viens. C’était donc représentatif de Montréal à mes yeux. Quand je suis venue à Montréal pour la première fois, juste pour un été, avant d’emménager ici de façon permanente, j’ai loué un appartement dans le Ghetto McGill. Je me souviens de mes déplacements vers le nord, en direction de la Casa del Popolo, par exemple, pour y voir des spectacles. C’est alors que j’apercevais cette église. Finalement, c’est le quartier où j’ai emménagé, le Mile-End. L’église représentait en quelque sorte le quartier et la vie que je voulais y vivre, ce que j’espérais devenir après avoir quitté l’endroit où j’ai grandi. Dans les cieux et sur la terre repose donc sur une lecture idiosyncrasique et personnelle de ce lieu. Plus tard, j’ai appris que c’est l’un des premiers bâtiments qui a été édifié dans le Mile-End. Le quartier s’est construit autour. Il y avait déjà, je pense, Saint-Louis-du-Mile-End, qui était un peu plus à l’est, mais ce bâtiment a été construit comme une sorte de projet immobilier. C’est une relation spécifique à mon expérience de la ville que j’entretiens avec cette église, que je trouve à la fois extrêmement belle, mais aussi effrayante et intimidante.
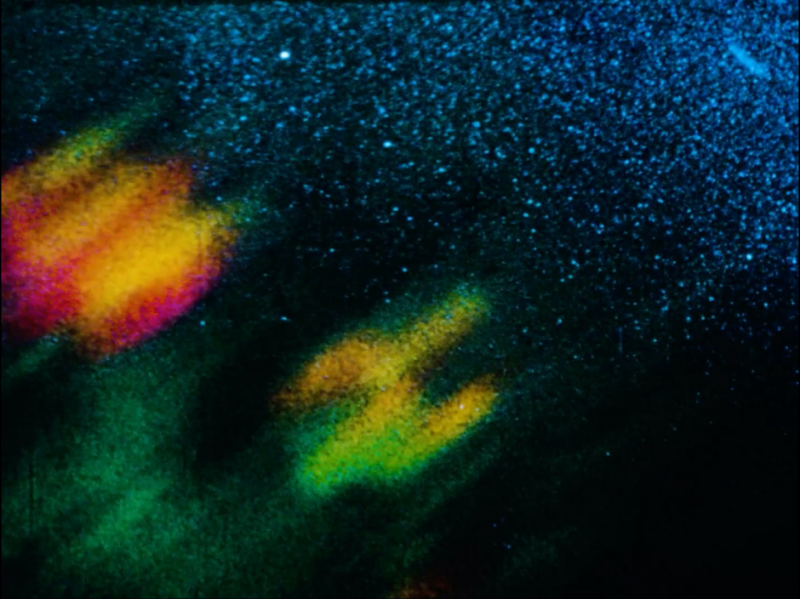
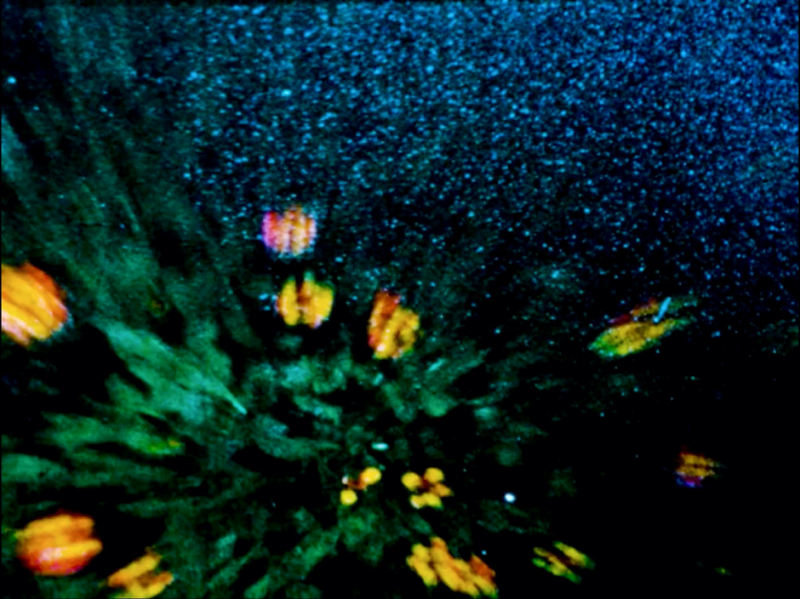
From Which Even the Memory of the Darkness Has Vanished (2018)
P.B.C. : Ce film poursuit les explorations plastiques que tu as initiées dans From Which Even the Memory of the Darkness Has Vanished (2018). Est-il juste de voir ton film de 2018 comme une esquisse pour Dans les cieux ?
E.W. : Oui, je pense qu’il est juste de voir le premier film comme une esquisse du second. J’ai tourné le film sur environ sept ans. Une partie de la raison pour laquelle il m’a fallu si longtemps pour l’achever, après l’avoir commencé à Concordia, est que j’ai fait d’autres films pendant cette période. Après avoir obtenu mon diplôme, je travaillais dans une maison de location et à devenir assistante à la caméra syndiquée, ce qui me laissait peu de temps ou d’argent pour faire ce film. Il m’a fallu le faire entre les mailles du filet, avec des caméras empruntées, pendant une longue période. Ainsi, chacune des quatre sections de Memory of the Darkness est basée sur une sorte d’expérience effectuée ou sur une série de rushes tournés au cours d’une année particulière.
Une grande partie de ce matériel n’a pas été utilisé pour Dans les cieux, puisqu’il était davantage lié à une recherche esthétique préparatoire. Je trouvais ce matériel quand même intéressant et je voulais en garder une trace, aussi parce qu’il représentait tellement d’années de travail. J’ai donc monté un film en quatre parties, plus ou moins toutes composées d’images créées in-camera. À quelques endroits, j’ai enlevé des passages qui ne fonctionnaient pas, ou j’ai ralenti les images à l’aide d’une tireuse optique. Mais sinon, ce sont des bandes de film sorties telles quelles de la caméra, re-photographiées par moments sur du film inversé, tel le document qui témoigne de l’instant où elles ont été tournées. Au départ, c’était un projet modulaire, alors j’en avais différentes versions. From Which Even the Memory of the Darkness Has Vanished est le nom que j’ai donné à la version plus ou moins définitive du projet. À une occasion, j’ai montré le film dans une version différente. Je tenais à ce que le film soit muet. Je voulais que ce soit brut, un simple document de ces moments de recherche.
P.B.C. : En parlant de son, tu m’apprends que tu as fait de la radio. Ça met en lumière l’importance du son dans tes autres films. Je pense notamment à Dans les cieux et à Traces (2014). Ils ont tous deux des bandes sonores riches et détaillées. C’est intéressant parce que dans l’histoire du cinéma expérimental, le son a souvent été subordonné à l’image ou carrément exclu. Peux-tu me parler des bandes sonores de ces deux films ?
E.W. : Je vais commencer par Traces. Il fut un temps où je me promenais toujours avec un très petit enregistreur sonore. Je le portais à la main avec des écouteurs. Les gens pensaient probablement que j’écoutais de la musique alors que j’étais en train d’enregistrer. C’est quelque chose que je faisais en ville ou quand j’étais en vacances. J’enregistrais beaucoup et je cataloguais tout. La majorité du travail sonore pour Traces a été construit à partir de ces sons que je collectionnais depuis plusieurs années.
P.B.C. : Tu as fait toi-même le montage sonore ?
E.W. : J’ai fait le son pour Traces. En fait, maintenant que je me rappelle, une partie de la bande-son est venue d’une pièce sonore quadriphonique que j’avais faite auparavant. Cela m’a donné un point de départ. C’était très intuitif, comme une composition audiovisuelle, où les deux éléments sont partenaires. L’image est peut-être au premier plan, mais le son est devenu une mise en œuvre autour d’elle.


Traces (2014)
P.B.C. : Dans le cas de Dans les cieux, le son est plus figuratif. On entend le frottement des pierres, le tintement des cloches. Quel a été le processus pour créer le son de ce film ?
E.W. : J’ai fait appel à une artiste sonore, Andrea-Jane Cornell, avec qui j’avais travaillé à CKUT. Je connaissais son travail d’artiste sonore, mais je ne savais pas qu’elle travaillait dans le cinéma et la vidéo. J’ai vu le film de Mike Rollo Farewell Transmission (2017), pour lequel Andrea-Jane avait fait le son. J’ai réalisé qu’elle avait aussi un sens aigu de la manipulation du son avec les images. Je l’ai contactée, et elle m’a envoyé des liens vers des œuvres réalisées avec Sabrina Ratté et Allison Moore, œuvres que j’ai adorées. Comme j’avais déjà une amitié et une relation de travail avec elle, je lui ai demandé si elle était prête à collaborer avec moi sur ce nouveau film. Nous avons alors beaucoup parlé d’idées pour le son, de ce que je cherchais. Je pense que je lui ai envoyé des exemples de choses que j’aimais, et elle me proposait également des idées. Puis elle a commencé à collecter des sons et à les téléverser dans un dossier en ligne d’où je pouvais les écouter pendant que je montais les images du film.
J’avais initialement prévu un réel va-et-vient entre le montage des images et la conception sonore, mais avec notre emploi du temps, ça n’a pas marché. On s’est retrouvé au final avec un flux de travail plus traditionnel, soit le picture lock suivi de la conception sonore. Parce qu’elle habite aux États-Unis, je me suis procuré le logiciel qu’elle utilisait, elle m’a envoyé le dossier du projet et à partir de là, je m’adressais à elle si je trouvais qu’un certain son était trop fort ou trop faible, si un son me déplaisait ou si je souhaitais qu’un autre soit utilisé davantage, etc. Deux ou trois fois, elle est venue à Montréal avec ses haut-parleurs de studio. Nous avons eu quelques sessions de mixage où nous avons vraiment retravaillé les choses, toujours en fonction du modèle qu’elle proposait, mais en le peaufinant selon ma nature pointilleuse. Elle a été extrêmement patiente, méticuleuse et généreuse.
P.B.C. : Tu fais présentement partie du duo Jerusalem In My Heart, au sein duquel tu fais des performances multi-projecteurs en direct avec des boucles de film 16 mm. Comment as-tu relevé ce défi ? Comment Radwan et toi avez paramétré cette collaboration ?
E.W. : J’ai eu de la chance parce que je n’avais pas de pratique de performance avant de travailler avec Radwan, même si j’ai toujours été très intéressée par sa dimension « directe ». C’est une très bonne pratique à avoir en parallèle d’une pratique cinématographique plus traditionnelle, à un seul canal 3 , où la chose devient en quelque sorte figée une fois que le film est monté. Par opposition, la performance en direct est beaucoup plus dynamique, le travail varie énormément. Je suis sur place, j’interagis avec le public et avec d’autres artistes. C’est bien de sortir un peu de la chambre noire.
Quand j’ai commencé à travailler avec Radwan, j’ai repris la formule de Charles-André Coderre parce que le groupe avait quelques spectacles planifiés au moment où il a quitté le projet. J’ai étudié les vidéos du dernier set, disponibles sur Internet, et j’ai appris comment Charles-André jouait avec les bandes-images, à quoi ressemblait la set list. Il m’a ensuite remis ses boîtes de film et j’ai installé des projecteurs dans le studio. C’était une très belle occasion d’apprendre à travailler avec les projecteurs dans un contexte de performance. Essayer de ne pas déchiqueter les boucles de film, tenter d’effectuer les manipulations rapidement. Je jouais le son du spectacle très fort dans mon casque d’écoute, parce que le son des projecteurs était très fort. Je répétais la performance, encore et encore.
P.B.C. : Tu as recommencé à zéro pour Qalaq (2021), le quatrième album de Jerusalem In My Heart.
E.W. : Oui, exactement. Faire des spectacles m’a donné l’occasion de me familiariser avec la vie de tournée, à voyager avec des films, à apprendre l’aspect physique de la performance et, bien sûr, à connaître Radwan. Nous étions de parfaits étrangers avant cela. Nous nous étions rencontrés à travers la communauté, mais nous ne nous connaissions pas vraiment.
Nous avons une étrange façon de travailler ensemble, nous n’avons pas tendance à nous asseoir et à planifier ce que nous allons faire, c’est très ouvert. Je lui envoie des images, des clips ou des films. Par exemple, pendant qu’il composait la musique de Qalaq, il avait accroché les images que j’avais tournées pour « Qalouli 4 » sur les murs de son studio. Et vice-versa, il m’envoie sa musique et des photos qui l’inspirent. Pour Qalaq, nous avons utilisé des images de Tony Elieh, et je savais qu’elles se retrouveraient dans la pochette de l’album 5 . J’ai donc demandé si nous pouvions les utiliser aussi au sein de la performance. Nous avons contacté Tony et il a accepté. Bien sûr, il a été rémunéré pour sa contribution au projet. Je savais à quel point ces images étaient liées aux thèmes de l’album et à ce qui préoccupait Radwan à l’époque. Il était important d’ancrer le visuel du spectacle d’une manière littérale dans la situation au Liban et à Beyrouth.
P.B.C. : Le format du spectacle est-il définitif ou évolue-t-il d’une performance à l’autre ?
E.W. : En ce moment, le format est très semblable d’une performance à l’autre. Nous travaillons avec une liste d’éléments. Il y a des moments très maîtrisés qui, pour cette raison, sont conservés, plus ou moins, d’un soir à l’autre, mais à travers eux, nous essayons tout de même de nous donner de l’espace pour des moments d’improvisation structurée. Par exemple, Radwan peut jouer un solo de buzuq autour d’un certain thème et à partir d’une collection d’images que j’ai agencées, j’improvise à ses côtés. Si les choses sont toutes prévues d’avance, je pense qu’elles deviennent un peu ennuyantes pour nous. Je travaille habituellement avec un peu plus de matériel que nécessaire afin d’avoir une certaine variété à l’intérieur d’une section donnée et d’avoir la possibilité de briser le confort. Je peux également décider de retravailler la façon dont j’utilise les projecteurs, de les déplacer, de recadrer les projections pendant le spectacle. C’est satisfaisant de découvrir des variations imprévues, de sentir quelque chose survenir et de réaliser que cette chose est plus intéressante que ce que je faisais déjà.
Cet entretien a été traduit de l’anglais par Philippe Bouchard Cholette.
Notes
- Le programme en question a eu lieu le 26 octobre 2021, dans le cadre de la série « IN SITU ». ↩
- La mécanique de certaines caméras analogiques permet de créer des effets spéciaux à même la caméra. Weisgerber, par exemple, utilise souvent le mécanisme de rembobinage manuel de sa caméra Bolex pour réaliser des expositions multiples. Les effets spéciaux in-camera apparaissent donc sur le négatif original et sont à distinguer de ceux créés en post-production. En français, l’expression in-camera peut se traduire par « tourné-monté », une technique de réalisation consistant à tourner les scènes d’un film chronologiquement, en une seule prise de vue par plan. L’expression française me semble toutefois imparfaite pour désigner la création d’effets spéciaux, je lui ai donc préféré l’expression anglaise dans ce texte. ↩
- En opposition au dispositif à trois canaux des performances de Weisgerber pour Jerusalem In My Heart : c’est-à-dire avec trois projections simultanées. ↩
- Précision de Erin Weisgerber au sujet de « Qalouli » : « J’avais ce matériel que j’avais tourné pour la performance multi-projecteurs en direct. Puis, Philippe Léonard m’a invité à présenter un film triptyque pour une projection extérieure intitulée « À l’ombre des astres ». Il m’a suggéré de remonter un film existant pour trois canaux, et j’ai plutôt suggéré de créer quelque chose de nouveau en utilisant le matériel en question. J’ai ensuite demandé à Radwan s’il voulait collaborer sur le son. Il a fourni la piste « Qalouli » qu’il avait à l’origine enregistrée sous son propre nom. J’ai monté les images numérisées sur le morceau. Finalement, nous avons décidé de sortir la vidéo sous Jerusalem In My Heart, dans la série de singles vidéo de Constellation Records ». ↩
- La pochette de Qalaq comprend les contributions d’autres artistes, dont une photographie de Myriam Boulos, en couverture, prise durant les manifestations de 2019, à Beyrouth. Pour plus d’informations, visitez le site web de Constellation Records. ↩
