Lapins à l’écran : une descente dans le terrier (2/2)
Cuniculophilie
L’autre aspect frappant de ces deuils de l’enfance est la concordance récurrente de la question de la chasse avec l’adolescence/la fin de l’adolescence des jeunes hommes. Comme je le mentionnais plus haut, une fois qu’est acceptée la responsabilité bien masculine — de chasser l’ancien ami pour nourrir, vêtir ou protéger —, la poursuite du lapin devient attirante. Au croisement du mignon, du défi et de la proie, visée ou piégée, je ne m’étonne donc plus qu’ils soient devenus symboles du désir et de la sexualité hétéronormés.
Le lapin est si intimement lié à l’imaginaire sexuel qu’on le retrouve partout : au symbole de la revue Playboy, déguisement très populaire (coucou, Elle Woods, Regina George et Shelley Darlingson), et accessoirement, sextoy très populaire. On aurait pu choisir bien d’autres animaux pour signifier une activité sexuelle intense : les rats et les souris se reproduisent très vite aussi. Mais ils n’ont pas le même historique relationnel avec nous que les lapins. En bon patriarcat, on parle bien de « conquêtes » ou de « tableaux de chasse » pour désigner la poursuite et la consommation d’objets de désirs. On parle même, en effet, de consommation et d’objets. Après tout, qui oserait chasser son égal ?
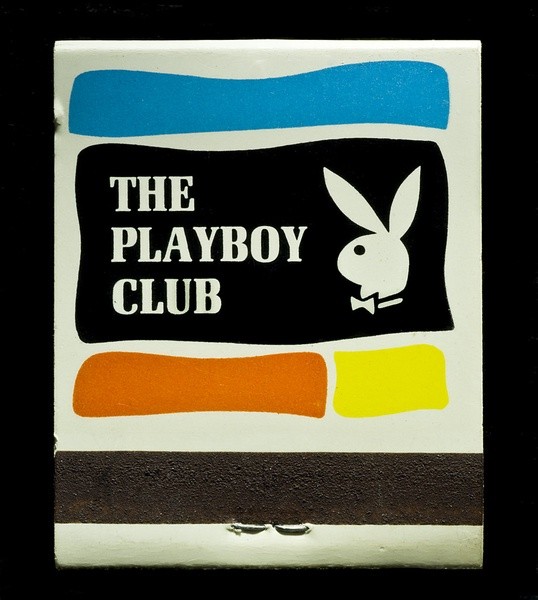


Le personnage de Elle Woods (Legally Blond, Robert Luketic,2001).
Mais il me semble que beaucoup se joue justement dans le renversement du rapport entre les hommes — principalement — et les lapins à l’adolescence, donc à l’âge de la libido et de la chasse. Dans ce renversement, il y a un passage de l’âge de la douceur et de la coopération à celui de la conquête et de la compétition. Et il faudrait tuer le gamin/lapin en soi pour devenir un homme non pas seulement pour les raisons énumérées plus haut, mais parce que l’enfance reste perçue comme le domaine des femmes : combien ont eu l’impression qu’Elle Woods se comportait comme une enfant ? Pareillement, dans Who Framed Roger Rabbit, il est difficile pour presque tout le monde de comprendre et accepter que la belle Jessica Rabbit — réduite par tous à un fantasme — soit vraiment attachée à son mari Roger, lapin cocasse, doux et aimant : antithèse d’un chasseur, d’un « vrai » homme.

Preuve d’amitié de la part d’Eddy Valiant. Who Framed Roger Rabbit Robert (Zemeckis, 1988).
Dans leur article consacré au film, Justin Clemens et Dominic Pettman explicitent cette idée comme suit :
And because Jessica is married to such a hysterical, clearly “feminized” cartoon rabbit, it’s just as “clear” that her relationship with Roger cannot be a sexual one. “He makes me laugh,” she finally explains to Eddie (no doubt giving the audience another chance to dream of impossible cartoon sex) 1 .

Jessica Rabbit justifiant son intérêt pour Roger Rabbit.
Je tiens à mettre l’accent sur les guillemets accolés à clear, nous rappelant que ce n’est clair que si l’on considère une sexualité non normative comme inimaginable. À tel point qu’elle reste longtemps la suspecte numéro 1 dans sa disparition et dans l’assassinat du gentil créateur des Toons : elle est trop belle — et trop femme, c’est la seule Toon d’apparence humaine — pour ne pas être fatale.
J’ai donc pour hypothèse que, dans le monde des bunnymen de cinéma, rester dans un rapport affectueux avec les lapins signifierait refuser l’hétéronormativité. Une autre « force (positivement) destructrice » ? J’espère bien. Cette idée me vient de Gummo. Dans la première scène où Bunny Boy n’est pas seul, il se fait attaquer par deux garçons surjouant une certaine masculinité toxique avec tout un assortiment d’insultes homophobes et de références aux pénis. « Rabbits are queers! », s’exclament-ils. On pourrait commencer par justifier le commentaire par les oreilles de lapin roses, qui ne sont pas sans rappeler les Playmates et les déguisements de « sexy bunnies ». Mais ce n’est pas exactement ou, du moins, pas uniquement ce que les enfants disent. « Rabbits are queers » implique une généralisation qui met en cause tous les lapins. Pourquoi les lapins seraient-ils queers, si ce n’est parce que l’hétéronormativité fait des « hommes », des chasseurs ? Rabbits are queers because they do not hunt.


Gummo (Harmony Korine, 1997).
On sent dans cette scène la peur d’être associé à la queerness par contact, qui appelle une masculinité performative (qui ne peut être qu’hétérosexuelle) se manifestant dans la violence physique et verbale : s’agit-il de cette fameuse peur homophobe d’être un chasseur chassé ? Ce qui me rappelle l’histoire éternelle de Bugs Bunny et son chasseur, Elmer Fudd…
Dans un court texte consacré aux films cryptiques — je ne suis pas seule dans mon désarroi —, Jeffrey Sconce décrit le film comme suit :
The film has a rudimentary plot—a braided narrative organized around highly gendered investments in “pussy.” […] Also used to separate the boys from the girls is a queer third term, embodied in the figures of a mute boy in pink rabbit ears (“bunny boy” [Jacob Sewall]) and a rival [trans] cat hunter 2 .
Muet, rejeté pour son apparente queerness et apparaissant rarement, Bunny Boy est pourtant inséré dans ce montage de scènes documentaires, d’images d’archive et de séquences jouées comme le fil rouge du film : il l’ouvre et le clôt, après une apparition au milieu.
J’en viens donc à mon film favori parmi toutes ces histoires de lapins anthropomorphes : Harvey (Henry Koster, 1950), adapté de la pièce de théâtre de Mary Chase (1944). On trouve d’ailleurs des références à ce film dans Who Framed Roger Rabbit et dans Donnie Darko.

Un nouvel ami de Roger Rabbit, détournant l’attention du super-vilain Judge Dooom en lui présentant le lapin invisible, Harvey.

Donnie Darko, lorsque sa professeure de littérature lui demande : « Who’s Frank? ».
Elwood P. Dowd, absolument merveilleux de gentillesse et de douceur, vit avec sa sœur — la veuve Veta Louise Simmons — et sa nièce dans l’immense maison héritée de leur mère. Malgré son évidente bonté, la bonne société moque et/ou fuit Elwood : à chaque rencontre, il présente son ami Harvey, toujours à ses côtés. Sauf que Harvey est un lapin invisible de 6 pieds et 3 pouces et demi.

Harvey (Henry Koster, 1950). Edwood (au centre) présente Harvey (à droite) à Tante Ethel (à gauche).
Le seul endroit où Elwood et Harvey sont les bienvenus est le bar où ils passent le plus clair de leur temps. En effet, Edwood traite tout le monde comme son égal, donnant son numéro, son adresse et une invitation à souper à chaque individu avec qui il a une interaction : autre « symptôme » de sa supposée folie. Le tenant du bar et les habitués respectent donc la présence de ce Harvey, sans ne l’avoir jamais vu.
Or sa sœur Veta, qui essaye de trouver un bon parti pour sa fille, voit tous ses efforts ruinés par l’entêtement d’Elwood à présenter son Harvey invisible à tout le monde. Elle décide donc de prendre les mesures nécessaires pour le faire interner de force : pendant les premières minutes du film, on partage l’impression que l’homme hallucine un lapin, qu’il a un ami imaginaire. Jusqu’à ce que le film multiplie les indices pointant vers la piste d’une créature magique, invisible, mais bien réelle. De fait, il s’agit d’un pookah, une créature magique du folklore celte, bénéfique ou maléfique.
La tentative de Veta pour faire interner Elwood se retourne contre elle grâce au pookah et à l’inattention du psychiatre : la pauvre femme avoue naïvement voir de temps en temps le fameux Harvey.

Le psychiatre saute sur l’occasion pour la diagnostiquer hystérique. Pendant l’internement — de quelques heures — de sa sœur, Elwood rentre au manoir et dispose un portrait de lui et Harvey devant celui de sa mère : nous « voyons » le pookah pour la première fois.

Cette scène est importante, car il est mentionné plus tard dans le film que c’est seulement après la mort de sa mère qu’il a rencontré Harvey et atteint l’espèce de béatitude dans laquelle il vit désormais. Ce qui pourrait être l’indice d’une queerness enfin revendiquée ? Après investigation du terme, il s’avère d’ailleurs que, d’après le Urban Dictionary, « pookah » peut référer à un partenaire amoureux ou à un homme très musclé et beau (entre autres) 3 .
Justin Clemens et Dominic Pettman notent également le sous-texte sexuel, souligné vers la fin du film :
One of Harvey’s gifts, anticipating the rabbit in Donnie Darko, is prophecy, for he can reliably predict the future. Another, even more impressive power, is the capacity to create a fermata by arresting the flow of time:
— Elwood: “Did I tell you he could stop clocks?”
— Dr. Chumley [director of the asylum]: “To what purpose?”
— Elwood: “Well… You can go anywhere you like, with anyone you like, and stay as long as you like, and when you get back, not one minute will have ticked by… You see, science has overcome time and space, but Harvey has not only overcome time and space, but any objections.”
The key phrase here—“any objections”—is Hayes Code language for the social sanction of erotic fantasies (of which the good Dr. Chumley happily confesses). The elusive object of Harvey himself thus authorizes the libidinal abandon that psychoanalysis sets up as both its object and objective (through socially acceptable sublimation, etc.) 4 .
Après avoir vu un certain nombre de lapins au cinéma, il est difficile de ne pas saisir le lien ici proposé et de voir dans le film que ce sous-texte n’est pas hétéronormé.
L’exemple le plus marquant à ce sujet est la supposée attirance d’Elwood pour l’infirmière qui l’accueille dans l’hôpital psychiatrique. Il a déjà été établi avant cette rencontre qu’elle est attirée par le médecin qui a interné Veta par erreur, et qu’iels se sont probablement déjà fréquenté·e·s. Mais contrairement au psychiatre indifférent, Mr. Dowd est très attentif à la jeune femme et n’hésite pas à la complimenter et à lui signifier son attirance — c’est même parfois gênant. Pourtant, il s’arrange pour rapprocher le futur couple dès qu’il en a l’occasion. Son désir ne semble alors être énoncé que pour souligner les attraits et l’intérêt de la jeune femme aux yeux du docteur, et non pas dans un objectif de séduction. En revanche, lorsque par bonté de cœur il fait la même chose avec Harvey et lui suggère de rester avec Dr. Chumley, il est évident que la situation lui est désagréable. L’air triste, il s’éloigne en regardant plusieurs fois par-dessus son épaule, comme s’il espérait que Harvey change d’avis et le retrouve. C’est bien ce qui arrive, et les deux personnages sont rapidement réunis. À ce moment-là, on a très envie de dire : et ils vécurent heureux.
Avec ces possibles clés en main, le diagnostic de Veta et son irritation face au lapin prennent un tout autre sens. L’hystérie, faux désordre psychiatrique à l’époque du film, rejoint un autre faux désordre : l’homosexualité telle que pathologisée par les institutions psychiatriques jusqu’en 1973 aux États-Unis (date à partir de laquelle elle fut retirée de Diagnostic and Statistical Manual II). Si la relation d’Elwood avec Harvey signifie la queerness du protagoniste, il en irait de même pour Veta, à qui il arrive de son propre aveu de voir le lapin géant.
On le constate avant même son aveu dans une scène subtile où la femme s’excuse auprès d’Harvey alors qu’elle allait accidentellement lui fermer la porte au nez. Devant le psychiatre, lorsqu’elle s’emporte et révèle ne plus supporter le pookah, elle ne dit pas uniquement que c’est la honte sociale d’avoir pour frère « the screwball with the rabbit » qui lui pose problème. Elle ajoute que c’est aussi de le voir partout chez elle qui lui est devenu insupportable. À la fin du film, elle reconnait tout de même l’intérêt qu’elle porte à Harvey, et avoue à demi-mots qu’il lui manquerait s’il disparaissait (notamment parce que cela impliquerait un retour à la « normale » de son frère).

Serions-nous lapins ?
Revenons-en au tableau de chasse épinglé à nos écrans : de toute évidence le chasseur ne sait pas exactement ce après quoi il court, ni même pourquoi il court. Ça prend la forme d’un lapin, mais ça parle — et jamais en vain. Ça prétend être un lapin, mais c’est une version difforme (ou invisible) de la bête. Un vestige de l’enfance qui se double soudainement d’un imaginaire sexuel révélant certains rapports de force hétéronormés.
Le lapin qu’on examinerait après capture se fait miroir au cinéma, et nous demande de nous observer interagir avec lui. Or, c’est comme si nous étions coincé.e.s dans le miroir, à mi-chemin entre soi-même et le lapin. Lorsqu’on s’observe avec lui, les repères sont faussés. On s’en va dans un sens et dans l’autre jusqu’à ne plus trop savoir qui du lapin ou de l’homme mène la marche. Et dans un mouvement presque inquiétant, on en vient à douter de ce que l’on voit. Le lapin sert-il toujours de reflet à nos pulsions ou inconscients ? Ou projetons-nous sur lui ce qu’on veut y voir ? Dans quel sens va l’image ? Il y a quelque chose de perturbant dans l’observation des contradictions portées par l’animal, qui d’ami devient proie, d’animal réel hallucination. Comme un dérèglement de la continuité de soi dans notre rapport au monde/lapin. Est-ce bien la même personne qui le caressait et le chasse ? Si bien qu’en se penchant sur l’écran, on peut apercevoir vaguement que la course du chasseur et du chassé n’est pas ce que le chasseur prétend. Pour reprendre les mots d’Uncle Junior dans The Sopranos (David Chase, 1999–2007), parfois un coureur a tellement de retard sur la course qu’il pense être en tête (« Some people are so far behind in a race that they actually believe they’re leading. »).
Et c’est le constat : le lapin nous dépasse. Dans la lapinière filmographique, on déniche des questions, principalement, et toujours cette vague impression que quelque chose se trame dans l’ombre. Combien d’autres lapins émergeront du terrier ? Dans le cas de Harvey et Donnie Darko, les amis des lapins semblent être des hommes très sages, plus que les autres, voire trop sages pour leur propre bien. En plus d’être queer et mystérieux, le lapin serait donc également le compagnon, voire l’alter ego, des esprits éclairés. On l’a vu, il y a également une prédominance de maladies mentales comme la schizophrénie et l’alcoolisme dans les récits mettant en scène des amitiés entre hommes et lapins anthropomorphes. Ce qui n’est pas sans rappeler un autre trope, celui de l’esprit brillant et torturé, comme Donnie Darko. Mais pourquoi ces associations en particulier ? Quelles mutations nous amènent aux bunnymen meurtriers ? À moins que le costume ne soit en fait la face derrière le masque ? Qu’en est-il de la peur qui les entoure ? Pourquoi de bêtes peureuses se transforment-ils si souvent en monstres ? Les slashers que je n’ai pas eu le courage de regarder ont certainement bien des réponses en formes de question. Sans parler du terrier de nos inconscients collectifs… Quels fantasmes motivent l’inversion de la dynamique chasseur/chassé ? Quels plaisirs cherche-t-on dans le sentiment — cinématographique —d’être des chasseurs.euses chassé.e.s ?
Notes
- Justin Clemens et Dominic Pettman, « “Look at the Bunny”: The Rabbit as Virtual Totem (or, What Roger Rabbit Can Teach Us About the Second Gulf War) », dans Avoiding the Subject: Media, Culture and the Object, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2004, p. 66. ↩
- Jeffrey Sconce, « Indecipherable Films: Teaching Gummo », Cinema Journal, vol. 47, n° 1, automne 2007, p. 113. ↩
- Entrée « Pookah » dans le Urban Dictionary : https://www.urbandictionary.com/define.php?term=pookah (consultation le 30 mai 2021). ↩
- Clemens et Pettman, 2004, p. 71. ↩
