L’Après-film

Photogrammes super8 tournés pour La Version nouvelle (2016).
Version française du texte présenté lors du symposium tenu à la Cinémathèque québécoise, revu et adapté par le cinéaste.
In a field
I am the absence
of field.
This is
always the case.
Wherever I am
I am what is missing.
- Mark Strand
Le cinéma est un psychopompe non fiable, un guide au seuil de la cécité.
Il existe en cinéma une multiplicité de solutions pour rendre le monde visible, mais chaque fois que je réfléchis au processus créatif, que j’essaie de le décrire ou de l’enseigner — qu’il soit question de représenter une action et ses conséquences, de mettre en scène un objet, un lieu, d’encadrer un visage, de choisir l’ouverture et la fin d’une séquence, d’un élément à soustraire de l’écran dans l’espoir que le spectateur le restitue en esprit (qu’il « boucle la boucle », comme l’a joliment formulé Walter Murch) —, quelque chose fuit, et je réalise que, plus je planifie, moins je suis satisfait du résultat. C’est ce qui explique peut-être mon affinité pour les travelogues, ma préférence pour les détours et les imprévus aux arrivées à temps. Comme le voulait Chklovski, l’objectif serait de redécouvrir les choses afin de leur donner de nouveaux noms. Mais qui choisit ces noms ?
Je pense souvent aux rapports entre les intentions d’une image et mes propres attentes, l’interprétation que j’en fais. Je n’utiliserai pas la formule « phénoménologie de l’iconologie », mais je dirais : certains croient que la poésie devrait être mémorisée pour qu’elle se manifeste à soi aux moments opportuns. Elle serait, comme l’imaginait Mandelstam, une mélodie surgissant au fil des jours, comme le chant d’oiseau de la poésie originelle, imité par des humains, et sans mots. Le répertoire des films que j’ai vus et gardés en mémoire — ce catalogue de vies vécues par procuration, ces visions du temps — est devenu pour moi un index de réactions qui émergent en réponse au monde.
On dit que le temps est une notion relative, mais au cinéma, à quel temps se réfère-t-on ? Un cinéaste peut dire « ce n’est pas important, seul compte l’instinct du moment, tout ce qui s’ensuit ne me concerne pas ». C’est une réponse valable, mais l’expérience du temps au cinéma suscite encore mille questions. Je pense à cette boutade intrigante de Kiarostami, qui disait que ses films préférés étaient ceux devant lesquels il pouvait s’endormir. Le sommeil du spectateur ne semble alors utile ni au plan narratif ni à l’ordre des choses. Mais les mêmes questions demeurent : qui narre ? Et quel ordre des choses ? Du point de vue de l’intention ou de l’interprétation des images ?
Longtemps j’ai dit que la photographie montre ce qui est arrivé, alors que le cinéma tend toujours vers ce qui arrivera; au final, tous deux sont des expériences singulières qui se déploient dans le temps. La différence entre regarder et voir peut possiblement l’expliquer – devant une photo, un tableau ou des ombres au mur, il faut revenir à notre apprentissage de la lecture des images; comment se raconter les détails qui émergent du champ de vision. C’est au moment de son récit que l’image prend vie, à ce moment-là que son paysage prend forme, dans l’espace et dans le temps; l’arbre se détache de la forêt, l’œil des bêtes scintille sous les feuilles.
L’observateur, le spectateur, choisit seul l’ordre dans lequel les choses et les êtres sont successivement aperçus, l’importance d’un détail plutôt qu’un autre, mais aussi la vitesse à laquelle les actions se produisent à l’écran, ou la réalité même des scènes filmées. Dans ma mémoire, la scène montrant la mère de Rocco qui observe ses fils buvant du café dans le matin de Milan dure toujours une minute de plus que le plan réel; quand Hari réalise ce qui est arrivé à Durga, je le vois toujours s’effondrer au ralenti, mais est-ce bien le cas ? La deuxième victime du Pickpocket dans le métro le gifle à la figure après avoir réclamé son portefeuille : il paraît que cette scène n’existe que dans ma tête. Ces trahisons abondent dans ma mémoire. Je ne peux m’empêcher de croire que Joseph Cornell avait déjà trouvé la solution en 1936 quand il a présenté Rose Hobart à la galerie Julien Levy de Manhattan. Il avait remonté un film selon sa propre vision, isolant les plans de son actrice fétiche, et l’avait projeté au travers d’un filtre bleu. Revoir Louise Brooks dans Pandora’s Box me confirme que Cornell avait trouvé la clé. Il n’y a que le visage de Louise Brooks qui affleure à mon esprit, le reste du film reste flou. En fait, je m’en souviens à peine.
Je fais référence à ce que j’appelle, faute d’un meilleur terme, l’après-film. Un film a plusieurs vies, je ne sais combien exactement, au moins quatre ou cinq. La première est celle du film avant qu’il ne soit tourné, une chose parfaite, la vie rêvée du film : j’ai oublié qui a dit que « les meilleurs cinéastes sont ceux qui n’ont jamais touché à une caméra ». Mais ce n’est pas dans la littérature que se trouve pour moi cette perfection, c’est plutôt dans les notes inscrites à l’envers d’une enveloppe, d’un billet de train, d’une carte d’embarquement, et qui deviennent une gamme de possibilités, peut-être même une véritable liste de lieux, d’heures du jour, de directions; un code fabriqué à partir de bonshommes allumettes et de mots exilés de la littérature. Car le scénario sera toujours le paria de la prose, qu’il compte cent pages ou quelques mots, « fille, fusil, Cincinnati ». Il est une rumeur merveilleuse, mais une chose incertaine, qui espère sortir enfin de ses bleus pour être mis en lumière, visualisé. C’est une sorte de prière, un mantra si on veut, oui, un chant d’oiseau – à l’aube ou au crépuscule, c’est selon.
La deuxième vie d’un film se déroule pendant le tournage, sous l’œil de la caméra; cette vie s’enfuit durant les répétitions, mais elle poursuit l’équipe qui rentre à la maison pour se pointer le jour suivant afin de la redécouvrir, sauvage et fuyante. Cette dynamique, ce chassé-croisé imaginaire se répètent jusqu’au montage final. Pour moi, le résultat, la bobine de film imprimé, s’apparente en quelque sorte à une géode, cette pierre d’apparence banale, à l’intérieur de laquelle s’est cristallisée une foule de formes et de couleurs.
Le soi-disant « montage final » constitue la troisième vie du film, dont la naissance est renouvelée à chaque projection, jaillissant de l’écran pour s’engouffrer dans la rétine du spectateur et se diffracter dans son esprit : s’accélérant, ralentissant, s’arrêtant, faisant marche arrière, se déroulant d’une manière que ne prévoyait ni sa première ni sa deuxième incarnation. Le film se ramifie là où il se voulait univoque, il se peuple de nouveaux personnages, reflets des spectateurs, qui répètent certaines répliques, miment des gestes tendres ou violents, s’attardent à un détail d’apparence anodine, encore et encore, bouleversant la cadence du film, modifiant l’image.

Brown owl (Waldkauz) (Johann Friedrich Naumann (1780 – 1857) Naumann-Museum, Köthen)
Et c’est dans ce monde de réactions psychiques et d’angoisse passive que l’après-film est conçu. Cette chose que nous emportons hors de la salle obscure, et qui représente la quatrième ou cinquième vie du film, entièrement constituée de souvenances, et qu’on peut méprendre pour un fil rouge, le « psychopompe » évoqué plus tôt : c’est le guide des âmes incarné par Hermès ou un animal, un hibou par exemple, créature psychopompe suprême, mystérieusement didactique, hypnotisant d’ennui. Un hibou perché à la fenêtre cligne des yeux pour vous prévenir, change d’idée en tournant la tête. Je ne pense pas ici au fameux « Memories, you’re talkin’ about memories… » du détective Deckard, ni à de sentencieuses leçons de vie, mais plutôt à une série de débuts et de fins; des fragments orphelins qui permettent de revoir le monde et surtout de rejouer le temps. L’après-film nous accompagne longtemps après la projection, léger et discret comme une clé dans la poche d’un manteau. Avec elle, nous avançons dans la nuit, suivant ce guide intime qui soudain nous mène au coin d’une rue familière, mille fois parcourue, mais qui pour un court instant semble enveloppée d’une tout autre lumière. Cette rue porte même un nouveau nom; elle le conservera quelque temps encore, du moins jusqu’à la prochaine vie de l’après-film.
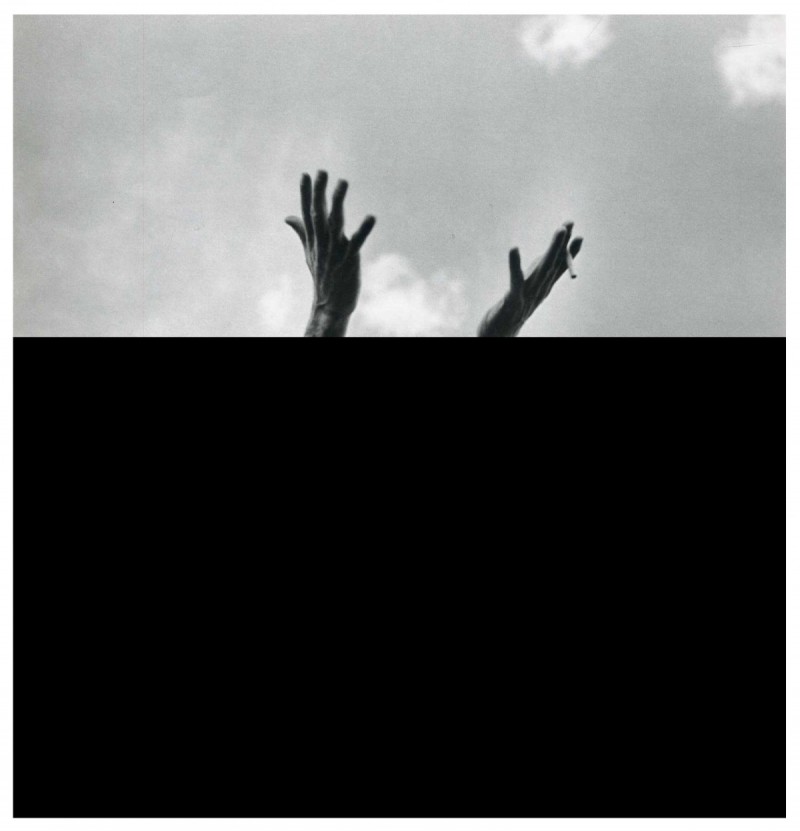
Untitled (2015)
L’auteur remercie Simon St-Onge, Olivier Godin et Rosalie Lavoie pour leur aide avec la traduction française.
