Des choses qui brillent
Entretien avec Paul Clipson (27 janvier 2011)

UNION (détail, 2010)
Cet entretien a été réalisé à la fin janvier 2011. Le cinéaste américain Paul Clipson était de passage à Montréal pour lancer l’incroyable série de projections du Cinemaspace au Centre Segal (qui durera 2 ans), sous la coordination de Daïchi Saïto et Malena Szlam. Un premier soir, le 26 janvier, nous pûmes assister à une sélection de ses films en super8, puis, le 27, à une projection d’une nouvelle série de films (toujours en super8) accompagnés cette fois par les musiciens Roger Tellier-Craig et Bernardino Femminielli. Entre les deux soirées, Paul m’accorda cet entretien lumineux, brillant, passionné, généreux, comme l’étaient ces films qui ont laissé une marque profonde sur tous ceux qui ont eu l’honneur et le privilège de les voir projeter (ce qu’on peut voir sur sa page Vimeo — et malgré la belle qualité des transferts — n’offre que l’ombre des sensation que nous éprouvions devant l’écran, à voir ces bobines de fine pellicule tressaillir à travers le projecteur). J’ai eu le plaisir de le voir à diverses occasions et de revoir quelques fois ses magnifiques films, plongé dans cette lumière. Je me disais qu’il fallait bien un jour que j’écrive quelque chose, que je reprenne l’entretien. Et puis ces mots, cette voix, étaient restés tapis, dans un disque dur, comme tant d’autres. À diverses périodes, j’y repensais, me disant qu’il fallait les retranscrire, les traduire, reprendre le fil de tout ça. L’occasion ne s’est jamais présentée. Et voilà 7 ans qui se sont écoulés…
Il a fallu qu’il nous quitte, le 3 février dernier, à 53 ans, pour que je me remette à écouter cette voix, si claire, si juste, si fragile aussi, comme ses films, comme la vie. Oui. Tout. Toujours. Ne tient qu’à un fil. Mais c’est aussi pourquoi, parfois, ça brille si fort. Et que souvent ça continue de briller, longtemps après que la lumière se soit éteinte…
Hors champ [HC] : Pourriez-vous commencer par nous parler de votre collaboration avec Jefre Cantu-Ledesma, qui a eu, je crois, un rôle important dans votre carrière ?
Paul Clipson [PC] : Nous nous sommes connus il y a de nombreuses années et nous avons tout de suite partagé plein de choses. Il m’a fait découvrir Morton Feldman, qui a été une immense influence ; je lui ai parlé de Brakhage, Bresson, Tarkovsky, Akerman, etc. À cela s’est greffé un contexte. Il compose de la musique, il performe, et il a toujours eu le désir d’accompagner sa musique d’images. Il fait partie d’un groupe qui s’appelle Tarentel, mais il réalisait aussi des performances solo. Il lui arrivait de projeter des films de cinéastes. Et il m’est arrivé de lui demander : pourquoi ne pas projeter un film original ? Tu composes ta musique, pourquoi repartir de films déjà réalisés dans un autre contexte ? Par exemple, il m’avait demandé de lui prêter ma copie des films de Bruce Conner. Ce n’était pas très rare, certes, mais ce n’était quand même pas édité de façon officielle. Je les ai eus à travers Bruce, parce que j’avais montré ses films et j’avais travaillé avec lui. Et Jefre m’a dit : je vais faire une performance sur ces films, ils sont exceptionnels ! Et ma première pensée a été : si Bruce savait ça, il t’étranglerait. Ça m’arrivait souvent de projeter des films au musée, pour susciter un intérêt pour le cinéma, pour un cinéma alternatif. Souvent, quand je passais les films, les cinéastes nous prêtaient les copies sans nous demander de payer. Dans le cas de Conner, il m’avait bien dit, si tu les montres au musée, tu dois payer. Et je respectais ça totalement. Le cinéma expérimental est une lutte permanente. C’est difficile. Après coup, je me suis dit. Oh ! J’aurais tellement préféré que Jefre n’eut pas fait ça. C’était dans une petite salle, ça n’a pas eu vraiment d’impact. À San Francisco, les choses sont assez séparées, entre le monde de la musique et celui du cinéma. Il y a ce genre de mur invisible. Mais à partir de là, m’est venu l’idée de lui dire : je ne crois pas que c’est une bonne idée, ça devrait être du matériel original, ce serait mieux ainsi, etc. Du coup, il m’a invité à proposer des images pour le spectacle suivant de Tarentel, qui avait lieu quelques mois plus tard. Je ne faisais pas des films dans cette perspective-là à l’époque, alors j’ai pris des images un peu hasard, qui dataient de quelques années, tournées lors de voyages, des images d’observation, des plans de voiture, des choses que je trouvais énigmatiques et belles, qui évoquaient des souvenirs. Un monde visuel. Et j’ai conçu un film de trente minutes à partir de ce type de matériel. Je l’ai montré et les gens ont semblé enthousiastes. Et ça a lancé le processus. À partir de là, j’ai montré des images à tous les spectacles de Tarentel, au moins ceux où je pouvais me libérer, ce qui est à près tous. Ils sont partis en tournée pour deux ou trois semaines, en Italie, en Espagne, sur la côte Est des États-Unis. Soudain, ça m’imposait un rythme. Ça me forçait à produire des images en fonction d’une date à venir. Pour moi, c’était important d’avoir cette structure et cet objectif. Ceci va avoir lieu, c’est un fait, à telle date, et je ne veux pas toujours montrer les mêmes images. Ça me donnait une respiration, un souffle. Et je crois que c’est très important, soit de parvenir à se l’imposer soi-même, soit de se le faire imposer de l’extérieur. Les artistes ou les écrivains, sont aussi très sensibles, ils se tourmentent sans cesse, ils se sentent coupables de ne pas assez travailler. Et je pense qu’il y a des artistes comme Ellington ou Fellini qui ont parlé de l’importance du contrat dans le processus créatif. Même s’il est purement formel et arbitraire, ça impose une date et un format. Finir une œuvre devient aussi une question ouverte, dans la mesure où l’œuvre est terminée quand la date de l’événement arrive. Ça a redéfini ma façon de travailler. Auparavant, je faisais des films de manière plus conceptuelle. Et dans un esprit plus narratif. Ce qui impose évidemment des contraintes économiques et institutionnelles importantes. Lorsque j’ai commencé à travailler sur ce modèle-là, toutes ces questions ont disparu. En fait, elles étaient toujours là, mais elles semblaient plus secondaires. Il s’agissait plutôt de parvenir à trouver le temps de générer le matériel, plus rapidement que je ne l’avais jamais fait. Parce que c’était aussi une expérience sociale pour moi. Je travaillais avec des gens qui travaillait dans un autre médium, qui créaient de la musique, etc. Je me suis aussi mis à les étudier, mais aussi à les filmer. Par exemple, ils étaient en train d’enregistrer un album et ils me demandaient de venir les filmer en vidéo. Ça ne correspond pas du tout à ce que je fais en pellicule, mais ça a eu l’effet de me faire réaliser comment ils collaboraient, comment ils s’inspiraient mutuellement.
Il s’agissait aussi pour moi d’apprendre à travailler avant de réfléchir. Utiliser toute sa connaissance, mais pas de façon strictement intellectuelle ou analytique. Ça me permettait de mettre l’emphase sur les connaissances accumulées de façon plus intuitive. Des choses plus enfouies ressortaient soudain, à cause de la rapidité ou du caractère constant du processus. En tournant pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, à tous les jours, les matins, le soir, en voyage, sans connaissance préalable du lieu où je vais, ce que je vais y trouver, je ne savais pas du tout ce que j’allais voir. Et même s’il s’agissait de lieux que je connaissais, soudain je découvrais des choses parfaitement inattendues. Le plus important c’est que quand je voyais le film que j’avais réalisé, ça ne ressemblait pas du tout à ce que j’avais ressenti la première fois en tournant le film. Ça m’a appris à ne pas intervenir. Au début, il faut agir, lancer le processus. Comme en musique, ou en dessin, c’est l’habitude qui prime. C’est comme respirer. Il faut le faire, naturellement. Le reste suit après. Et cela, je le lie beaucoup à mon amitié avec les musiciens. À l’espace de causalité accidentelle de cette sphère sociale, au travail et au mode performatif qui n’était pas naturel pour moi.
HC : Au début, c’était vous qui accompagniez des musiciens, qui fournissiez, en gros, du matériel visuel. Ce n’est pas nécessairement réducteur de dire cela, mais…
PC : Non, non, tout à fait, c’est ce que c’était. C’était une relation très fonctionnelle, très simple. Mais, comme je le disais hier soir, il n’y avait pas vraiment d’échange, de discussion, si ce n’est un partage du travail. Nous étions intéressés et enthousiastes par ce que l’autre faisait, mais l’idée ne leur serait pas venu de me dire : tu devrais faire un film sur les villes, parce que nous voulons traiter de ce sujet. Nous ne parlions pas de ce genre de choses. Je leur montrais des choses, ou on en parlait, mais plus souvent qu’autrement ils ne voyaient pas les images que je tournais avant le spectacle. De la même manière, en les écoutant répéter, je ne leur demandais pas s’ils allaient jouer telle ou telle pièce de musique dans deux semaines. C’était plutôt comme deux studios, mais des studios virtuels. Moi, je suis souvent dehors, en train de tourner. Ça c’est une chose que j’ai oublié de mentionner hier soir, c’est que les films sont tournés en extérieurs. Tout ce qui se passe dans les intérieurs est un tout autre sujet, et peut-être vais-je m’y intéresser à l’avenir, mais je me suis beaucoup intéressé à tourner en extérieur. Je ne sais pas pourquoi, mais c’est comme ça…
HC : Il y a peut-être en cela quelque chose qui est propre au fait de tourner en super8. Vous êtes souvent en position d’accueil, de disponibilité, de réception du monde environnant, des accidents qui surgissent, d’où le plaisir du tournage en extérieur…
PC : Beaucoup de gens, justement, me posent des questions à propos du tirage optique. C’est très intéressant, j’aimerais explorer cette voie, mais mon travail jusqu’ici à consister à réagir à partir de contraintes très précises. Je fais quelque chose qui est similaire sur le plan du processus, mais c’est un peu comme les cubistes qui trouvaient des petits bouts de papiers dans la rue et qui décidaient d’en faire quelque chose. Le résultat peut être personnel, mais aussi des choses opaques, dispersées. C’est l’autre chose qui est liée au fait de tourner en extérieur. Lorsque je vois les films, ce sont des villes « expériencielles » que j’ai imaginées, je sens que c’est comme ça que les gens existent : ils ont en eux des couches denses de collages qui forment les toiles de leurs mémoires, mais ils ont aussi une mémoire sensible de l’espace dans lequel ils vivent [they have dense layers of web-like collages of their memories but also sense memory of space, that they exist within]. Et quand je retourne tourner dans la ville, je suis toujours étonné de ne pas trouver ces choses. Il n’y a rien ici de ce que j’avais imaginé, et que les films m’ont montré. Et je réalise que j’ai donc créé cette ville imaginaire, même si elle la concerne, d’un point de vue documentaire, puisque je ne trafique rien, je ne manipule rien. Chaque chose est un objet trouvé. C’est la façon dont ils se combinent qui fait que leur sens change, qu’ils s’intensifient, ou se synthétisent, je ne sais pas. Tout ceci j’y pense après coup, et ça informe le travail que je fais après. J’essaie moins de provoquer les choses, de faire ceci ou cela, que de lancer un filet, afin de collecter des choses, mais en se rassemblant elles créent leur propre accord, puisque je ne peux pas revenir en arrière, et enlever quelque chose. Et c’est aussi ce que j’aime. C’est comme en dessin. Les lignes demeurent. Les erreurs demeurent. SI c’est une erreur, elle est quand même liée à un contexte, elle est connectée aux choix que j’ai faits. J’aime cette sorte d’équilibre qui est toujours forcément en déséquilibre en raison de la méthode.

TWO SUNS (2005)

TWO SUNS (2005)
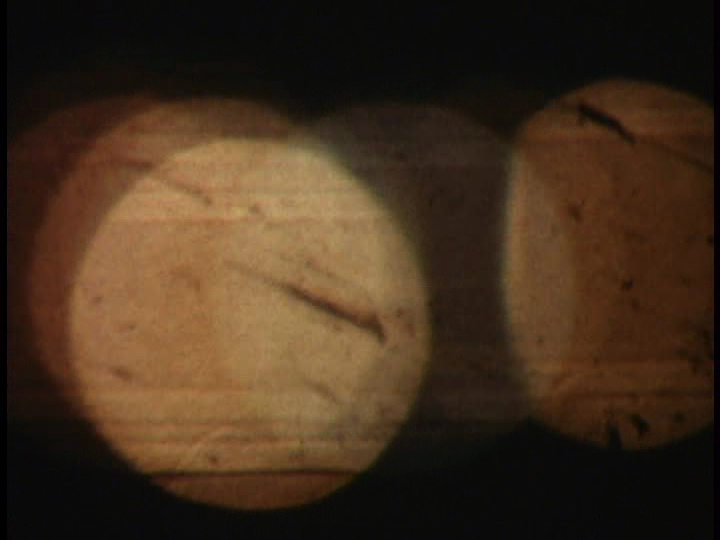
TWO SUNS (2005)
HC : Brakhage a toujours prétendu faire des documentaires. Des documentaires sur sa vision. Il essaie de retrouver des états de perception par le truchement de la caméra. Est-ce que, de ce point de vue là, tu es aussi documentariste ?
PC : Une des choses que Brakhage disait et qui m’a toujours marqué est rattachée à cette question du métabolisme du filmeur et celui de la caméra, qui se trouvent connectés. Tu respires, ton cœur est en train de battre, tout cela passe dans la caméra, surtout lorsqu’elle est tenue à la main. Tout cela est enregistré en somme, tout cela est présent, continuellement. Et oui, ce sont des choses très importantes pour moi. J’essaie de ne pas trop réfléchir à ce que serait l’intention émotionnelle, ni même à ce qui est en train de se passer. Ces choses surgissent par hasard, grâce à une présence, une disponiblité aux choses. Elles ne se révèlent pas toujours pour autant. Souvent j’essaie de reconnaître quelque chose de vivant, de vital, qui semble vrai, et réel pour moi. Et en voyant le résultat, après coup, je n’assigne pas une signification particulière aux choses. J’essaie de continuellement voir les choses pour la première fois. Comme artiste, c’est un défi perpétuel. C’est impossible, d’une certaine manière. Parce que tout nous rappelle que les choses sont toujours ce qu’elles sont, qu’elles se ressemblent. Que cet arbre est comme cet autre arbre. C’est un dialogue qui est toujours va-et-vient.
HC : Ce que tu décris rejoins un peu notre manière d’envisager tes films. Le même film, en raison de sa densité, de la complexité du montage, des textures, fait en sorte qu’on a toujours le sentiment de les voir pour la première fois. Nous les voyons toujours au présent. C’est le cas de plusieurs cinéastes lyriques — je me permets de te mettre dans cette catégorie, et on peut se reparler pour savoir si tu t’y identifies — qui fonctionnent au « présent », dans ce qu’Annette Michelson appelle le « present tense » (notamment à propos des films de Brakhage). Ce sont des films où il s’agit d’être totalement attentif à ce qui passe, intensément, à chaque instant. Il y a tellement de choses qui s’accumulent d’un photogramme à l’autre que, en quelque sorte, parce que ta concentration est tellement sollicitée à chaque instant, tu oublies ce que tu as vu à chaque instant de ton regard.
PC : C’est très intéressant. J’en parlais avec des gens aujourd’hui. Il m’arrive d’utiliser des photogrammes de mes films sur mon site Web ou ailleurs. On se rend compte que, en voyant les films, ces images ne sont jamais perçues comme ça. On ne peut pas les voir comme ça, dans leur fixité. Je ne suis pas sûr pourquoi. Mais pour décrire plutôt que d’essayer d’analyser, la question du mouvement est centrale à mon travail. C’est une fascination constante dans mon attrait pour le cinéma. Je suis fasciné par la question du mouvement au cinéma, que ce soit un mouvement de caméra en grand angle, à la Welles, ou toute autre chose. Cette dimension hypnotique du cinéma associée au mouvement est aussi connectée à la manière dont la musique est expérimentée. On analyse moins la musique sur le coup qu’on est emporté par elle. Ta réaction émotionnelle n’est pas explicable, même si après coup tu peux te dire que telle section de violon, ou telle séquence à la batterie, ou telle drone au synthétiseur, en est la cause. Sur le coup, tu es simplement soulevé, tu n’y penses pas. C’est quelque chose qui est proche du rêve, de l’hallucination, de la vision, que le cinéma peut induire. La chose première c’est l’impact, c’est l’impression. Après on peut faire toutes sortes de connexions, des associations dans la mémoire, des expériences que l’on arrive à s’expliquer après-coup, mais au moment-même, ce que l’on vit, est au seuil de la reconnaissance et de la non-reconnaissance, du visuel au seuil du visible. Encore une fois, certaines des musiques avec lesquelles j’ai travaillé m’ont semblé si texturées, que la musique me semblait visuelle, et mes images, elles, semblent percussives, comme un code morse. Une signalétique rythmique en somme. Comme si la répétition, devient le sujet de l’image. Comme si on passait rapidement devant une clôture, un grillage. Parfois la répétition est interne, parfois le montage répétitif est réalisé directement dans la caméra. C’est aussi ce que Roger [Tellier-Craig] disait hier soir. Ces films pourraient parfaitement être montrés muets et ils auraient quand même plein de sons en raison de leur rythme.

CONSTELLATIONS (2006)
HC : Brakhage a surtout réalisé des films muets. Et même s’il a réalisé plusieurs films sonores, il avait une relation privilégiée avec le silence. Il prenait la question du silence très au sérieux. Il pensait que, dans certains cas, la musique pouvait anesthésier notre vision. Est-ce que tu es parfois inquiet que la musique viendrait nuire à l’image, que l’image devienne illustrative par rapport à la musique ?
PC : Je pense qu’il y a un mouvement de va-et-vient. Et oui, c’est le risque. Parfois on a en effet l’impression que le son guide l’image, ailleurs que c’est les images qui guident la musique. Parfois elles semblent en parfaite symbiose. Ça dépend aussi de la capacité des gens à soutenir l’attention, qui change. Les spectateurs peuvent être plus engagés dans l’un ou dans l’autre, et ça dépend de chaque conscience. Et je pense aussi que conceptuellement, Brakhage concevait ses films à la base comme des films n’ayant pas besoin de son ou de musique. Ils étaient pensés, créés de la sorte. La question peut se poser, alors, s’il est juste ou pas de rajouter de la musique après coup, mais ce n’est pas ma question. Pour moi, c’était un cadeau de travailler avec des musiciens, puisque ça m’enlevait la responsabilité de devoir choisir. J’étais dans un contexte où les films que je faisais étaient par essence inachevés. C’était une incroyable liberté. De dire que, cette chose pointe dans une direction mais n’est pas encore rendu. Les films ne sont pas finis, lorsque je les montre dans un contexte de performance. Ils sont tout chauds, et ils se refroidissent, même si la musique les tient au chaud. Je trouve qu’il y a beaucoup d’expériences potentielles que je ne peux pas définir et que je sais que je vais avoir, ou que le public va éprouver, durant la performance. Je sais aussi que c’est ça, précisément, qui va m’inspirer et me motiver à tourner d’autres films. C’est la chose la plus importante : c’est ce processus qui me permet de continuellement travailler. C’est comme un artisanat, comme un musicien qui doit pratiquer, faire des gammes. Un cinéaste doit faire des gammes. Et je n’ai pas pu faire cela avant de réaliser des films dans ce cadre collaboratif.
HC : D’un côté, ces films ont été réalisés pour une performance, et en même temps, tu ne penses pas, en les réalisant, à une musique en particulier qui sera jouée lorsque les films seront projetés….
PC : Je sais parce que je suis familier avec le type de musique que les gens avec qui je collabore jouent. Mais je ne sais pas du tout quelle sera la musique jouée précisément ce soir-là. C’est assez précieux, de ne pas savoir….
HC : Et en même temps, je crois avoir lu quelque part, que tu cherches à filmer musicalement… Comme un musicien qui improvise.
PC : Certainement, mais pas consciemment. Dans le processus, en le faisant. Je ne pense pas, en filmant : ces images iraient bien avec tel type de musique. En même temps, je sais que ces films n’existeront pas sans la musique. Le performance en direct est une étape nécessaire, réflexive, réflective, pour moi, qui me permet de voir les films un peu de façon extérieure. C’est une zone un peu floue, puisque les films sont très personnels, et en même temps ils sont partagés, et en même ils ne sont pas achevés. Alors c’est quoi exactement ? C’est comme si l’absence de définition permet de laisser le film respirer, comme si je parvenais à le voir pour la première fois. L’autre chose c’est que j’aime faire les choses à la dernière minute. Du coup, je développe le film juste avant un spectacle, deux ou trois jours avant. Je l’ai fait transférer numériquement, je prends juste assez de temps pour m’en faire une impression, pour me permettre de dire qu’il y a quarante minutes, ou vingt-cinq minutes de matériel. En voyant le matériel je peux déterminer à peu près la durée de la performance. Et je l’assemble très rapidement et je le montre. J’ai à peine une impression du film. Ça n’a pas nécessairement à voir avec la manière dont le film a été tourné. Je ne cherchais pas trop à réfléchir à la structure. Je cherche simplement à créer une sorte de flux. Quand je finis par voir le film, projeté avec les musiciens qui jouent, c’est peut-être la deuxième fois que je le vois, et peut-être même la première fois que je le vois d’un seul bloc.
HC : Je suis curieux de l’étape numérique intermédiaire.
PC : J’ai toujours monté numériquement, comme s’il s’agissait d’une Moviola virtuelle. C’est une référence. Le super8 est tellement fragile, qu’il n’est pas vraiment possible de faire beaucoup d’essai et erreur. Une fois le film monté virtuellement, je retourne ensuite à l’original super8 pour effectuer les coupes. Je le fais dans IMovie ! Car il n’y a rien à faire au film. Il s’agit seulement d’organiser les plans. Je n’utilise pas FinalCut. Une fois que j’ai décidé de toutes les coupes, je les effectue sur le film. Je fais cela pour épargner le film finalement, que je visionne rarement en pellicule. Les seules fois que je vois réellement le film projeté, hormis à l’étape où je reçois le film et le fait transférer, c’est avec le public. Je suis très obsessif et, avant cela, j’étais très incertain — comme beaucoup d’artistes — de la valeur de mon travail, ce qu’il veut dire, comment il se situe par rapport à mes intentions initiales. C’est très difficile. Il faut être très confiant, ce qui n’est pas mon cas. Ou alors il faut se laisser distraire, ne plus y penser, ou encore vivre l’œuvre à travers une sorte d’expérience partagée. Je n’ai jamais éprouvé cela en tant que cinéaste. Ce n’est pas comme si on sortait en bande filmer ensemble. Les musiciens ont cela. C’est plus social. Mais le fait justement de travailler avec des musiciens m’a permis de découvrir une dimension sociale à mon travail.
HC : Dans tes collaborations, au début, c’est plutôt toi qui accompagne des musiciens. Or, les performances auxquelles j’ai assisté, c’est plutôt les musiciens qui accompagnent les films. Ce soir, nous allons voir une performance cinématographique avec de la musique en direct, plutôt que l’inverse. On peut citer différents artistes qui font les deux, comme toi. Le cas de Karl Lemieux est intéressant. Quand il joue avec Godspeed, c’est plutôt lui qui fournit du visuel, qui les accompagne. Parfois, ce seront les mêmes musiciens qui vont plutôt fournir un matériau sonore pour accompagner sa performance cinématographique. Bien entendu, dans chacun des cas, c’est plus complexe et sans doute moins polarisé, mais…
PC : J’aime bien le type d’ambiguité que ça crée. J’en parlais avec Daïchi [Saïto] justement. Je lui ai dit : on aurait pu décider de faire un spectacle où on aurait pris la décision que ce soit plutôt moi qui accompagne des musiciens, dans un lieu plutôt consacré à la tenue de spectacles musicaux. Les gens qui pensent voir de la musique, voient soudain des films accompagnés par des musiciens. Mais le plus important, c’est le fait que ces gens n’ont pas vu de films expérimentaux, ou très peu. Je ne sais pas si mes films sont expérimentaux, mais peu importe. Quelque chose se passe au contact de la musique. Et j’ai toujours trouvé ce genre d’expérience très enrichissant. J’ai toujours aimé montrer mes films dans des contextes de cinéma expérimental. Les courts métrages que j’ai montrés hier étaient programmés de façon très précise et méticuleuse, je ne les avais jamais vus de cette manière-là. Ça m’a apporté beaucoup. Mais j’aime aussi quand il y a une sorte d’erreur, que personne n’est en fait venu pour voir des images. Mais en même temps, les gens se rendent compte que ce n’est pas qu’un décor accessoire. Il y a une intensité, une intention. Certaines personnes décident de se fermer, d’autres ne sont simplement pas intéressées. Certaines autres, au contraire, qui n’avaient aucune attente, qui ne s’attendaient pas à voir du visuel, décident d’embarquer, d’en faire l’expérience. Et c’est très valorisant, parce qu’ils n’avaient aucun préjugé, aucune préconception. Comme dans la vie au fond. Nous vivons continuellement des expériences sans savoir à quoi nous attendre. En tant qu’être humain, c’est ce que nous faisons, nous sommes constamment en train d’enregistrer des expériences. Ce que j’essaie de dire, c’est que j’étais très humble et un peu déprimé à un moment. Je faisais des concerts où je devais rivaliser avec une enseigne de Pabst Blue Ribbon. Parce que c’était dans un bar, les gens commandaient de la bière. Et j’étais en train de me dire : « mais attends, il y a un segment extraordinaire qui s’en vient, et la musique est géniale, etc. » Mais les gens étaient plutôt là pour boire un verre, discuter. Après un moment, par contre, je me suis à aimer cette fragilité extrême. C’est peut-être le fait que, comme chaque chose qui est importante et spéciale dans la vie, ça ne tient au fond qu’à un fil. Et parfois une personne — parfois personne aussi —, mais parfois quelqu’un vient vous voir après coup et vous réalisez alors que quelque chose s’est bel et bien passé, au milieu de tout, malgré tout. Ça m’a beaucoup motivé à continuer à créer. Et j’aimais bien cela aussi parce que parfois, quand je montre mes films dans un festival de film, que ce soit à San Francisco, New York, en Europe, les gens y vont en sachant toujours déjà un peu ce qu’ils vont voir. Il y a une distance qui apparaît alors, parce que les gens ont déjà une idée de ce qu’ils vont voir. Ça m’intéresse beaucoup de parvenir à faire vivre l’expérience de l’inconnu. C’est comme de voir quelque chose que tu reconnais comme exceptionnel, incroyable, mais qu’en même, tu ne reconnais pas. Certaines œuvres d’art, certains phénomènes culturels, des événements culturels, des lieux, il nous arrive de faire des rencontres, d’avoir le sentiment que nous devions voir cette chose. Voir un film, et sentir que le film a été fait pour toi. Pas juste que tu as vécu une expérience forte. C’est comme si tu as pris une drogue et que tu es changé, a tout jamais. Ce n’est pas nécessairement des films que tu a choisi de voir. J’aime cette idée d’une intensité, d’une vivacité. Pour moi, l’écran n’est pas un écran : il n’y a pas de composition à l’arrêt, il n’y pas de fixité, tout est toujours en mouvement, en constant changement. La musique n’est pas l’espace. Elle peut avoir une dimension sculpturale, elle peut suggérer de l’espace, mais elle est aussi, comme les images, à la fois là et pas là. Ce n’est pas un écran, c’est un espace mental dans lequel on rentre, qui nous traverse.

LIGHT FROM THE MESA (2010)

LIGHT FROM THE MESA (2010)

LIGHT FROM THE MESA (2010)
HC : Une chose spécifique avec le super8, c’est le fait qu’on vous accompagne en quelque sorte dans ces aventures de la vision, de la perception. Ce sont des films à la première personne, même si on ne te voit jamais à l’image. C’est la définition que Sitney donne du film lyrique. On accompagne tes activités de perception. Même si ce qui aboutit à l’écran n’est pas tout à fait ce que tu as vu, on sent quand même qu’on est avec toi, avec ton corps, dans ces lieux. Tous ces films sont aussi très rattachés à des lieux précis, des moments de ta vie. Et en même temps, il peut être difficile d’identifier un lieu spécifique, une ville. J’aime ce double aspect. Le caractère à la fois totalement spécifique, unique, et en même temps, cette dimension anonyme.
PC : Tout d’abord, il faut dire que j’adore les paysages au cinéma. N’importe quel film qui a une sensibilité paysagère, m’emballe. Ça peut être Anthony Mann ou Antonioni, ou Akerman, Tarkovsky. Le sentiment de l’espace, et la solidité qui s’y rattache, m’attire beaucoup. Avec le super8, et je reviens avec ma métaphore du dessin, j’ai le sentiment que le crayon et le papier te dictent le sujet du dessin. Il est clair qu’il ne me viendrait pas à l’idée de tourner un mur en brique en super8. Je tournerai un mur en brique d’une certaine manière en 16mm, d’une autre manière en 35mm. Mais dire cela, c’est comme de dire que le super8 est limité. Dans les faits, ce qu’il ne peut pas faire lui permet de faire autre chose. Ses limitations font qu’il permet d’atteindre un point d’intensité qu’il est le seul à pouvoir atteindre : un reflet de lumière par exemple. Si la pellicule est de bonne qualité, les couleurs explosent de l’écran : certaines couleurs ne semblent même plus attachées à la composition. Le plus grand détail, la plus grande précision ou délicatesse du 16mm ou du 35mm, permet de produire un autre type de beauté. J’aime tous les formats, ceci dit. Mais ce que j’aime avec le super8, c’est ce caractère pulpeux, qui m’a beaucoup attiré. Et je m’approche de certains sujets pour voir ce que ça pourrait donner en super8. J’ai fait un film que je ne montrerai pas à Montréal cette fois-ci, qui s’appelle Over Water, qui a été tourné depuis un avion, en filmant les reflets de la lumière sur l’eau de lacs. Avec de la pellicule couleur, ça prend des allures de gravures. Ça a une sorte de piqué incroyable. Si j’avais tourné en 16mm, ce serait une image plus fidèle du lac, on reconnaîtrait les lacs. D’une certaine manière, ce serait plus beau. Mais la simplicité du super8 fait que ça ressemble à la gravure à l’eau forte, où parfois L’acide ronge trop l’acier. Mais encore une fois, c’est le métabolisme du matériau. Quelqu’un parlait de cela hier, à propos du fait de développer de la pellicule trop rapidement. Parce que parfois, on s’ennuie, on fait les choses vites, et ça crée des choses involontaires, souvent ratées. C’est comme dessiner. On peut dessiner de façon méticuleuse ou non, et ça produit évidemment des types de dessins différents. Le résultat est toujours un enregistrement de cette expérience.

OVER WATER (2007)

OVER WATER (2007)


OVER WATER (2007)
HC : Ce principe de l’esquisse, du trait rapide, me semble spécifique au super8. Tu me disais hier que si tu tournais en 16mm, tes tournages seraient différents. Il faudrait que tu t’assures de bien charger la caméra, de calculer plus méticuleusement la lumière, de prévoir les choses un peu plus, vu que ça coûte pas mal plus cher. En super8, tu peux te permettre de faire des esquisses.
PC : C’est exactement ça. Godard a fait construire cette fameuse caméra Aaton, parce qu’il voulait une caméra 35mm dont il pourrait se servir comme d’une super8. J’ai un ami qui travaille au ILM, Industrial Light and Magic, la boite de Lucas. S’il veut tourner quoi que ce soit, il doit mobiliser un royaume au complet, des mécanismes techniques et mentaux inouïs ! Il ne peut pas sortir pour simplement filmer. Je peux, moi, filmer une fleur ou un reflet dans l’eau, maintenant, à cet instant. Une seconde plus tard, le phénomène que j’observe est passé pour toujours. Il y a des images de synthèse qui prennent 50 personnes, dans différents coins des États-Unis pour exister. L’image sera peut-être très belle, très intéressante, là n’est pas la question. Mais le fait que le super8 soit aussi direct et immédiat, m’excite toujours beaucoup. Une autre chose relève du processsus que j’ai découvert en tournant en super8 pour des musiciens. Filmer à cesser d’être une activité qui consiste à attraper quelque chose, aller chercher quelque chose. Je peux donner un exemple. Disons que tu es en voyage, en voiture, dans un endroit que tu n’as jamais visité. Le paysage défile. Tu es en Italie, et il y a des magnifiques tours devant lesquelles tu passes. Si tu réalisais une fiction, tu passerais devant et tu dirais : il faut filmer ça, c’est magnifique. Du coup, tu fais demi-tour, tu espères que la lumière n’a pas trop changé. Tu attrapes la tour qui défile. Tout va bien. Mais pour être sûr, tu fais une deuxième prise. La lumière est un peu changée. Tu fais deux prises, peut-être quatre dépendant du temps et de l’argent que tu as. Pour moi, le fait de tourner en super8, m’a fait réaliser qu’en roulant, tu rates plein de choses. Tu regardes ailleurs. Tu es en train de vérifier quels films jouent dans la ville que tu t’apprêtes à visiter. Un miracle vient de passer, et tu l’as peut-être raté. Le fait de tourner en super8 m’a fait accepté l’idée qu’on rate en permanence plein de choses, mais qu’en étant présent aux choses, on peut capter des miracles qu’on ne cherchait pas. Ça consistait à accepter l’idée que j’ai raté ça, mais que j’ai enregistré la chose juste après. Ça m’a rendu sensible à l’idée d’être présent aux choses, en acceptant l’idée qu’il est impossible de tout avoir. Les images tournées dans l’avion étaient un peu la métaphore de ça. C’est comme la vie, elle est en train de passer. C’est fini. Et tu parviens à enregistrer des choses et tu réalises à quel point c’est riche. Plutôt que d’avoir un discours : c’est un tournage raté, on a perdu l’acteur à mi-chemin, etc. En même temps, je m’identifie à ce discours. J’aime toutes sortes de films. J’aimerai tourner un long métrage. J’aimerai qu’il soit spectaculaire et expérimental. Je pense que les gens pourraient être prêts à voir un long métrage de fiction expérimentale. Les cinéastes qui prennent ce genre de risque croient au public, croient dans la société, à l’idée que les gens sont capables d’évoluer, de s’ouvrir à autre chose.
HC : Il y a quelque chose de très humble dans le super8.
PC : Oui, bien sûr. J’ai dit tout ça pour pas qu’on pense : « mon dieu, ce n’est que du super8 ». C’est un truc très simple, pas cher, ça m’a permis de travailler à un rythme qui me convenait. Je n’ai pas besoin de m’arrêter parce que je n’ai plus d’argent… C’est très libérateur de ce point de vue là aussi.
HC : Le super8 ne requiert pas tout un dispositif d’éclairage, de manipulations, de mise en scène, de calibrage, des coûts de laboratoire exorbitants. Même les choses que tu décides de filmer sont très humbles, très simples. Un néon, une goutte d’eau. Ce sont des aventures de la perception qui sont disponibles à tout le monde. Il y a une dimension amateur qui est rigoureusement maintenue dans l’utilisation du super8. Pas que tes films soient l’œuvre d’un amateur, mais en même temps, ce caractère amateur est si fondamental pour le super8. C’est ce qui crée la proximité avec ces images.
PC : C’est toujours participatif. Les images ont beau avoir été fabriquées, elles ne sont pas le fruit d’une ingénierie désirée et recherchée que l’on retrouverait dans l’image. Il y a des cinéastes géniaux, comme Jacques Tati, qui a construit une ville entière pour réaliser Playtime en 70mm. Un flop total, mais un film incroyable. De mon côté, je suis évidemment une autre tradition… Une tradition humble qui consiste à filmer ce à quoi tu es capable d’être présent. Que ce soit un insecte, un jeu de lumière, toutes choses qu’il est difficile de préméditer.
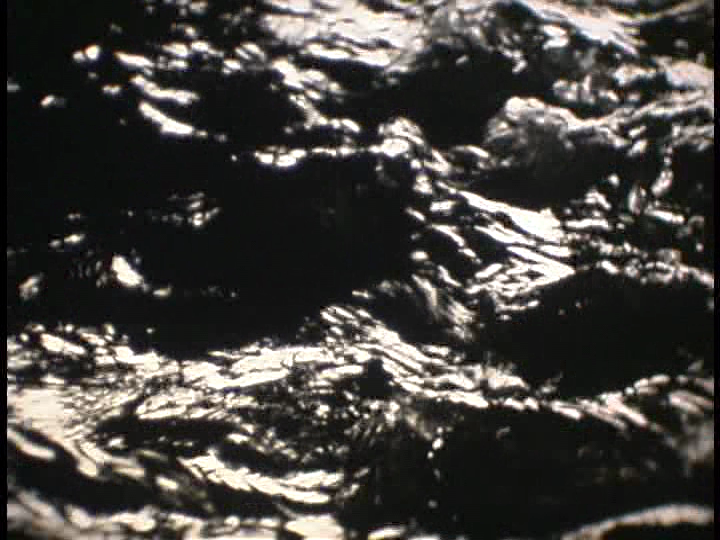

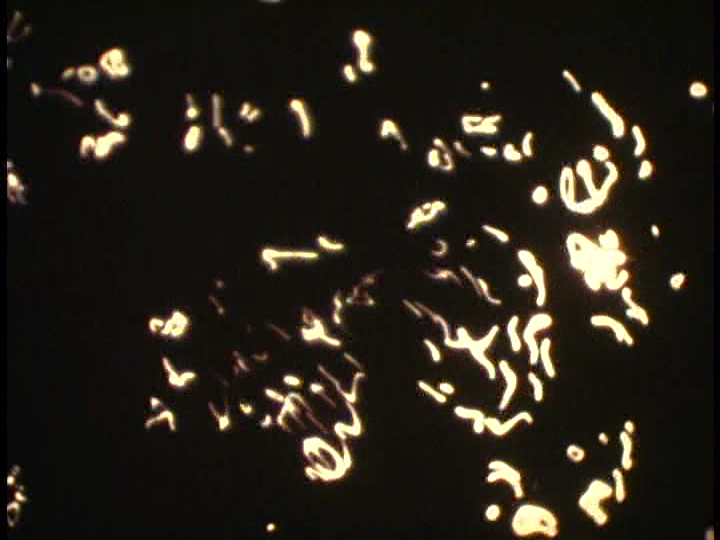
TUOLUMNE (2007)
HC : Il y a une autre tradition, humble aussi, qui est celle du documentaire scientifique, qui a parfois des affinités avec le cinéma expérimental. Je pense à Painlevé.
PC : J’adore les films de Painlevé, et ceux de Franju. J’ai beaucoup d’affection pour les courts métrages français. Un de mes films préférés est Le Chant du Styrène de Resnais. C’est tellement un film contradictoire, et ironique. Et aussi très expérimental. Il a reçu une commande pour faire un film sur le plastique. C’est a priori le truc le plus ennuyeux qu’on ne peut pas imaginer. Il trouve quelqu’un pour composer un commentaire en vers, en alexandrins, dans une langue fleurie.
HC : C’est le poète Raymond Queneau qui a écrit le commentaire…
PC : Le son est une sorte de mélange de musique d’avant-garde des années 50. En Cinemascope, la couleur la plus incroyable que tu peux imaginer, les travellings les plus sophistiqués, un montage rigoureux. C’est de la science fiction. Ça commence avec des objets suspendus. Les gobelets des dieux ! Ça se moque totalement de la commande. C’est très Tati au fond. Avec cette musique atonale, et cet ode poétique complètement délirant aux gobelets de plastique ! Et puis de là, on remonte dans le temps de la production, on refait le chemin inverse dans l’usine. Il y a une sorte de beauté constructiviste, à la Rodchenko, Vertov. Ce moment d’espoir envers la technologie et la mécanisation, et en même temps, il y a une ironie complète, dystopique, surréaliste. Et ça continue à remonter dans le temps jusqu’à une sorte d’état gazeux de la matière. C’est aussi un court métrage ! C’est tellement de chose dans une si petite boite. Ce qui me fait penser au super8. Les paramètres sont restreints, mais en même temps, ça peut être très chargé…
HC : J’aimerai revenir à la question du cinéma amateur. Est-ce que dans ta famille, on tournait en super8 ?
PC : Non, pas vraiment. Mon père enseignait l’architecture et ma mère était peintre et graphiste. Ils étaient très intéressés par le cinéma. Ils allaient souvent au cinéma, mais il n’y avait pas de caméras dans mon environnement, en grandissant. C’est devenu un intérêt pour moi durant mes études. J’ai étudié dans une école d’art, mais je faisais des films. Une des choses que je faisais et qui se rapproche obliquement de ce que je fais aujourd’hui, c’est que j’établissais des sortes de récits, mais je les tournais dans une autre ville, comme Toronto, ou Montréal. On parle du milieu des années 80. Ce n’était pas vraiment dans un esprit de cinéma documentaire. Mais plutôt, je trouvais que le décor, parce qu’il ne m’était pas familier, devenait génial. C’était une manière de découvrir, avec un nouveau regard, le tournage. L’espace influençait les films. Et c’est assez proche des films que je fais aujourd’hui. Le fait d’être jeté dehors dans ces espaces inattendus. Un peu comme dans ce que les situationnistes ont théorisé par l’idée de dérive. Ces parcours construits qui te lancent sur une trajectoire et te font découvrir la ville sous un autre œil. Tu navigues un espace qui est peut-être familier mais qui devient non familier. Ceci permet de révéler certains aspects de la ville, à tout le moins, qui devient le lieu d’une expérience. Je trouve ça en faisant des films. Ce sentiment de familiarité et de non familiarité.
HC : On retrouve cet aspect aussi dans les choix de lieux de tes films : tu filmes autant dans ton jardin que dans un paysage italien. Il n’y a pas toujours de différence palpable à l’écran, et souvent on ne sait pas où on est. Il n’y a pas de différence de nature. Il y a une différence, sans doute, pour toi…
PC : J’y réfléchis. Je pense que c’est un point important. Sphynx on the Seine est un bon exemple de cela. Chaque coupe de montage te fait sauter de temps et de lieux. Tu peux reconnaître qu’il s’agit de New York ou Moscou. Pour moi, c’est assez peu important que tu identifies le lieu. C’est important que tu perdes tes repères, que tu perdes ton équilibre. Pour moi, les images sont des faits. Mais, comme Marker l’a si bien exprimé dans son œuvre, l’histoire, après tout, n’est qu’une sorte d’interprétation. L’histoire, ça n’existe pas, c’est une construction. Quand tu regardes des images, elles sont à la fois une réalité concrète, mais en même temps une illusion. J’aime cette idée que l’on puisse voir une chose sans savoir ce que c’est. Mais elle peut produire une association. Et elle peut vous transporter quelque part, parce que ça vous fait penser au Japon. J’aime la banalité, et l’humilité des choses.




SPHYNX ON THE SEINE (2009)
HC : Un motif qui revient souvent dans tes films est un jeu avec le point et le flou. Souvent les choses sont vues hors foyer, et ce n’est qu’après un certain temps que le point est fait, ou qu’on recule suffisamment pour reconnaître l’objet filmé. Tu dévoiles la chose suffisamment pour maintenir le brouillard. On est toujours un peu au seuil de la reconnaissance et de la non-reconnaissance, de l’objet réel et de la pure force colorée, du pur mouvement sans forme.
PC : Où se situe la limite, en effet, entre la figuration et l’abstraction. Ce qui me semble incroyable c’est à quel point les propriétés technologiques de la caméra permettent de travailler cette limite. Le fait de traverser un espace seulement en variant la longueur focale. Je réalise soudain qu’il n’y a peut être pas de différence entre une image au foyer et une image hors-foyer. Une image hors-foyer peut être d’une extraordinaire beauté. Certes, selon une définition, cette image est nulle, le film est ruiné ; selon une autre, l’image est sublime, une abstraction digne de la lumière des toiles de Rothko ! Si tu étais dans une forêt, et que tu fixais une masse de feuillage dense, illuminée par l’arrière ou par un ciel couvert, et tu te mettais à filmer en macro, il y aurait toujours quelque chose qui serait au foyer. Soudain j’ai réalisé que pour définir l’espace, ce sont toujours des particules d’espace. C’est toujours une vague en mouvement. Mais c’est aussi le mouvement de la pensée. Elles bougent, elles se déplacent, elles ont des degrés de clarté variables, de façon volontaires ou involontaires. Et je me disais que la caméra avait des sortes de propriétés mentales, en tout cas, de façon analogiques. Je me suis beaucoup intéressé à cet écart entre le point le plus rapproché et l’infini (en terme de foyer), et je me suis mis à faire ces passes, ces transitions rapides. Et j’ai réalisé qu’il y a toujours des formes de montage internes. Il est impossible de voir quelque chose dans sa totalité. Tu peux déduire un concept qui le résume, de façon abstraite, mais ce ne sera jamais la totalité. Tout ce que l’on fait, tout ce que l’on voit, est fracturé. C’était une réflexion au fond sur la question du rythme et de la surimpression que j’explore dans mes films.
HC : C’est une idée bergsonienne au fond, d’une certaine façon. Pour que chaque présent passe, il faut qu’il soit en même temps déjà passé et déjà projeté vers le futur qui le borde. Chaque présent coexiste avec le passé et le futur. C’est-ce que tes films produisent comme impression : une impression de coexistence de temps, de choses et de lieux, à chaque présent.
PC : Oui. Et il y a une dimension physique à ça. J’ai fait ça avec mon film Chorus, qui est la même chose que l’on trouve dans le film Nature, que je n’ai pas apporté. Chorus faisait la même chose avec des lumières, la nuit. Parfois on dirait un même mouvement continu, mais en fait il est composé de plusieurs mouvements. Et encore une fois je trouve que c’est un processus mental. C’est notre compréhension de la conscience. C’est quelque dont Benjamin parle, en reprenant lui aussi une idée de Bergson. À propos de Baudelaire, je crois, il suggère l’idée que la conscience est une sorte de mur, fait de membranes, qui nous protège des stimulus du monde externe. C’est le choc du monde moderne, en particulier, qui nous assaille. Je pense que mes films fonctionnent un peu de cette manière, en ce sens qu’il est impossible de tout absorber. Notre conscience filtre…
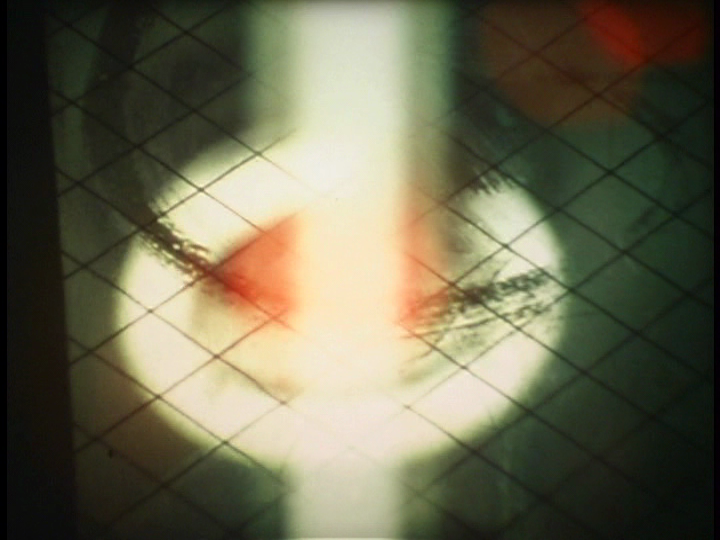
CHORUS (2009)

CHORUS (2009)

CHORUS (2009)
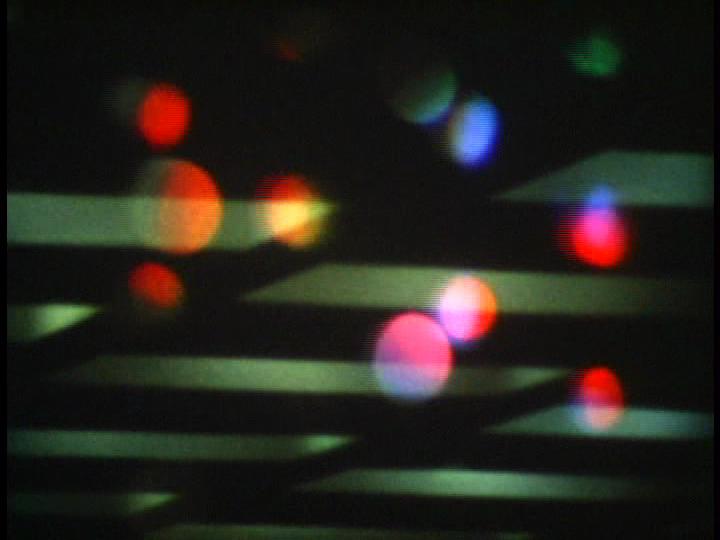
CHORUS (2009)
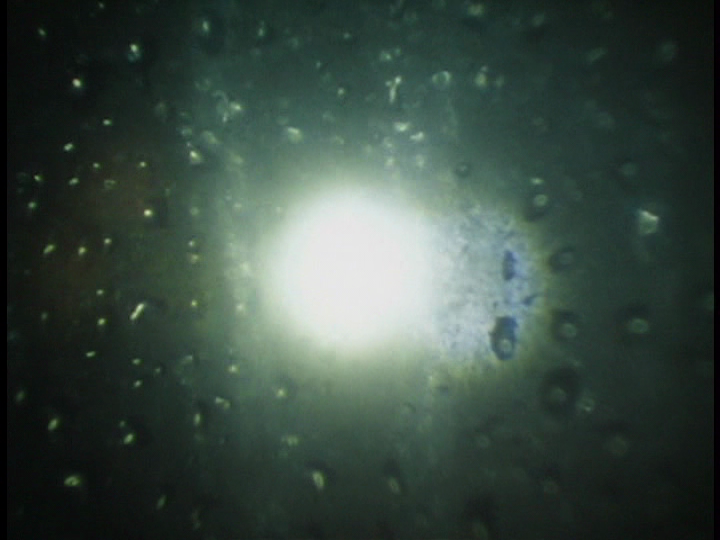
CHORUS (2009)
HC : Baudelaire parle, dans Le peintre de la vie moderne, du « kaleidoscope de la conscience »… Cette expression rend compte de l’expérience qu’on peut aussi éprouver au contact de tes films.
PC : L’aspect excitant à propos des films et des couches d’images, c’est qu’une fois qu’une image est imprimée, elle ne peut plus être effacée. Tout ce qui entre est indélébile et reste. C’est une trace de ce qui a eu lieu. Ça vous force à assumer les choix.
HC : Lorsque tu fais des surimpressions dans la caméra, procèdes-tu de façon plus ou moins aléatoire, où sais-tu à chaque pied, voire photogramme de pellicule, ce qui a déjà été imprimé ?
PC : Non, ce n’est pas trop réfléchi. D’une part, la caméra est limitée. Je ne peux pas reculer plus que 50 photogrammes. Même si on m’a souvent décrit des passages beaucoup plus long de surimpression, mais pour tout dire, je ne sais pas comment cela s’est produit ! Ceci dit, je dis que ce n’est pas conscient, mais je crois que la rapidité du travail fait en sorte que de façon consciente ou inconsciente, tu te découvres des intérêts, tu deviens fasciné par quelque chose et tu essaies de rester le plus collé. Tu essaies de faire progresser cette phrase, la faire évoluer, la compléter, à trouver quelle autre phrase peut lui répondre, et ce sont parfois des mosaïques denses de choses superposées. Quand tu filmes tu les envisages comme des morceaux séparés, mais plus tard tu les saisis comme un mouvement plus continu. Ou parfois ce sont des choses très rompues, très chaotiques, très discontinues. Ou des choses qui sont connectées par leurs singularités.
HC : Nous sommes à l’époque post-kodachrome. Nous sommes aussi à l’âge du simulacre où il est assez facile sur son Iphone de simuler toutes les pellicules, et tous les effets imaginables, du Polaroid à la super8. Évidemment, ça n’a aucun sens, et n’offre évidemment aucune des possibilités réelles que permet le fait de tourner en super8 (le fait de tourner image par image, réaliser des surimpressions, travailler sur des expositions différentes, etc.). Dans un contexte où la pellicule tend à être de plus en plus difficile à trouver, que plusieurs compagnies ont cessé d’en produire, te considères-tu comme une race en voie d’extinction ?
PC : Je suis constamment rappelé qu’un des plus grands risques pour un créateur c’est la facilité, et c’est une bonne partie de la tendance de la société occidentale capitaliste aujourd’hui. Une des choses les plus importantes, c’est de prendre profondément acte des limites imposées par ton médium. Il faut que tu ressentes ces limites et les difficultés qui lui sont liées — et je parle ici de limites que tu choisis, que tu t’imposes. Avec telle caméra, ou tel type de film tu ne peux pas faire ceci ou cela. Je pense que nos vies doivent être perçues, appréciées et chéries telles qu’elles nous sont données. Souvent on me demande : « Pourquoi tu tournes encore en film ? » Je ne le fais pas comme un investissement pratique. C’est une forme d’expression de la beauté, où se trouve une forme de vérité, pour moi, que je peux parfois partager. C’est comme de dire que tu es sur la plage et de quitter avant que le soleil se couche, sous prétexte qu’on sait qu’il va se coucher. De dire qu’on ne tournera plus en pellicule, parce que la pellicule va disparaître, revient un peu au même. Je pense que ça finira par disparaître. C’est un peu de beauté incroyable que je ne parviens toujours pas à comprendre, je suis encore ébloui comme si c’était la première fois. Je travaille beaucoup en vidéo comme médium pour des installations. Je trouve que la vidéo s’apparente au dessin contour. Il y a des propriétés visuelles des contours des formes, et sa relation au temps qui me semble intéressantes. Moins en tant que médium visuel, mais en tant que sculpture, en tant que forme lumineuse. Je pense que la pellicule est encore et toujours d’une bouleversante beauté. À tous les jours je me dis que c’est un peu ridicule de continuer à vouloir travailler avec un médium constamment menacé de disparaître, à la fois vieux, présent, passé, à l’avenir incertain. Mais je me dis parfois que nos vies sont un peu comme ça. Notre vie est à la fois ancienne et neuve. Elle vous paraît des fois orientée vers l’avenir, parfois tournée vers le passé. Les matériaux avec lesquels on vit, avec lesquelles on travaille, ont un rôle important à jouer. Nous enregistrons notre passage sur terre. Il y a une fascination pour l’histoire et le passé. On parlait de flâneur et ça m’a fait pensé aux photos d’Atget. Il enregistre ce passé éphèmère, évanoui, négligé, absent, banal, le décomposé, l’abandonné. Le super8 est une bonne métaphore pour ça. C’est à la fois vieux, ça viellit, c’est fragile, ça va disparaître. C’est comme si ç’avait déjà disparu. Mais c’est comme le rayon vert, c’est éphémère, et c’est pour ça que c’est si précieux, c’est ce qu’on veut tous voir.

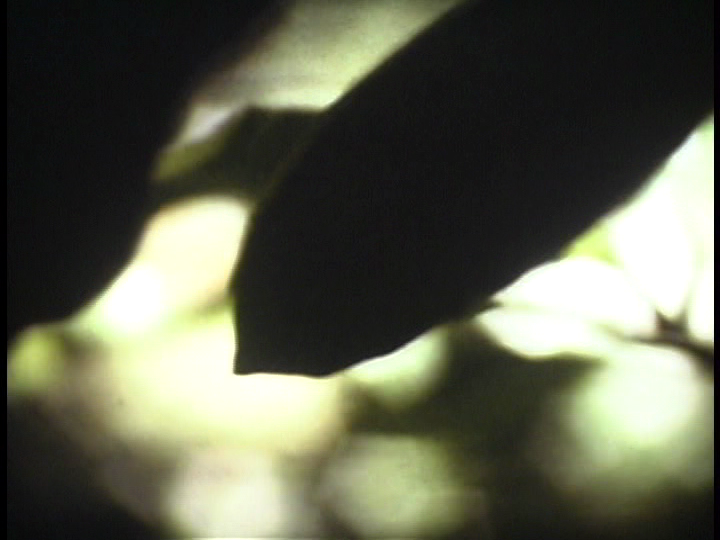

THE LIGHTS & PERFECTIONS (2006)
HC : Une dernière question au sujet de la conservation des films, de la fragilité des supports. La plupart des films que tu projettes sont des inversibles originaux… tournés en Ektachrome ?
PC : Tous les films sont en effet les inversibles originaux. J’essaie d’utiliser autant que possible une pellicule Fuji, Velvia, 50D. C’est comparable au Kodachrome. C’est peut-être un peu plus froid que le Kodachrome mais j’aime beaucoup cette pellicule, surtout pour les plans de nuit. Sur la question de la préservation, en effet, je visionne mes images en vidéo, en préparation. Je ne projette les films que lors d’événements en direct, ou à une projection singulière. J’essaie autant que possible de transférer certaines copies en 16mm, tant et aussi longtemps que ce sera possible. Bien sûr, il y a toujours la part de risque, de danger, et une anxiété liée à la perte. J’essaie à la fois de faire attention, et en même temps, d’apprécier chacune des projections.
HC : En tant que spectateur, le fait de voir une chose aussi singulière, unique, fragile, fait qu’on se sent privilégié.
PC : Oui, c’est unique. La performance musicale est unique, mais la projection l’est aussi, d’une certaine manière. Les gens y vont pour une expérience unique, non répétable.
HC : C’est l’idée de l’aura paradoxale de la pellicule. Et c’est particulièrement vrai de la pellicule inversible : c’est une copie unique qui nous fait toucher le réel qui s’est imprimé sur elle. Paul. Merci pour tout.
PC : Merci à toi.


UNION (2010)
Cet entretien a été réalisé à Montréal le 26 janvier 2011. Retranscription et traduction : André Habib.
