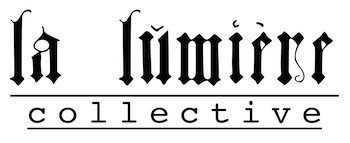Ben Balcom en trois films
Ce texte est présenté dans la cadre de la série ÉMERGENCE, organisée et présentée par [la lumière collective->www.lalumierecollective.org], en collaboration avec la revue Hors champ[[ De nuit, la lumière collective est un microcinéma qui projette des films, des vidéos et du cinéma élargi produits par des artistes locaux et internationaux. De jour, la lumière collective est un studio d’artistes et un espace de résidence avec plusieurs ressources permettant de travailler et expérimenter sur divers supports d’images en mouvement. Le collectif est dirigé par des artistes et conservateurs locaux qui croient en la création d’œuvres et d’espaces cinématographiques sur une échelle humaine. Nous facilitons des évènements afin de rassembler les gens. Nous créons des liens pour répandre et revitaliser le cinéma.
La lumière collective est ancrée dans le local, le physique, l’ici et maintenant.
En ce moment de connexions virtuelles et distanciation physique, nous avons transformé notre espace de projection en un espace virtuel, tout en conservant la connexion locale.
ÉMERGENCE est la version en ligne adaptée des activités concrètes prévues par la lumière collective. L’amour en ligne à l’époque de COVID.
Au lieu de tout simplement décharger les films et vidéos proposés en ligne, la lumière collective a sélectionné une œuvre par artiste et a demandé à ce qu’un écrivain local s’implique avec cette œuvre.
ÉMERGENCE est une nouvelle combinaison, une connexion locale, un engagement pour contrer la séparation.
Nous sommes impatients de vous voir de l’autre côté.
EMERGENCE est présenté avec le support du Conseil des arts du Canada. ]].
à propos de
Speculations Garden City Beautiful News from Nowhere— Je voulais simplement dire des choses directes et douces… Pasolini
— There is nothing else to trust but what warms… Samuel R. Delany
— La salicaire est une plante à la fois belle et un peu vulgaire à cause de son extraordinaire vitalité… Jacques Ferron

Pour muscler sa méditation crépusculaire sur la ville de Milwaukee, Speculations de Ben Balcom extrait des passages du Dhalgren de Samuel R. Delany. Dhalgren est un livre boule de feu ; tout en douceur, une énorme comète à chérir, et on peut regarder dedans également, sans se brûler les yeux. Le feu y déboule dans un étonnant chemin de mots, mots grippés, mots pressés, cela tient un peu de la prouesse, de l’énigme. On fait le plein dans le parfum de pétrole et de fin du monde. Revenus à la surface, les mots se reposent, vous reprendrez votre souffle, et jamais, dans tout ça de flammes et de boucanes, vous n’aurez accordé à l’imagination le répit qui dirait : Assez ! Que fais-tu de mon épuisement et dans quel merveilleux ravin le conduis-tu et que se passe-t-il de la brûlure d’habitude ? Je fais des culbutes pour dire que le Dhalgren fait avec Speculations un mariage réussi. Balcom va donc imposer à Delany une autre respiration que celle, époustouflante, qui est le naturel de son roman. Speculations commence sur une image noire, et dans le murmure argentique, une voix féminine, un peu endormie, un peu nonchalante, semble nous décrire dans ses mots — je n’ai du moins pas eu l’impression que ce passage était tiré de l’œuvre de Delany — la ville fictive de Bellona qui dans le film de Balcom est chargée d’interpréter Milwaukee. Une autre voix, également endormie, nous décrit une journée grise — les mots seront cette fois et dorénavant de Delany. Gris contagieux, gris totem, gris bronchite. Parc, nuages, ciel, tout est gris dans la journée sans ombres, dans la « ville parfaitement ordinaire. » De ce gris thématique émane une part d’ambiguïté : un regard sur la fin des choses, la fin qui n’en finit plus de finir, la fin qui rattrape constamment le présent. On ouvre les yeux dans ce regard et c’est le gris soluble de Verlaine qui est convoqué, le gris d’un art poétique, car le Dhalgren est bien des choses, trop de choses, peut-être, conte sans fruits, mais pornographique, chanson grivoise de l’Afrofutur, roman poussière et boursouflure, l’apocalypse en sandales, poème de gare labyrinthique par excellence, parabole hippie et aussi, otite marxiste. Mais s’il n’est pas, par exemple, une lasagne, il est, notamment et certainement, une ode à la poésie. C’est d’ailleurs pour cette raison que le film de Balcom cogne dans la jointure de la leçon poétique, précisément, et si cela est possible, sur l’Indécis et le Précis et se pose là où « seul fleurit l’inaccessible », je cite Jaccottet, et pour demeurer dans le joli jardin du poète, le fait en cherchant toujours la note intérieure. Les notes, d’ailleurs, elles résonnent, et Balcom s’en empare et en joue magnifiquement, un peu comme un romantique intuitif, s’assurant de jardiner sa mélodie du zeste de l’immense point d’interrogation et d’angoisse du roman : que s’est-il passé à Bellona, à Bellona qui ici est beaucoup moins que Milwaukee ?
— Où sommes-nous ? Je veux dire… qu’est-ce que c’est que ça, cet endroit ? Qu’est-ce qui est arrivé ici ? Comment est-ce que tout ça est survenu ?
— Une bonne question, très bonne même. Pendant longtemps, j’ai pensé que c’était la faute des espions internationaux — j’ai pensé que… oui… que la ville entière racontait une expérience, qu’elle portait en elle une sorte de contre-plan pour détruire tout : le pays, le monde, nous.


Tout à coup, dans une lumière de pleine lune, gris de plâtre, gris d’usine, une femme s’adresse à la caméra. Ses yeux sont inquiets, méchants, les sourcils froncés, elle ne cligne presque pas des yeux. Ses lèvres sont jolies. Elle a peut-être un afro. On ne voit pas ses pieds, ses bottes. Elle récite un monologue volontairement incohérent — il l’est d’autant plus qu’il est cité, comme tout d’ailleurs, sans le contexte narratif de l’œuvre de Delany. Elle met en mots un revirement de perspectives.
— Dans ma ville, dit-elle, c’est toi qui as perdu la raison.
Une autre femme apparait. Elle est blonde et accompagnée d’un homme, il a l’air perdu, elle a l’air sérieuse. On ne voit pas ses pieds, elle non plus. Dans son monologue, l’invisibilité de l’esprit est évoquée. Après les descriptions du début, les mots s’affichent maintenant avec une prédilection plus philosophique, s’imprimant dans l’œuvre selon une direction nébuleuse, explosive. À cet effet, les philosophes que l’on rencontre dans Milwaukee ne sont peut-être pas des plus saints. Ils s’adressent à la caméra, et à des heures pas possibles, prononcent des verdicts de fatalité, ils sont les avocats du pire et de la ville qui est condamnée, restons du côté de la poésie, à la « défaite sans avenir ». Ils sont tous un peu poètes, même ceux qui sont en fait des ingénieurs. Dans un film réalisé en 1971 par Delany, on trouve un plan dans lequel un homme écrase une poignée de compas sur la surface d’une fenêtre. Un plan étrange, donc, excellent. Le film de Delany, intitulé The Orchid, semble être une tentative aussi maladroite que fascinante — louable ratage quand même — de rendre à l’image l’énergie impressionniste qui anime son écriture. Même si ce n’est certainement pas l’intention de Balcom, je peux dire que Speculations, avec une élégance cinématographique et un soin visuel qui échappent à Delany, y arrive, il y arrive, les pieds dans l’époque, la tête dans l’aujourd’hui, le demain, embrassant un décalage, celui du texte et des images, et dans l’amitié de la lumière, mais quand même, avec le concours de la nuit et des ombres, avantage poésie, les plus beaux fruits se cueillent dans la lumière des marges. Et ça se termine bellement sur une citation qui est tirée de la saison de la Peste, quatrième partie, juste après la maison de la Hache, et dans laquelle le personnage principal de Delany, cet homme qui ne porte qu’une sandale, qui a des mains hideuses, qui n’a lu Mallarmé qu’en portugais, qui ne connait pas son nom et qui, dans ses temps libres, griffonne des poèmes dans un calepin, ce calepin qui contient d’autres poèmes dont il ignore tout de l’auteur, sinon que cet auteur est peut-être lui-même, une autre version de lui-même, bref, lui discute longuement avec un autre poète, érudit, prolixe, sage, drôle, à l’image du projet poétique de Delany, le dénommé Newboy. Balcom, dans une intention qui n’est certainement pas anodine, offre les derniers mots de son film à ce dernier, poète et visiteur, qui passerait, comme nous, par là. C’est un beau moment dans le bouquin, mais aussi dans le film et en guise de conclusion, je le traduis humblement de l’américain :
Lorsque vous me demandez la valeur de ces poèmes, vous me demandez en fait quelle place l’image de cette ville tient dans l’esprit de ceux qui n’y sont jamais venus. Hélas, je n’ai pas la prétention d’en offrir à quiconque la suggestion. Par moment, alors que j’erre dans la brume abyssale, ces rues me semblent appartenir à toutes les capitales du monde. À d’autres moments, je vous admets trouver que la ville ressemble à une erreur répugnante et inutile, qui n’entretient aucune affinité avec ce que je pourrais concevoir du monde civilisé et du coup qu’on devrait l’anéantir en plus de l’abandonner. Je ne peux pas la juger parce que je l’expérimente, la ville, de l’intérieur. Je ne pourrai pas en juger non plus une fois en dehors, ailleurs, pour la simple raison que je n’en resterai pour toujours qu’un visiteur.


Si je demande à mon téléphone de traduire vers le français le titre Garden City Beautiful, il répond Ville Jardin Magnifique. C’est une réponse simple et honnête, à l’image du film, ce qui fait penser, je ne sais pas pourquoi, qu’il n’y a rien de particulièrement nouveau dans les films de Ben Balcom. Qui me fait également penser que l’idée même de la nouveauté est une illusion qu’il vaut mieux ne pas chasser, à laquelle il ne faut surtout pas prétendre, surtout si la création a le malheur de s’affubler de l’étiquette expérimentale. Mais de Balcom, c’est l’absence de nouveauté, ou d’expérimentation, qui me permet d’en saluer l’audace discrète et de mieux y discerner sa sensibilité. Une absence travaillée pour chuchoter, dire très peu, mais dire quand même juste assez, chuchoter magnifiquement, c’est encore souhaitable. Ce qui se loge alors dans l’oreille va filer droit dans le cœur, comme si le cœur était un étui, le film, sa musique, une musique totale qui serait à elle seule la convalescence rêvée d’un monde fou, fou braque. La littérature se cache dans ce cinéma, que je veux dire, et la seule nouveauté pertinente me semble tenir de sa volonté effacée de dire tout en ne participant pas à la cacophonie ambiante. De se tenir en marge, pour n’être rien d’autre que ça, de la musique, et très justement, le murmure de l’image. L’avant-garde recycle la nouveauté de ses expériences depuis au moins un demi-siècle — sa plus grande audace est de toujours se réclamer de l’avant garde. Voilà plutôt une œuvre qui n’a de prétention autre que de mettre des textes d’hier en contact avec des images d’aujourd’hui, plus précisément, des images de Milwaukee et plus précisément encore, des textes qui s’adressent à son devenir. Balcom troque le ciel gris pour le ciel bleu, un ciel de carte postale, un ciel de rêves placides. Une voix, toujours un peu endormie, fait la lecture d’une lettre de Victor Berger, rédigée en 1895. Berger était un homme politique, socialiste, lucide et inquiet. Le contenu de sa lettre, sorte de shampoing pour l’apocalypse, l’apocalypse détendue, de celle qui donne naissance à l’entraide et aux communes, comme dans le Dhalgren d’ailleurs, apocalypse avec des poux lumineux, un mal de cheville, cheville bleue, et qui dit la fin du capitalisme et l’indice du progrès dans ce qu’il a de plus vertigineux. Une catastrophe a mis l’individualisme dans un tombeau. Le besoin de l’autre, de rencontrer l’autre, annonce l’ère du vivre ensemble. Les ouvriers accèdent à de meilleures conditions. Les machines sont des amis. Orwell à l’envers, le rêve de William Morris ou l’avènement dans le vrai monde du Major Barbara de Shaw. Mais les étoiles électriques, que se plait à filmer Balcom nerveusement, annoncent que le présent du film n’a rien retenu du futur de Berger, sinon que ce futur est l’articulation d’un rêve qui est criant d’actualité, de vérité, de la vérité qui pénètre le sommeil, le rêve de ceux et celles qui rêvent de ne pas emprunter l’autoroute, mais qui le font, dans un désarroi secret. Balcom se reprend à rêver le rêve de Berger, à s’inscrire dans un cycle qui répète une même nécessité. Des personnages endormis répètent d’ailleurs ce qui a déjà été prononcé ailleurs. Une parenthèse, comme ça, mais l’idée de la répétition est une idée qui nourrit le Dhalgren de Delany de la même manière qu’elle semble ici donner lieu à un cycle qui se partage le jour et la nuit, comme si dans les mots de Berger se trouvaient cachés ceux de Delany, qui forment le secret de l’avenir de Milwaukee, le secret entendu par la caméra de Balcom, dans un rêve, sûrement, un rêve de survie. Ferron écrit quelque part que survivre heureux devient de plus en plus rare dans un « habitat que le béton, l’asphalte et le pétrole sont censés humaniser ». Je cite le plus grand barde du Québec, car il y a ensuite et pour finir, un concert de fragments d’autoroutes blessées, blessés par le progrès qu’elles engendrent, peut-être, béton, asphalte, pétrole. Je dirais que oui. Les images fortes et magnifiques se succèdent pour faire rimer des fissures qui balafrent le bitume. Dos au ciel, la caméra s’éloigne de ces berceaux de botchs de cigarettes, de ces réunions d’herbes malpropres et du goudron qui fait un pansement de glu noire, glu laide et féroce. Éloge de la salicaire ou de l’herbe grise, la répétition nous fait rencontrer une nature pourtant vaincue qui trouve là un accès héroïque vers la lumière. Elle redonne ainsi au peuple des plantes une emprise sur son territoire. De l’espoir, caché dans les sutures de l’autoroute. C’est là, une interprétation tout à fait contestable, je le reconnais, mais c’est la mienne.
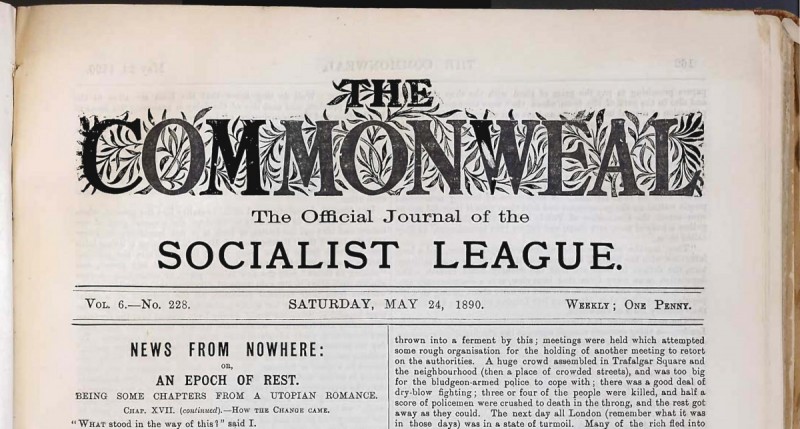
Ben Balcom réalise enfin News from Nowhere, dont le titre, par voie d’un clin d’œil à William Morris et à son roman utopique du même nom, est particulièrement intéressant. Le roman de Morris raconte ce qui se trame dans le souterrain du précédent film de Balcom, c’est-à-dire, l’histoire du rêve d’une société future, basée sur le partage et le bien commun. Je le mentionne, car plus qu’une référence, le contenu de cette œuvre tisse de précieux liens entre le film et les précédents, et recontextualise vers l’intime le magnifique texte de Bernadette Mayer, tiré de son recueil Utopia, et qui sert ici d’inspiration principale à Balcom. Ces « nouvelles de nulle part » racontent un autre rendez-vous à l’enseigne du Gris soluble. En résulte une image du monde poétique encore plus évanescente, qui a perdu sa totalité pour se fixer dans la marge du temps. Je n’ai ici rien vu de Milwaukee, encore est-il que je ne sais rien de Milwaukee, sinon l’emblème du cerf, sinon le mariage du base-ball et de la bière, Paul Molitor, ce cogneur qui ressemble à un livreur de lasagne, Michael Redd, catapultaire, citrouilles et tout ça, et aussi, du même coin, Jacob Blake et les assassins policiers. Ce que je ne sais pas, c’est le reste, l’énigme du vert des parcs et de la banlieue, le message qui se cache dans la musique des oiseaux et des saxophones. Le « nulle part » du titre se précise, comme le texte. Une lumière diamantée s’y conjugue, se précise encore, à l’image de cette longue missive panoramique que précède le noir et blanc d’une tapisserie. Elle évoque la nature, la tapisserie, et aussi, les ouvrages de William Morris, penseur du futur et pionnier d’un art décoratif pensé à la souche de l’ancien, lire, l’indémodable. Vous entendrez une musique ambiante. Si vous reconnaissez cette musique, c’est qu’elle semble extraite de la trame sonore de la moitié de la production expérimentale du monde. C’est une musique inoffensive – or, elle se découvre ici dans une déclinaison plus douce que d’habitude. Elle est moins dans ta face, car ce qu’elle vise peut-être, c’est le cœur et l’âme, ces contrées d’un autre nulle part. Elle entretient cette faiblesse, c’est-à-dire, de viser dans le plus mou, mais enfin, je n’oserais pas complètement le lui reprocher. Si vous êtes un adepte du cinéma expérimental, vous la rencontrez donc souvent, cette musique, je parle de celle des drones, bourdon électronique, sauce ambiante, tonalité élastique, mélasse passe-partout aux variations minimes. Si cette musique est pourtant si familière, elle a chez Balcom le grand avantage de jouir du soutien du chant des oiseaux. Lui aussi, nous est familier. Il l’est surtout parce qu’il est souvent la seule musique qui compte. Une musique qui rassemble en elle l’existence du poème qui se respire par les sens. Au début, la tapisserie qui reproduit des images de la nature cède la place à la vraie nature. Du moins, on s’en approche, on sort dehors, voir les oiseaux. Voir les oiseaux, avec les oreilles. Une mouche aussi passe par là. Alors que le texte se termine sur une question, un son enfin organique nous fouette comme pour répondre : le son du saxophone s’appuie sur la chanson des oiseaux. Sur un chemin de terre, la caméra tourne, mais fait aussi tourner le vert des arbres et des ombres. Dans les fragments de ciel bleu, bleu, mais pas trop, un espoir d’après-midi. Et dans le bleu, une sorte de fin apparait. Elle apparait sans se nommer.