AUTOUR D’UNE FEMME MARIÉE
Des films de Godard des années 60, Une femme mariée n’est pas le plus connu, pour ne pas dire qu’il est carrément oublié 1 . On se souvient peut-être, et même parfois sans avoir besoin de l’avoir vu (en feuilletant seulement un livre consacré à Godard), de la censure qui frappe le film, notamment en raison de son titre [le film fut présenté à Venise sous le titre La femme mariée], on se souvient peut-être du mollet ou de la poitrine de la magnifique Macha Méril, des innombrables publicités de soutiens-gorge, de la photographie toujours parfaite de Coutard. Un film oublié, sans doute à tort. Certes, le film ne possède pas l’ostentation romantique, déchirante du Mépris, explosive de Pierrot le fou, il ne respire pas cette puissance juvénile d’Une femme est une femme, de Bande à part ou d’À bout de souffle, la badinerie des Carabiniers, la gravité du Petit soldat, l’iconoclasme d’un Week-end, n’a peut-être pas toute la puissance mélancolique de Vivre sa vie, de Masculin-féminin ou la radicalité de 2 ou 3 choses que je sais d’elle, de La chinoise, du Gai savoir, etc. Véritable « film-entre », on y retrouve néanmoins comme dans une monade, des fragments de toutes ces choses (techniques, style, ton) qui constituent le génie de cette œuvre et son inscription bouleversante dans son époque, ainsi que des questions qui reviendront hanter l’œuvre des années plus tard (les camps, la mémoire). C’est une sorte de film adulte (bien que marqué ici et là par des bouffées d’enfance [le monologue du petit garçon qui reviendra dans 2 ou 3 choses] et des fixations d’adolescence [la passion fétichiste de Godard pour les dessous féminins]), comme l’est La peau douce de Truffaut (cité d’ailleurs dans le film) ou comme les Bergman qui lui sont contemporains (on pense bien sûr au Silence) et d’où il tire pour une part son esthétique (des plans froids, des gros plans sur des détails de corps, filmés comme des objets, nus, disposés sur des grandes surfaces blanches) et ses thèmes familiers (un couple adultère, un travail introspectif, la confession, la banalité quotidienne de la bourgeoisie, l’ennui). Il est d’ailleurs frappant de rappeler que cette même année 1964 voit ces trois films (Le silence, La peau douce, Une femme mariée) frappés d’interdit par la commission de la censure.
Notoirement mal distribué (on le trouve depuis quelques temps dans une belle copie américaine), je l’avais vu à Londres, lors de la grande rétrospective du NFT, en 2001, puis encore, il y a quelques temps en DVD. Je me suis alors, encore une fois, étonné d’y trouver des choses tout à fait remarquables, toutes plus ou moins tombées dans cette zone trouble de la mémoire que l’on appelle l’oubli et que je prenais plaisir à retrouver, neufs. Je me souvenais d’un film lisse, un de ces films de Godard, et ils sont rares, où la ligne narrative, ondoyante, musicale, est la plus équilibrée, claire, où les audaces stylistiques sont tempérées, apparaissant sans ostentation, comme ouatées. Je me souvenais de Macha Méril (née princesse Maria-Magdalena Wladimirovna Gagarina), en bourgeoise un peu toujours étonnée d’être sur terre, avec cette sorte de beauté asiatique aux yeux clairs (répétant « oui, oui, oui »), parfaite, de la photo de Coutard, avec cette grâce un peu austère et tranchante, des fondus au noir sur des plans rapprochés de jambe, de nuques (que déjà Le mépris préfigurait). Je me souvenais d’un film que les gens bêtes qualifient de film « mineur », et que serait absolument incapable de réaliser le plus habile des cinéastes aujourd’hui (d’autant qu’il a été conçu, tourné et monté en quatre mois, entre le festival de Cannes et celui de Venise).

Ces « fragments d’un film tourné en 1964 », pour lisses qu’ils soient (Truffaut a cette belle formule, quand il lui écrit : « Ta belle petite femme mariée ressemble à un grand mélange bien homogène »), sont aussi marqués par une certaine rugosité. Cette rugosité se fait sentir parfois au détour d’un échange banal, des phrases dites comme ça, en passant, et qui fait que le film coince, ou grince : « Ce n’était pas la peine de me violer ni de me donner des claques. Ça n’a jamais été le meilleur moyen pour avoir de la gentillesse. — Je te demande pardon. » Ou encore « Vous avez entendu parler d’Auschwitz ? — C’est la thalidomide ? — Non, pas exactement, c’est une vieille histoire juive, un camp…— Ah! Oui, Hitler. »
Bien sûr, comme bien des films de Godard, le génie de ce film est logé dans des détails. Tantôt ce sont des courtes idées fulgurantes, comme cette séance de photo montrée en négatif, à la piscine, un procédé qui reviendra dans Alphaville, ou encore ces enchaînements de mots suivant un flot de conscience [« À quoi penses-tu? »] que l’on retrouvera dans 2 ou 3 choses, et que Godard perfectionne notamment grâce à son système de l’oreillette, mis au point dans ce film et qui lui permet de poser des questions ou de faire dire des phrases sur le vif aux acteurs, en gardant toute la fraicheur de la parole ou de l’idée.
Ce film doux-amer sur la bourgeoisie et la société de consommation, laisse aussi libre cours à la fantaisie de Godard, comme ce bulletin de circulation, qui peut passer inaperçu, comme il le sera pour les protagonistes du film, annonçant que : « A 14h30, 1723 morts et 132 blessés, tel est le premier bilan de cette première journée de vacances que les spécialistes de la circulation ont déjà qualifié de journée rouge. » Ou encore cette scène étonnante où une bonne faisant la vaisselle expose le récit de ses ébats sexuels dans un parler rustre et baroque à la fois (on comprend éventuellement qu’il s’agit de pages tirées de Mort à crédit de Céline). Il y a ces plans vifs, pris à la volée au Printemps Nation, dans les rues de Paris, un franc et long dialogue avec un (vrai) gynécologue (il s’agirait du premier film français qui aborde directement la pilule contraceptive, même si Godard a été obligé de couper une séquence où il était question de la sodomie comme méthode de contraception). Il y aussi, dans cet appartement de banlieue aseptisé tout droit tiré de L’eclisse (Une femme mariée avait d’ailleurs enthousiasmée Antonioni qui remportait le Lion d’or pour Deserto rosso cette année-là à Venise), ces phrases reprenant la rhétorique utopique des « villes nouvelles », comme plus tard ceux de Pierrot le fou reprendront des slogans publicitaires (« Tout ici est de qualité, vous avez vu en bas les façades élégantes, où joue la pierre de taille, etc. »). Il y a aussi ce superbe clin d’œil à Truffaut, hommage non seulement à La peau douce (que la coupure de journaux donne à lire), mais aussi à Jules et Jim, par le truchement d’un tableau de Picasso sur le mur du salon 2 .

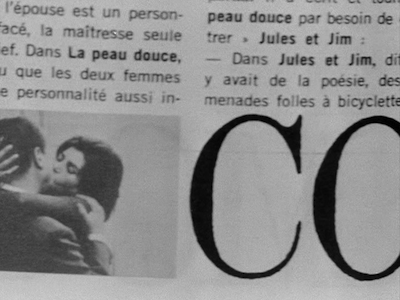

Il y aussi cette présence, dans le dernier quart du film, de l’aéroport d’Orly, au cours de longs travellings mettant en valeur ses lignes froides et fines (comme le sont celles du film) et où l’on aperçoit, à deux reprises, et pour un bref instant, si on fait attention, le reflet de la légendaire chaise roulante de Coutard, poussée par Godard.


C’est à Orly que se donnent rendez-vous les amants (dans un cinéma où l’on passe Nuit et brouillard, et qui nous rappelle que 1963, c’est l’année du procès Eichman, 1964, c’est l’année du procès d’Auschwitz), dans cet aéroport (inauguré en 1961) qui constituait un des lieux parisiens les plus visités à l’époque, plus populaire que la Tour Eiffel (3 millions de touristes non voyageurs en 1963). Évidemment, Godard y est, capte tous ces bouts d’histoire, comme Marker un peu avant lui (La jetée est de 1963) et Tati aussi, dans Playtime (qui après avoir commencé à tourner in situ, à Orly, devant l’abondance du trafic, doit le « réinventer » en studio). Orly, ainsi, permet de mettre en série trois films (quatre si on inclut deux séquences tournées à Orly dans La peaud douce de Truffaut, ce qui aurait peut-être d’ailleurs inspiré Godard) qu’on n’aurait pas tendance à penser ensemble, mais qui tous trois, à bien y penser, ont une manière commune de faire époque (une fois nommés côte à côte).
Et puis il y a un ensemble de choses plus secrètes qui relèvent moins du film de Godard que de mon investissement personnel, de ma fixation. Il y a d’abord ce geste, difficile à décrire, qui revient à deux ou trois reprises, de l’actrice, les poings fermés, la tête légèrement penchée, se frappant doucement les joues, sorte de tic nerveux qui signale sûrement une douleur intérieure, mais à ce point discret que personne ne doit en capter le signe, ni l’angoisse dont elle est le symptôme. Une angoisse, une peur sourde passait dans ce geste (on la voit le poser la première fois à l’aérogare où, après avoir passé la journée avec son amant, elle accueille son mari, avec ce geste qu’elle se retourne pour poser, comme si elle cherchait à se dire à elle-même, et à nous, « patience, patience, ne dit rien, ne fait rien, tout va bien ».) Un geste comme une ritournelle, qui apaise en même temps qu’il la nomme, une peur d’exister. Ce geste, dans sa discrétion, sa quasi-invisibilité, semble pouvoir incarner à lui seul, au-delà du drame particulier de ce personnage, la tension d’une époque qui, à l’image du film, présente une couverture glacée, mais qui, si on a le loisir de s’en approcher, apparaît fissurée de toutes parts. Godard aura été un des plus éloquents témoins du caractère trop volontairement lisse de son temps, comme de ce qui le ravine et le fissure.

Et puis il y a ce long monologue de Roger Leenhardt, critique et cinéaste, aimé et respecté, ami de Bazin et des Cahiers, figure de ces intellectuels vieille école qu’affectionne Godard (on pense bien sûr à Brice Parrain dans Vivre sa vie), un peu paternel, donnant une leçon de doux et vieux sage, une improvisation sur le thème « Qu’est-ce que l’intelligence? », où Leenhardt défend les vertus du paradoxe, et fait, en hommage à Emmanuel Mounier, l’éloge du compromis comme de « la plus courageuse des opérations intellectuelles. » Mais tout en écoutant ce vieil homme sympathique dérouler ces jolies phrases, on peut être happé par une curieuse chose. Deux, plutôt, choses curieuses. Dans la courbe intérieure des arcades sourcilières, au-dessus des paupières de cet homme, curieusement logé dans cette partie creuse où la peau est si fragile, et parfaitement symétriques de chaque côté, deux petites excroissances de chair énigmatiques. Et à mesure que cet homme aux yeux clairs et à l’expression sagace nous fait don de la générosité de son esprit, je m’accroche à ces apostrophes de peau, j’en détaille, perplexe, le motif, cette étrange fente au centre qui plisse la peau, qui lui donne l’allure d’une petite bouche de crustacés, d’une ventouse, d’un coquillage de chair, et je ne cesse de m’étonner devant le mystère qui veut que ces deux verrues — que pourrait-il s’agir d’autre — soient à ce point identiques. Ceci a quelque chose de choquant au fond, aussi choquant, pour reprendre la formule de Bataille, « qu’une mouche sur le nez d’un orateur. » Il y a quelque chose de choquant, mais aussi de bouleversant, de drôle et d’injuste à la fois dans le fait de voir ce discours, pourtant si beau et lucide, se laisser distraire par quelque chose d’aussi bassement et bêtement « charnel », planté au milieu d’un visage qui se déforme.

Roger Leenhardt dans Une femme mariée

Ces deux petits morceaux de peau agacent et fascinent à la fois parce qu’ils sont à proprement parler inexplicables et inexpliqués, même, on se dit, à celui qui en est le porteur, qui ne s’en soucie guère. Cela se soigne-t-il, s’opère-t-il ? Ces deux boutures, ces deux replis, fonctionnent au fond — et m’ont amené à réfléchir — à toutes ces petites choses qui grincent et pincent dans ce film (et au cinéma en général, parfois), qui passent vite sous nos yeux, en faisant des saillies en nous, au milieu de choses placides et normales qui le peuplent. Comme le mot « thalidomide » (ce sédatif anti-nauséeux, fabriqué par une compagnie allemande et retiré en 1961, prescrit à des femmes enceintes dans les années 50 et 60 qui donnèrent naissance à des enfants troncs, à des monstres) mêlée à une évocation du procès d’Auschwitz, comme ces plans de Nuit et brouillard en contre-champ d’une banale histoire d’adultère. Comme un disque qui fait entendre une femme qui rit en boucle, alors que la scène, filmée avec froideur et distance, est triste à pleurer.


Relever un détail (et c’est le sens de cette chronique), dans ce qu’il a parfois d’aussi parfaitement insignifiant, d’obtus, est une manière de nommer, voire de poétiser (faute de pouvoir rationnaliser) le noyau d’obstination, la fixation obsessive à l’aune de laquelle se mesure et s’éprouve, au plus près, notre relation intime, souvent inavouable, avec les images. C’est une manière non d’en venir à bout, mais de décrire le mouvement d’une expérience qui nous dépasse, et à laquelle on ne cesse de faire retour.
Notes
- On lira toutefois avec intérêt les pages fascinantes qu’Antoine de Baecque consacre à ce film dans sa biographie, pour rappeler le rôle qu’il a pu jouer dans la consolidation symbolique de Godard au sein de la sphère publique française des années 60 : Antoine De Baecque, Godard, Paris, Grasset, 2010, p. 259-271. ↩
- Pour une lecture attentive des tableaux de Picasso dans Jules et Jim, on lira le récent ouvrage de Martin Lefebvre, Truffaut et ses doubles, Paris, Vrin, 2013. ↩
